« Fata Morgana » d’Etienne Rochefort
Peut-on encore se fier aux images ? Une enquête dansée entre cinéma et corps réels, au cœur d’une forêt (même pas) truquée.
Etienne Rochefort a très bien saisi une chose: Pour interroger les effets de l'intelligence artificielle sur nos vies, pas besoin de déployer sur le plateau tout l'arsenal des nouvelles technologies. Les questions soulevées sont plus profondes. Celle qui préoccupe le directeur de la compagnie 1 des Si concerne la relation entre l'image et le réel, qui est en train de changer radicalement. L'IA en est fortement responsable en rendant les trucages du deepfake accessibles à tous. Il y a peu, l'image, qu’elle soit fixe ou mobile, par la photo ou par le cinéma, jouissait encore d’un statut documentaire par rapport au réel, et ce malgré les trucages déjà en jeu, souvent à des fins politiques. « J'ai été habitué, conditionné à ce que l'image illustre des faits ou des événements censés être une réalité à travers le monde », écrit Rochefort.

En gros, les images étaient dignes d'un crédit certain. A l'ère de l'IA, leur indice confiance est en chute libre. Toute image publiée est d'emblée à considérer comme fausse, devant apporter la preuve de son authenticité. Ou bien comme une œuvre d’art. Et plus elle semble vraie, plus il faut s'en méfier. C'est en tout cas ce que semble vouloir nous dire Etienne Rochefort quand il donne la définition du titre de son duo : « Une fata morgana est un phénomène optique qui résulte d'une superposition de plusieurs images, provoquant des mirages. » Ce qui décrit assez bien les effets qui se produisent sur le plateau.
Troubles sans trucages
Fata Morgana est une rencontre entre danse et cinéma, tantôt par juxtaposition, tantôt par superposition. Images filmées, images dansées. Au début, on se croit dans une salle de cinéma improvisée, squattant le plateau pourtant prévu pour la danse. Aussi Fata Morgana commence tel un film no budget. Une femme, dans une salle de bains, se lave les dents. Elle donne l'impression d'être stressée, angoissée. Quelque chose se prépare, mais qu’est-ce qui l’attend ? Puis elle prend place à une grande table, face à une baie vitrée. Et soudain, sa présence semble réelle, physique, scénique. Nous savons pourtant, pertinemment, qu'elle n'est que projection. Un premier trouble. S’habitue-t-on à l’image ? Y a-t-il un trucage, sans même avoir recours aux hologrammes ?

Arrivent les danseuses, Marine Wroniszewski et Mégan Deprez, voyageant grâce à la caméra. Elles traversent un désert, dansent face à une plage, prennent le métro parisien. Et sont soudainement prises en sandwich entre une projection au lointain et une autre, sur un rideau de gaze séparant la scène de la salle. Apparaît alors une forêt incertaine, ou les deux se baladent telles des fantômes entre des arbres apparemment bien réels. Puis deviennent réelles, apparaissant en chair et en os. Et l’image de la forêt retrouve son statut d’artefact. Dans ce va-et-vient, tout dépend de l'origine de la projection, de sa direction et du rideau visé. Il n’y a là pas non plus, à proprement parler, usage de trucages. Le dispositif s’affirme, s’avoue et s’explique. Et pourtant les illusions fonctionnent.
L’art du questionnement
La subtilité de la relation entre présences humaines et images projetées lance les deux interprètes dans un road movie dansé entre illusions d'optique et autres incertitudes rétiniennes, jusqu'à l’apparente disparition des danseuses dans un trou noir, d'une profondeur qu'on croyait réservée au Vantablack*

Avec Fata Morgana, Etienne Rochefort pose les bonnes questions aux images et aux corps. C'est le rôle des arts. Les réponses vont s'inventer ailleurs. Une pièce de danse, ici interprétée avec puissance et en beauté, peut néanmoins aider à aiguiser les consciences, ce qui contribuera en soi à améliorer la qualité des réponses que la société se doit d’apporter à une question aussi fondamentale.
Thomas Hahn
Vu le 18 février, Besançon, Les 2 Scènes – Théâtre Ledoux
* Le Vantablack (ou Vantanoir) est une matière inventée en 2012 faite de nanotubes de carbone agencés verticalement et serrés les uns contre les autres. Le Vantablack est le noir le plus noir qui existe : il absorbe 99,96 pour cent de toute la lumière et rend les objets foncés au point qu'on n'y distingue plus aucune forme ni texture : on ne perçoit même plus s'ils sont à deux ou à trois dimensions.
Distribution
Chorégraphie & mise en scène : Etienne Rochefort
Interprétation : Mégan Deprez et Marine Wroniszewski
Création musicale : Mondkopf
Création vidéo : Grégoire Orio et Grégoire Couvert
Création lumière : Olivier Bauer
Son : Bertrand Charret
Scénographie : Etienne Rochefort, Olivier Bauer, Grégoire Orio et Grégoire Couvert
Catégories:
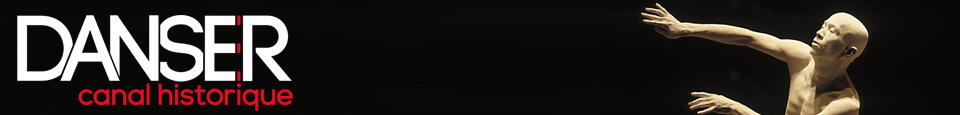
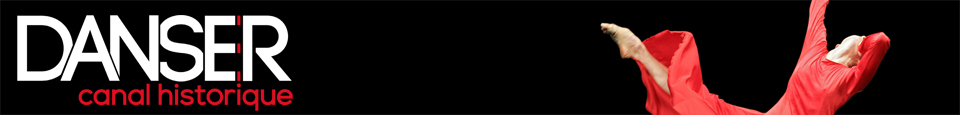






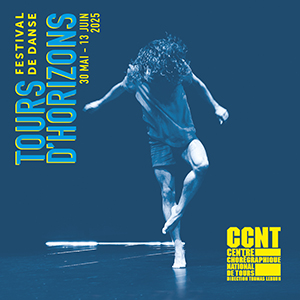








Add new comment