« Onéguine » de John Cranko par le Ballet de l’Opéra de Paris
Entré en 2009 au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris, Onéguine de John Cranko fait l’objet de reprises régulières, au grand bonheur des spectateurs et des danseurs, l’interprétation de cette sublime histoire de passion contrariée représentant une sorte de Graal, à la fois technique et émotionnel.
Il fallait une vision – pour ne pas dire, du culot – pour s’emparer des vers d’Alexandre Pouchkine pour en tirer un ballet intitulé Onéguine ! John Cranko, chorégraphe né en Afrique du Sud, alors directeur du Ballet de Stuttgart, (1927-1973) et maître indépassable du ballet narratif, en tire en 1965 une sorte de modèle absolu du ballet littéraire romantique. D’ailleurs, s’il forme John Neumeier, William Forsythe et Jiří Kylián, il pousse également Kenneth McMillan à devenir chorégraphe et c’est sans doute ce dernier qui hérita de cette veine de « ballets dramatiques », il suffit de voir Mayerling [lire notre critique] pour s’en convaincre.
Mais pour revenir à Onéguine, la chorégraphie est complexe à souhait. Apparemment centrée sur les quatre protagonistes que sont Onéguine, Tatiana, Lenski et Olga, les ensembles ont la particularité non pas de « faire avancer l’action » mais de lui donner une ambiance, un cadre, comme une sorte d’atmosphère qui rend d’autant plus réaliste le déroulement de ce roman mis en danse. La scénographie, les accessoires participent de ce récit, constituant comme des leitmotiv soutenant l’intrigue. En revanche, la musique – une sorte de pot-pourri de Tchaïkovski, rassemblée en partition par Kurt-Heinz Stolze, alors directeur musical du Ballet de Stuttgart – qui se sert aussi de leitmotiv pour structurer cet ensemble composé de pièces et de morceaux si elle ne dérange pas, n’est pas à la hauteur de l’ensemble.
Galerie photo © Laurent Philippe
En deux mots, l’intrigue est la suivante : Onéguine, dandy hautain et indifférent, est invité par Lenski, le fiancé d’Olga chez celle-ci. Il y rencontre sa sœur Tatiana, plus intéressée par les livres que les divertissements. Cette dernière a un vrai coup de foudre pour le héros et lui écrit une lettre qu’il déchire sous ses yeux lors d’un bal, avant de flirter ostensiblement avec Olga. Lenski provoque alors Onéguine en duel et ce dernier le tue. De nombreuses années plus tard, Onéguine retrouve Tatiana au bal du Prince Grémine dont elle est devenue l’épouse. Il tombe alors follement amoureux d’elle et lui écrit une lettre. Elle le reçoit mais déchire sa missive devant lui, tout en repoussant ses avances dans cette ultime entrevue.
Bien sûr, tout se joue dans les rapports entre tous ces personnages qui ont une liberté immense d’interprétation. Corollaire : il faut des danseurs d’une grande maturité artistique pour interpréter les rôles qui leur sont dévolus. Notamment pour les quatre protagonistes, qui tous peuvent l’enrichir de toutes les nuances à leur disposition.
Galerie photo © Laurent Philippe
Commençons par Onéguine. Mathieu Ganio a choisi d’incarner un jeune aristocrate arrogant et ténébreux, odieux et pourtant séduisant, qui laisse entrevoir derrière une morgue et une fatuité évidente, peut-être un douloureux secret. Les miroirs qui reviennent dans les trois actes de ce ballet quand il apparaît sont peut-être une clef de ce personnage absent au monde et imbu de lui-même que Ganio personnifie admirablement. Ludmila Pagliero -Tatiana, en habituée de cette partition chorégraphique aussi virtuose que difficile, campe une jeune fille rêveuse, aussi romantique que celles des livres qu’elle dévore, une proie idéale pour ce Narcisse féroce, puis une femme sûre d’elle-même et de son pouvoir de séduction mais prête à vaciller de nouveau, avec une intensité rare. Marc Moreau (Lenski) campe parfaitement ce jeune homme honnête et attachant, amoureux et entier au point de risquer sa vie. Un rôle auquel Cranko semble avoir dévolu une chorégraphie d’une grande technicité, comme pour souligner sa droiture. Enfin, Léonore Baulac en Olga, sait également jouer des contrastes, passant de la « vierge sage » du premier acte, à la « vierge folle » du deuxième où elle se laisse sinon séduire, du moins instrumentaliser, par Onéguine.
Galerie photo © Laurent Philippe
La chorégraphie proprement dite sait faire évoluer le récit sans la moindre pantomime avec une fluidité à nulle autre pareille. De plus, son vocabulaire ose des combinaisons imprévues, des portés acrobatiques périlleux, des innovations d’écriture, des leitmotiv gestuels intelligemment disposés, et des ellipses. Bref, il sait insuffler à un ballet des procédés littéraires bienvenus. Ainsi, le duo rêvé du premier acte entre Tatiana et Onéguine se répète – ou plutôt se répercute – à la fin comme en miroir. Mais un miroir déformant, où la fougue des premiers émois imaginés alors par Tatiana, se transforme en assaut sensuel et désespéré avec des portés saisissants.
John Cranko savait si bien composer gestes et attitudes pour exprimer un sentiment, une sensation, une intériorité, par la façon d’enserrer le mouvement dans des transitions, d’affiner les postures du corps pour les rendre signifiants que l’on en oublierait la danse, pourtant si exceptionnelle. Le corps de ballet et ses danses collectives inspirées par le folklore, forment un écrin chorégraphique de premier plan qui renforce tout l’effet théâtral de ce ballet exceptionnel, porté formidablement par l’interprétation de l’Opéra de Paris.
Agnès Izrine
Le 8 février 2025. Opéra Garnier. Jusqu’au 4 mars 2025.
Catégories:
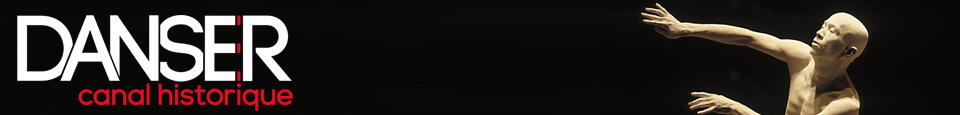
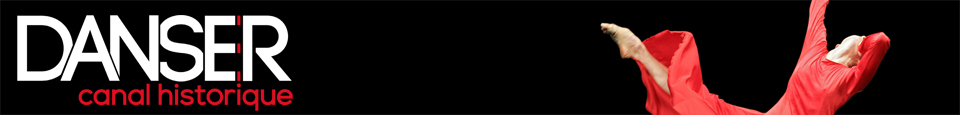



















































































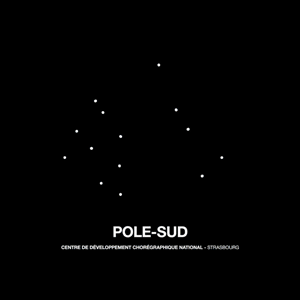







Add new comment