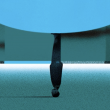« Cinq apparitions successives » de Vincent Dupont
Nous avons découvert la pièce de Vincent Dupont Cinq apparitions successives dans le cadre du programme New Settings de la Fondation d’entreprise Hermès au Théâtre de la cité.
Bien conçue, clairement énoncée, la chorégraphie respecte et, dans une certaine mesure, illustre l’objet de son titre. Sa structure, sinon son atmosphère, est nette et précise, composée de cinq parties distinctes séparées par des fondus au noir. Ce noir, summum de l’élégance pour Marlène Dietrich ou, si l’on veut, cette « nuit où toutes les vaches sont noires » pour citer Hegel dans sa préface à La Phénoménologie de l’esprit, maxime équivalente à notre proverbe « la nuit, tous les chats sont gris » est renforcé, tout au moins dans la première partie de l’opus, par un épais brouillard, un écran de fumée, une nébulosité pouvant rappeler le mythe de la caverne.

La boîte noire du théâtre ou, à la rigueur, le huis clos de la discothèque, peuvent artificiellement produire ou reproduire de tels effets de dépaysement ou de perte de repères chez les spectateurs comme chez les habitués de boîtes dites de nuit. Selon nous, la partie la plus captivante de la chorégraphie ne réside ni dans l’agitation, en solo, duo ou trio des interprètes, par ailleurs remarquables – Alicia Czyczel, Raphaël Dupin, Kaïsha Essiane, Kidows Kim, Émilie Labédan, Aline Landreau, Konstantinos Rizos– ni dans le rapport danse-musique, toujours à l’unisson, mais dans la sensation d’étrangeté, recherchée et obtenue par divers moyens.
Un de ceux-ci étant la marche lente, hésitante, tâtonnante des protagonistes à l’avant-scène qui, comme vous et moi, mettent un temps à accommoder, à découvrir le champ de l’action, voire à ne pas voir ou n’en pas croire leurs yeux. Lorsque Kaïsha Essiane fait sa traversée de jardin à cour, on songe à celle qui dans notre souvenir prit plus de vingt minutes à Ko Murobushi pour se rendre du piano sur lequel il était perché aux tôles accrochées aux cintres dans le Centaure et l’animal, en 2012. On pense aussi, naturellement, à la Gradiva de Jensen chère à Freud comme aux Surréalistes.
Galerie photo © Marc Domage
D’après Olivia Grandville, présente à la première, l’auteur de la scénographie, non crédité sur la feuille de salle, n’est autre que Vincent Dupont qui laisse libre cours grâce à l’art plastique et celui de l’architecture « son obsession des rideaux, des perspectives en point de fuite, du théâtre comme projection d’un hors-champ ». L’accentuation des angles rappelle un peu La Dernière Cène (1955) de Dali, qui détournait la vision brunelleschienne en l’encapsulant dans un vaisseau spatial. Sauf que dans le cas présent, Dupont ne vise pas la mise à jour mais son contraire, l’obscurcissement, l’abstraction.
À cet égard, le prologue du poète disparu Christophe Tarkos (son texte truculent « Je gonfle » dit à la façon d’un Wolman ou d’un Ben) ne nous éclaire pas plus sur l’enjeu ou sur ce qui se trame sur scène. Les danseurs se font nos représentants, s’offrant la plupart du temps de dos, l’avant-scène devenant le premier rang d’orchestre. Ils apparaissent et disparaissent de tous les côtés possibles – sauf du plafond. La lumière d’Yves Godin cristallise la fantasmagorie, plonge les sept samouraïs dans un univers spectral plus proche de celui de Mizoguchi que de Kurosawa, sculpte l’immatériel tel un disciple de Fujiko Nakaya.
Nicolas Villodre
Vu le 1er juin 2021 au Théâtre de la cité internationale.
Catégories: