Faits d’Hiver : Féminismes divers
La moitié des propositions de la 22e édition de Faits d’Hiver ont été consacrées à des prises de pouvoir féminines. Signe du temps ?
Christophe Martin l’a bien exprimé, dans nos pages, sur nos écrans : « comme le festival n'est pas une thématique ou un principe, je suis toujours étonné à la fin de découvrir ce que l’édition recelait » [lire l’article]. C’est d’autant plus vrai pour le festivalier. Plusieurs sentiers s’ouvrent pour traverser, rétrospectivement, l’édition 2020 qui interpelle par le grand nombre de propositions dans lesquelles les femmes s’emparent de domaines et de figures créés sous l’emprise masculine sur l’imaginaire collectif, de la Vierge Marie aux samurais. Du plus explicite au plus subtil, chaque artiste amène son regard, son esprit, sa méthode.
Teresa Vittucci - Hate me, Tender
Teresa Vittucci, Suissesse de Zurich (malgré son nom italien), a décidé de prendre le mal par la racine. La Vierge ! Dans cette image-source du rôle de la femme dans la société judéo-chrétienne, « maternité et virginité se confondent pour former l’essence d’une féminité idéale », écrit Vittucci. Seule représentante du discours éco-féministe dans cette édition de Faits d’Hiver, elle accorde à la Vierge d’incarner vulnérabilité, compassion et amour, des qualités dans lesquelles elle « trouve des bases féministes et militantes pour un contrat social idéal ». Chez Vittucci, Marie devient « une puissante héroïne et ambassadrice d’un féminisme queer ». Puissance des images, du corps et de la voix chantant l’incontournable Like a Virgin de Madonna.
Sous un voile orange feu, elle lance des regards de biche angéliques, le corps peint d’un dessin entre le Faune de Nijinski et le Mondrian d’YSL. Le voile, elle se le met dans la vulve, historie d’en finir avec « la sujetion de la femme par le phallus ». On lui croit, sur parole et sur image, que son Solo pour un Futur Féministe est autant fait de tendresse pour Marie que de critique de son instrumentalisation patriarcale. Mais cet équilibre se construit sur des extrêmes. Et inévitablement, il y a caricatures, jusqu’à l’autocaricature.
Bernardo Montet - Mon âme pour un baiser
Vittucci a une sœur d’âme dans cette édition de Faits d’Hiver, et elle s’appelle : Nadia Beugré. La chorégraphe est ici l’une des trois femmes dans la dernière création en date de Bernardo Montet [lire notre critique], un trio féminin offensif et incisif, prônant un féminisme joyeux qui invite à partager leurs danses, et qui épouse d’autres luttes concrètes, comme celle des peuples originels du Brésil pour leur droit à exister. Au passage, la Vierge Marie aussi en prend pour son grade. Combatif, carnavalesque, revendicatif et toujours prêt à dégainer, le trio féminin arbore des corps qui choisissent librement entre une gamme d’identités, du désirant au mélancolique, du vigoureux au monstrueux, de l’intime au politique. La tâche de Montet était de créer une dramaturgie qui révèle les énergies de ce féminisme passe-partout en les orchestrant, tout en le laissant s’exprimer à sa guise. C’est réussi. Un homme chorégraphe au service de trois interprètes féminines, c’est un message en soi.
Samurai I : Camille Mutel - Not I
Elle se prépare à faire la cuisine (pour nous ?), et fait monter le suspense, jusqu’à ce que son couteau tranche l’oignon épluché par ses soins, tombant tel un couperet (ou la main d’un karateka tranchant une brique). Mutel accomplit une série d’actions et part sur les chemins qui les relient tel un pèlerin. Elle fait face à un étau, avance à genoux, tire une énorme planche de bois brut et sort un énorme couteau de son tablier qui est autant une robe de geisha ou de samurai. On serait tenté de parler de lenteur, mais comme en butô, il s’agit d’un état, et d’ouverture. Les butokas le vivent de l’intérieur. Chez Mutel, tout est dans l’adresse au monde et aux spectateurs. Elle crée des natures mortes, des scènes de crime ou de violence, montrant ce qui reste d’un acte ou qui le précède. Ses poses et images sculpturales sont tranchantes comme l’énorme couteau de cuisine, énigmatiques ou symboliques, comme le poisson qu’elle tient entre les dents et qu’elle finit par percer, comme dans un rite.
A plusieurs reprises, elle met en suspension un instant où tout se décide, comme dans un oracle. Cette geisha-là fait intrusion dans un univers masculin, sans aller jusqu’au seppuku. Car l’acte final du samurai est autocentrique, alors que Not I crée un espace relationnel. Geisha oblige, ce féminisme-là est d’une subtilité absolue.

Samurai II : La BaZooKa - Solo OO
« Sois brave au combat, maintenant que tu es un homme » lisons-nous sur une pancarte tenue par un homme déguisé en lapin blanc. L’injonction s’adresse à une femme en tenue de samurai (Sarah Crépin) autour de laquelle tourne une autre femme déguisée en chien blanc (Marie Rual). Crépin et Cuppens redoublent d’esprit iconoclaste et farfelu, faussement enfantin, ludique et facétieux, pour s’amuser de l’esprit guerrier des mâles. Quand l’homme entre en scène, dans le costume du lapin, il vient pour passer l’aspirateur. Qui eût cru que le féminisme puisse être d’une telle drôlerie? Pour s’y attendre, il fallait avoir vu les créations précédentes de La BaZooKa. Car Sarah Crépin et Etienne Cuppens avaient déjà colonisé, féminisé et tourné en dérision, dans Queen Kong, l’identification masculine aux fantasmes les plus poilus: « Dans la forêt, les trois reines kong plantent la hache. / Dans la forêt, les trois reines kong crient leur joie. » Dans Solo OO (de fait un nouveau trio), les poils sont blancs comme dans le grandiose Monstres Indiens [lire notre critique], consacré à l’idée d’une Amazone sioux. Le lapin blanc y était du côté d’Alice (au Pays des Merveilles, bien sûr). Ici, il renvoie à Usagi, le lapin devenu samurai dans la bande dessinée japonaise, en référence aux films de samurai d’Akira Kurosawa, qui ont beaucoup influencé cette création de La BaZooKa, avec ses échos cinématographiques, oniriques et burlesques.
Yumi Fujitani - Aka Oni
C’est un fantôme rouge écarlate qui s’érige sur un socle, à un angle de rue, face à l’église Saint-Merri. Yumi Fujitani, ancienne soliste d’Ariadone, la compagnie de Carlotta Ikeda et Ko Murobushi, créé une féminité incandescente entre le sacré, l’érotique, le spirituel, le sanguinaire et le douillet. Aussi elle évoque entre autres le bondage japonais et les Miko, ces jeunes femmes devins au service des sanctuaires shintoïstes, alors que le titre renvoie aux oni, esprits diaboliques et maléfiques, typiquement représentées en guerriers dévorants et hyper-masculins. Les Japonais savent s’en protéger par des cérémonies ancestrales. Fujitani fait mieux : Elle s’infiltre dans leur royaume.

Entre ses références au soleil levant, Akaoni peut aussi nous rappeler Médée ou la menstruation. Au choix. Dans tous les cas, ce n’est pas rien que de s’exposer ainsi en montant sur Le Socle, lieu de rue consacré à l’art contemporain, un soir de février sous le regard des passants qui profitent des soldes d’hiver. En bravant les adversités diverses, Aka Oni ne revendique rien de manière explicite, sauf le droit de faire apparaître la féminité comme on veut, où on veut. Une façon de chasser les esprits machistes?
Nach - Beloved Shadows
Nach évoque la femme en pulvérisant les stéréotypes sur le « sexe faible ». Dans Beloved Shadows [lire notre critique] la plus universelle des krumpeuses convertit son expérience de résidence à Villa Kujoyama en une plongée dans le royaume des ombres, sans pour autant se convertir au butô. Elle s’empare de ces ombres que nous portons en nous, généralement sans en être conscients. Paradoxalement, les ténèbres font ressortir, plus que toute lumière, la puissance d’un corps où muscles et sensualité ne font qu’un. Elle évoque ainsi une force ancestrale qui pourrait appartenir aux sociétés matrilinéaires disparues. Une image de femme d’avant le féminisme...
Nathalie Pubellier - Non, pas toi !
Mise en scène par Benoist Brumer dans une chorégraphie de Jean Gaudin, Nathalie Pubellier livre ses souvenirs d’enfance et de danseuse. Et c’est sulfureux. Nathalie Pubellier incarne d’abord la sévérité de sa professeure de danse et ensuite le machisme des directeurs de casting du Paradis Latin où elle est engagée (« Tu dois me faire bander quand tu danses ! »). Prochain casting, même attitude: « Tu m‘appartiens! » Il suffit parfois de faire part de la réalité pour dénoncer. Non, pas toi !n’est pourtant pas un spectacle « #metoo ». Avec humour et lucidité, la réflexion de Pubellier sur son parcours ne contourne pas le bonheur éprouvé (« J’étais au Paradis, j’étais la masquotte! ») et sa capacité à résister. La proposition du Crazy Horse sera déclinée (« Un sous-sol, avenue George V ? Non ! »). Le féminisme de Non, pas toi !semble arriver en creux, au gré du choix de nous parler de ces (més)aventures. Car Pubellier aurait pu mettre l’accent sur le travail avec sa propre compagnie, L’Estampe, ou bien sur les bienfaits d’une formation rigoureuse, qu’elle confirme par son interprétation, avec sa précision du geste et du phrasé, sa clarté et sa pertinence.
Valeria Giuga - Rockstar
La danse a permis aux femmes de trouver leur place dans l’histoire des arts de la scène, avec Loïe Fuller, Isadora Duncan, Martha Graham… Des stars! En confiant le rôle de la star à Noëlle Simonet, interprète historique des premières heures contemporaines à Angers et Nancy, Valeria Giuga la hisse, en ce qui concerne la célébrité, au niveau des vedettes de la musique rock, ici représentées par Jean-Michel Espitallier, ancien batteur de rock, aujourd’hui poète. Il évoque l’histoire du rock, où les femmes se font bien rares, même dans les années 1960 à 1990 dont il est ici question. Et en danse? Mais parmi les sept chorégraphes dont Simonet reprend des passages qu’elle avait interprétées à la création, on ne trouve que deux femmes: Viola Farber et Brigitte Lefèvre. Pourtant ce duo n’est pas un manifeste. Mais la liste des chorégraphes qui comptent, énoncée à la fin est nettement plus féminine que celle du rock, même si on est loin de la parité hommes-femmes. Par contre, entre le rock et la danse, la parité est acquise. Mieux : la danseuse tient sa revanche sous les projecteurs. Un féminisme par procuration ?
Christine Armanger - MMDCD
Sur son rail circulaire, la rame TGV tourne au ralenti, signifiant l’heure qui tourne, seconde par seconde. A l’intérieur du cercle, en compagnie d’un crâne humain, la performeuse chorégraphique Christine Armanger nous appelle à une pleine conscience du temps et nous rappelle que notre temps sur terre est compté. Et on compte les secondes. Il y en a 2900, exprimé en chiffres romains dans le titre. Tempus fugit ? Non hic! Reste qu’Armanger s’empare du jouet le plus typiquement masculin qui soit, pour le faire tourner en rond, sans autre but que de continuer à incarner un monde qui n’avance pas. Comme toutes les vanités, MMDCD vous rappelle que, homme ou femme, vous allez, umm, umm… DCD!
Thomas Hahn
Faits d’Hiver, 22eédition, du 13 janvier au 8 février 2020
Catégories:






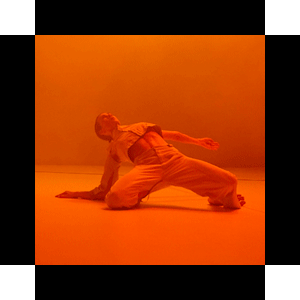





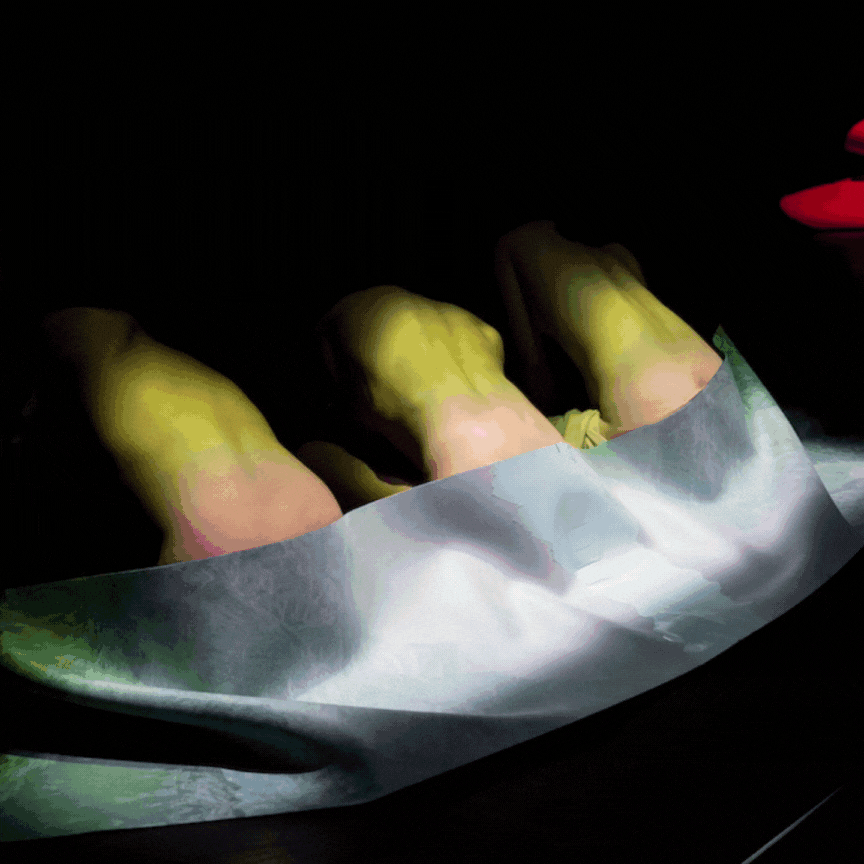






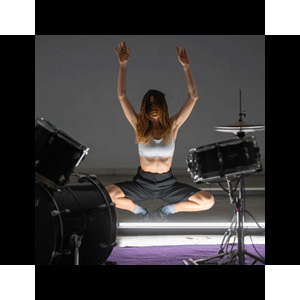

Add new comment