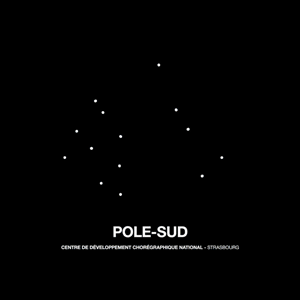William Forsythe et Ryoji Ikeda à la Grande Halle de La Villette
Deux installations géantes confrontent leurs visiteurs à un vertige métaphysique. Somptueux.
Un souci de justesse imposerait d'inventer ici un genre de restitution croisée des deux installations géantes qui se répondent dans la Grande Halle de La Villette. L'une conçue par William Forsythe, l'autre par Ryoji Ikeda. Mais un souci de commodité de propos, nous fera épouser ce qu'est l'expérience du visiteur-spectateur. Lequel ne peut effectuer leurs deux traversées que successivement, l'une après l'autre. Il faut bien les découvrir – dans ce cas les arpenter – et ici tenter de les décrire.
Toutefois, on soulignera d'emblée ce que leur mise en rapport a de magique sous la nef géante où elles sont disposées. Elles se font face, comme de part et d'autre d'une place publique. Elles occupent toutes les deux un volume analogue, aux proportions géantes. Celui-ci s'apprécie tout autant depuis leurs bordures, qu'en se glissant à l'intérieur de leur déploiement, ou encore de haut, depuis les coursives qui entourent la salle, à l'étage. L'expérience est immersive.
 Il y a là un jeu vibratoire géant. En y plongeant, notre esprit a pu se laisser gagner par de très antiques réminiscences d'une archéologie sensitive de ces lieux : c'était comme y entendre la rumeur multidinaire des masses de bétail qui connurent là leur premier, mais fatal contact avec la civilisation urbaine (historiquement, l'équipement de La Villette n'était autre que les abattoirs de la capitale).
Il y a là un jeu vibratoire géant. En y plongeant, notre esprit a pu se laisser gagner par de très antiques réminiscences d'une archéologie sensitive de ces lieux : c'était comme y entendre la rumeur multidinaire des masses de bétail qui connurent là leur premier, mais fatal contact avec la civilisation urbaine (historiquement, l'équipement de La Villette n'était autre que les abattoirs de la capitale).
William Forsythe tout d'abord. Nowhere and Everywhere at the Same Time n°2 consiste en six cent dix pendules laissés en suspension. Tous plongent à même hauteur, de cheville humaine, en nappe près du sol. L'ordonnancement est parfaitement régulier, orthogonométrique, au-dessus d'un gigantesque tapis blanc, parfaitement rectangulaire. Les pendules sont de facture standard, de forme à la fois globulaire et pointue, taille d'abricot, en métal qui brille sous une lumière assez douce mais franche. Profitons-en pour évoquer le fond sonore : il est d'une texture analogue, entre souffle et grondement légers, tout juste modulés par longues nappes, produisant une sensation d'arrière-plan, plutôt que de bain.
Les sources lumineuses étant nombreuses, l'ombre projetée au sol par chaque pendule se diffracte en plusieurs petites tâches virevoltantes, aussi fragiles que des papillons. Tout est extrêmement simple, quasi banal, dans ce dispositif saisi d'un premier coup d'oeil. Ce sont ses logiques de mise en série multidinaire et de déploiement d'ampleur gigantesque, qui lui confèrent une puissance d'ordre cosmique, propice à une méditation métaphysique.
Galerie photo © Martin Argyroglo
Pour un esprit qui s'y livre pendant plus que deux ou trois minutes, en évitant de se cacher derrière la fonction photo-vidéo d'un smartphone – soit une très faible proportion parmi les visiteurs – une tension exceptionnelle se creuse entre la brute évidence de cette sobre installation et l'immensité des mises en perspective mentale qui s'en dégage. Il suffit d'ailleurs de se déplacer doucement, d'une simple marche sur le bord, pour que la saisie scopique décale progressivement les perspectives d'alignement et de croisement du damier en suspension qui s'offre au regard (on songe aux colonnes de Buren).
Or, rien de cela n'est statique. Les fils de suspension sont fixés, discrètement, à des grills suspendus en grande hauteur. Et ces grills sont mobiles, roulant sur des rails, en plan horizontal. Une machine orchestre leurs mouvements, en modulant leurs niveaux d'intensité et leurs grilles de rythmicité ; cela en fonction de répartitions dans l'espace. Près du sol, il en découle que les six cent dix pendules entrent dans une danse géante, faite de vagues, de houles, de sursauts, de rebonds, de dillutions, d'amalgames, en nappes, et en survols. C'est d'autant facinant que toujours sobre, et vaguement énigmatique quand on cherche à en déceler l'exacte écriture, qui nous surprend plus qu'elle ne s'impose.

Nul doute que William Forsythe atteint là à une traduction supérieure de l'un de ses concepts favoris, selon lequel la notion de chorégraphique ne saurait en rien se rabattre, encore moins se réduire, sur celui de danse. Sa chorégraphie a ici quelque chose de total (en décapant ce mot de toute nuance idéologique), sorte de transport de la matière du monde, par une combinaison dynamique de paramètres physiques de l'espace et du temps. On en reviendrait à un Lucrèce, s'émerveillant du ballet premier des atomes et particules, ici préalablement conçu avant d'être offert à la possibilité d'une danse chez le visiteur.
En effet, il n'est pas interdit de s'élancer à l'intérieur même de l'installation. Il s'y aiguise un sens de l'auto-affection perceptive, qui nécessite souplesse et adresse, au moment de se faufiler et se mouvoir sans toucher aux fils et aux poids en mouvement – sans quoi on en perturbe l'action, leurs trajectoires dévient, leurs rythmes se brisent, et la trame s'entremêle. C'est plutôt désolant. L'expérience n'en est pas moins douce, sensitive, captivante, qui reverse chacun à sa conscience de n'être pas seulement autonome et volontariste dans son geste transperçant l'univers, mais d'être tout autant récepteur, modestement partie prenante d'un grand ballet des éléments, qui nous précède. Et nous dépasse.
!["test pattern [nº13]" - Ryoji Ikeda © Martin Argyroglo](/sites/default/files/test_pattern_no13_ryoji_ikeda_c_martin_argyroglo1_1.jpg) L'installation de Ryoji Ikeda suggère plus commodément l'action physique du visiteur-spectateur, puisqu'aucun obstacle ne se présente sur l'immense plan horizontal où son œuvre s'active. Une fois déchaussé, quiconque est invité à y déambuler à sa guise.
L'installation de Ryoji Ikeda suggère plus commodément l'action physique du visiteur-spectateur, puisqu'aucun obstacle ne se présente sur l'immense plan horizontal où son œuvre s'active. Une fois déchaussé, quiconque est invité à y déambuler à sa guise.
Etrangement, au moment de notre présence, aucun spectateur – d'une population pourtant jeune pour l'essentiel, mais planquée derrière ses smartphones – ne s'égaya au-delà d'une simple marche, sinon d'un arrêt contemplatif. Pourtant, le grand son, lui très présent, déployé par le plasticien-musicien-chorégraphe, plonge d'emblée dans la culture musicale de synthèse électronique, la plus actuelle.
Est-ce ce facteur de reconnaissance immédiate qui aura émoussé l'impact de cette œuvre dans notre perception ? L'installation test pattern est en fait terriblement sophistiquée, si on la rapporte au minimalisme des principes mis en œuvre par William Forsythe. Chez Ikeda, un déferlement technologique de pointe déchaîne un crépitement de sons très secs, dans un entrechoc savant de pulsations accélérées.
!["test pattern [nº13]" - Ryoji Ikeda © Martin Argyroglo](/sites/default/files/test_pattern_no13_ryoji_ikeda_c_martin_argyroglo3.jpg)
Cet aspect haché du son croise le graphisme vivant d'une sorte de code-barre géant, de bandes strictement noires ou blanches, débitées au sol. C'est sur cette image animée à la taille d'une rue piétonne, qu'on est invité à évoluer, induisant de l'impulsion et du rythme au niveau des appuis, quand le bain sonore, très puissant, tient d'un raz-de-marée tout autour.
La dimension strictement binaire et contrastée du découpage visuel en noir et blanc, inspire un songe vertigineux, au moment de considérer la gamme au contraire infinie, presque inouïe, des variations visuelles possibles selon la largeur, la sérialisation, l'inscription en plans, la pluie en stries, les arrêts, les relances, hoquets, accélérations, des segments enchaînés. En ce qui nous concerne, il fut spontané d'y ressentir la suggestion d'entrer nous-même en mouvement de danse.
!["test pattern [nº13]" - Ryoji Ikeda © Martin Argyroglo](/sites/default/files/test_pattern_no13_ryoji_ikeda_c_martin_argyroglo2_0.jpg)
A travers ces deux installations, quelque chose dialogue, fondamentalement, entre Forsythe et Ikeda, lorsqu'il s'agit d'orchestrer une globalité métaphorique du monde en mouvement. Mais le chorégraphe américain semble remonter plus haut vers des fondements, ancestraux, du moins hors temps, de haute tenue philosophique, quand le plasticien japonais en impose, de manière plus directive, dans l'excitation d'un flamboiement technologique contemporain.
Gérard Mayen
Installation visible à la Grande Halle de La Villette (Paris), dans le cadre du Festival d'automne, jusqu'au 31 décembre 2017.
Catégories: