Ballet de l'Opéra de Nice, Forsythe, Brumachon, Van Manen, Ekman
En deux temps et quatre mouvements cette soirée du Ballet de Nice réunissait quatre chorégraphies sur quatre décennies. Un quarté gagnant.
Sur le final en allegro vivace de la 9e Symphonie de Schubert, un peu grandiloquent, s’élancent les cinq danseurs de The Vertiginous Thrill of Exactitude (1996), un quintette d’une technicité inouïe de William Forsythe, qui balaie, à toute vitesse, tout le vocabulaire classique – j’aurais presque envie de dire, d’un seul revers de main – pour forger son propre style. D’une difficulté sans appel, avec ses changements de directions intempestifs et ses enchaînements antinomiques – ou antianatomiques – les pas s’enchaînent sans trêve, pour mieux défier la danse académique avec ses tutus vert pomme en forme de disque et ses maillots bordeaux (signés Stephen Galloway). Sauts de chats, pirouettes, rotirons et autres arabesques nous rappellent que Petipa n’est pas si loin, et les décalés étirés font signe vers George Balanchine ; mais, leur rythme affolant et leurs arrêts brutaux sont du pur Forsythe. Les interprètes du Ballet de l’Opéra de Nice se tirent bien de cette chorégraphie semée d’embûches, mais sans doute aurait-il fallu une plus longue pratique de cette gestuelle si ardue pour qu’ils puissent briller de tous leurs feux.
Ce qui est le cas des deux danseurs Thomas Rousse et Romain Sirvent, des Indomptés de Claude Brumachon. Ce duo, petit bijou chorégraphique de huit minutes créé en 1992 pour le JBF (Jeune Ballet de France) n’a jamais cessé d’être repris depuis, notamment par des plus grands ballets et les plus grands danseurs français et internationaux. Animale, avec ses étirements félins et ses arrêts nets, dignes de mustangs sauvages ; végétale par ses enchevêtrements organiques de bras-racines, et ses ramures qui s’entrecroisent, mais profondément humaine par sa gestuelle. Tout en tendresse jusqu’à l’exaspération des sens, avec son désir violent, et ses corps en perdition frôlant l’extase, s’exténuant l’un l’autre, cette chorégraphie résume magnifiquement tout le style Brumachon. Amants, amis, complices, rivaux… les portés fusionnels ou aériens, alternent avec des cambrés d’une volupté insensée. La densité de cette relation duelle et sensuelle, l’énergie palpable, la douceur infinie du geste font de cette pièce un duo incontournable du répertoire de la danse contemporaine. La musique de Wim Mertens, extrait de son album, La Stratégie de la rupture, ajoute à l’expressivité physique et psychique de ce duo duel.
Trois Gnossiennes d’Hans Van Manen (1982), reprend ce même thème du duo – ou dans ce cas, Pas de deux – mais entre un homme et une femme, thème qui a d’ailleurs sous-tendu toute l’œuvre de ce chorégraphe dont le dépouillement stylistique magnifie la danse. Sorte de chaînon manquant entre Balanchine et Forsythe, son instrument de prédilection reste le piano – ici celui d’Eric Satie joué subtilement par Roberto Galfione – qu’il sait utiliser dans toutes ses dimensions lyriques et percussives avec un sens du rythme infaillible. Sa fascination pour le duo lui autorise toutes sortes de figures audacieuses, à la pointe du déséquilibre qui associe le contrepoids au contrepoint et déploie une gestuelle athlétique, ou mystérieuse, parfaitement soutenue par Veronica Colombo et Luis Valle.

Enfin Cacti (2010) est une pièce étrange d’un « dingue de rythme » tel que se définit lui-même le chorégraphe suédois Alexander Ekman. Tout en contrastes, sa chorégraphie s’amuse des échelles de grandeurs, des registres esthétiques, et des incongruités. Comme ces cactus (singulier de Cacti) qui s’appuie sur une version en lambeaux de La Jeune fille et la Mort de Franz Schubert. D’acrobaties dignes de l’Opéra de Pékin aux pulsations martelées des frappes des pieds et des mains des seize interprètes, enveloppés d’une scénographie très travaillée et de lumières très soignées, cette œuvre dynamique et inventive se moque du « grand art » et fournit une déconstruction humoristique du mouvement qui se produit sur scène. Sur des plates-formes individuelles surélevées danseurs et danseusess portent des bonnets de bain noirs, des justaucorps couleur chair et des shorts amples. Toute forme d'individualité est effacée tout au long de cet entraînement cardio explosif, chacun sur son propre socle. Au bout d’un moment, un danseur et une danseuse apparaissent comme en répétition épuisés, ils se demandent s'ils ont terminé, « Est-ce qu'il reste quelque chose ? ». « la partie avec les cactus », dit la femme.
Alors tout recommence en redoublant d’énergie pour construire des ensembles époustouflants, drôles et fascinants. Et les Cacti me direz-vous ? Eh bien, eux aussi sont sur le plateau juchés sur les mêmes pratiquables que les interprètes, présence piquante et parfois poilue, souvent phallique mais sûrement empotés, tandis que le Quatuor à cordes de l’Opéra de Nice interprète brillamment un mélange de partitions qui outre Schubert, déjà cité, font entendre des extraits de Haydn, Beethoven et même Mahler. Lors de cette démonstration dynamique, on entend la voix d’un critique méditant la tournure que va prendre son prochain compte-rendu… et nous aussi peut-être !
Agnès Izrine
Le 2 avril 2025 à l’Opéra de Nice
Catégories:
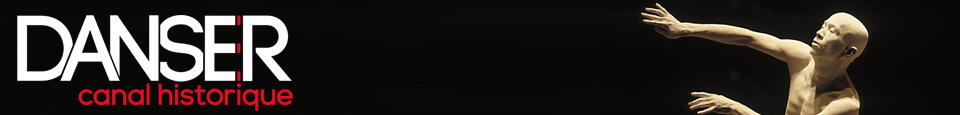
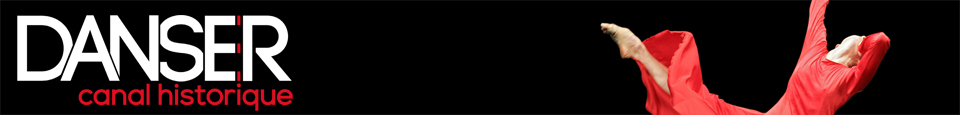








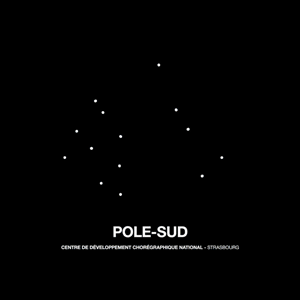









Add new comment