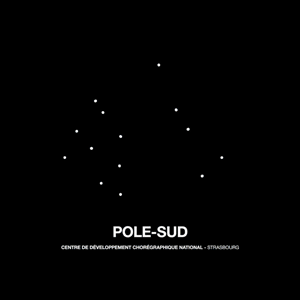« Les Serrenhos du Caldeirão » de Vera Mantero et « Pour » de Daina Ashbee
Vera Mantero et Daina Ashbee aux Rencontres de Seine Saint-Denis.
Insolite parcours sinueux pour le retour de la chorégraphe et performeuse portugaise. Suffocante plongée dans l'intériorité, pour la découverte d'un nouveau visage féminin québécois.
 Mais où était passée Vera Mantero ? Dans le milieu des années 90, cette chorégraphe et performeuse portugaise comptait parmi les têtes de file d'un nouveau mouvement de danse-performance, tout en audaces conceptuelles, venu de Lisbonne, plein d'échos avec ce qui se passait au même moment dans l'Hexagone. Ses solos notamment, furent alors reçus comme fondateurs (Olympia ; Peut-être qu'elle pourrait danser d'abord et réfléchir après ; ou encore Une mystérieuse chose a dit E.E.Cummings).
Mais où était passée Vera Mantero ? Dans le milieu des années 90, cette chorégraphe et performeuse portugaise comptait parmi les têtes de file d'un nouveau mouvement de danse-performance, tout en audaces conceptuelles, venu de Lisbonne, plein d'échos avec ce qui se passait au même moment dans l'Hexagone. Ses solos notamment, furent alors reçus comme fondateurs (Olympia ; Peut-être qu'elle pourrait danser d'abord et réfléchir après ; ou encore Une mystérieuse chose a dit E.E.Cummings).
Puis Vera Mantero sembla disparaître des scènes, du moins de la danse, en France. On entendit dire qu'elle avait bifurqué vers la chanson. Et c'est d'abord en chantant qu'elle nous est apparue au tout début de Les Serrenhos du Caldeirão, exercices en anthropologie fictionnelle, un tout nouveau solo, qui sonnait comme un come-back, offert aux spectateurs de l'édition 2017 des Rencontres chorégraphiques de Seine Saint-Denis.
Ce chant initial, aride, frêle et puissant à la fois, ouvre d'emblée un horizon de transport, que cette pièce ne va pas cesser de dégager ensuite. On y verrait des données toutes documentaires ; et pour autant, de pures échappées imaginaires, comme l'indique bien le second segment du titre qu'on vient de lire à l'instant. Il y a quelque chose d'un cheminement sinueux dans cette pièce. Et cela inspire de réfléchir à l'épaisseur d'un parcours d'artiste dans l'étoilement de ses diversités, non plus comme une simple suite de projets de production de spectacles, plus ou moins couronnés de succès d'exploitation.
Vera Mantero est devenue bien d'autres choses que chanteuse. Notamment, nous la voici rendue en anthropologue en herbe. Un centre d'art l'a invitée à s'inspirer de son ressenti en visitant la Serra du Caldeirão, au sud du Portugal. Une région en voie de désertification humaine. D'où le premier sentiment, d'un immense et absolu silence, que confesse la performeuse, et qu'elle transperce par la contradiction de son chant. La documentation peut commencer : sur écran sont diffusés des extraits de collecte filmée de chants des habitants de cette région, du temps où leur culture ne s'était pas encore totalement éteinte.
Galerie photo © Luis Da Cruz
Depuis plusieurs années, Vera Mantero se laisse impressionner par les puissances d'évocation sensuelle du Brésil, qu'elle a découvert. Ou bien elle pratique – en tant que projets artistiques – des insertions de pratiques agricoles alternatives écologiques dans le tissu urbain de Lisbonne. La démarche artistique ne se résume plus à montrer un produit spectaculaire bien emballé sur un plateau. Il se nourrit de, et en retour il irrigue, des actions engagées, et partagées, d'invention du monde.
Mais la science du monde entre aussi en flottement, de son côté. Les Serrenhos du Caldeirão participe de l'invention des conférences performées, et dérivations poétisées de la connaissance savante. Entre images documentaires et emprunts livresques, l'artiste s'interroge sur la perte qui s'est produite à travers l'extinction de la civilisation paysanne de la Serra du Caldeirão. En pleine Europe, voici quelques décennies à peine, un mode de vie ancré au plus profond des logiques terriennes paraissait apte à inspirer un lien au monde tissé dans une vastitude d'élévation spirituelle, derrière les apparences premières extrêmement rustiques.
 L'artiste fait ressentir la profonde sympathie que lui inspire cette découverte, au point de s'autoriser à déborder en citations apocryphes, détournements d'objets d'études savantes, spéculations interprétatives hasardeuses, l'air de rien, avec malice et en passant. Cela serait à ranger au rayon des déconstructions post-modernes obligées, si n'y venait gagner, souterrainement, un grand trait de tout l'art de Vera Mantero. A savoir : l'idée que l'état de performance relève d'une capacité à se laisser traverser avant toute chose, quand le geste artistique ne vient qu'insinuer une modulation à travers les puissances du monde, au lieu de prétendre rajouter un haut fait magistral et surplombant pour asséner un point de vue sur ce monde.
L'artiste fait ressentir la profonde sympathie que lui inspire cette découverte, au point de s'autoriser à déborder en citations apocryphes, détournements d'objets d'études savantes, spéculations interprétatives hasardeuses, l'air de rien, avec malice et en passant. Cela serait à ranger au rayon des déconstructions post-modernes obligées, si n'y venait gagner, souterrainement, un grand trait de tout l'art de Vera Mantero. A savoir : l'idée que l'état de performance relève d'une capacité à se laisser traverser avant toute chose, quand le geste artistique ne vient qu'insinuer une modulation à travers les puissances du monde, au lieu de prétendre rajouter un haut fait magistral et surplombant pour asséner un point de vue sur ce monde.
A ce jeu, Vera Mantero se saisit d'une grande écorce arrachée au tronc d'un chêne-liège, à la façon des pratiques ancestrales de récolte de la matière première des industries du bouchon. Cet élément végétal est massif, rugueux, sombre, d'une taille pas si éloignée de celle de l'artiste. Elle s'en tiendra à le déplacer dans diverses positions successives, brièvement exposées, au contact de son corps. Mais tout autant de son discours.
Un immense poème corporel se met à s'écouler, où le moindre déplacement dans la position de cet objet – et en lien avec cet objet – suggère d'énoncer une suite sans fin de métaphores visuelles. Chacune s'annonce au plus simple, factuellement, à la manière de, par exemple : "une femme debout, qui se cache derrière l'arbre qu'elle tient dans ses bras". Ce seul principe d'énonciation, très sobre, est un embrayeur imaginaire, où le langage invite à voir s'émanciper un tourbillon de métaphorisation poétique, inépuisable, quand le premier coup d'oeil ne voyait qu'un lien simple à un morceau chipé à la nature.
Voilà qui soulève les idées reçues du monde, et de la femme – elle aussi déclinée à l'infini dans ce jeu – et de la place de l'artiste. Mais rien de grave à tout cela, quand cette artiste conclut dans la totale fantaisie d'engager tout le public à chanter avec elle ; et quand finalement, en proie à tant de vibrations connectées, elle s'autorise un bref retour final aux mouvements sorciers de la danseuse incandescente qu'elle a été, avant de devenir tant d'autres choses.
Il est toujours très difficile de choisir quels spectacles relater, dans les programmations imaginées par Anita Mathieu, tant celles-ci abondent de propositions d'artistes très rarement vus en France, voire totalement inconnus, qui presque tous excitent la curiosité. On pourrait parler de l'artiste croate Jasna L.Vinovrski avec son solo Public in Private, quasi théâtral. Partant d'un thème de commande – traiter des "corps migrants" – elle se décale dans une digression surréaliste, fortement teintée d'humour pince-sans-rire, de composition d'un personnage nourri d'emprunts au livre fabriqué sur papier, migrant vers la tablette numérique. C'est d'un niveau excellent, voire un peu trop tiré à quatre épingles pour toucher à l'essentiel.

Au cours de la même soirée au Colombier de Bagnolet, on découvrait la performeuse indienne Mallika Taneja. Politiquement parlant, sa prise de risque est absolue, se présentant intégralement nue, très près des spectateurs, longuement figée dans un défi de regard adressé à la salle. Après quoi, elle procède à un strip tease inversé, pour lequel elle recouvre son corps d'une multitude insensée de tissus, jusqu'à paraître totalement voilée mais tout autant grotesque et difforme sous l'ajout des bouts de vêtements. Ainsi une femme indienne doit disparaître, jusqu'à l'informe et l'enlaidissement, si elle veut pouvoir se déplacer dans l'espace public. Tel est le message de Thoda Dhyaan Se (Be Careful), bref solo percutant, au message limpide. Il fut vivement applaudi, ce qui est bien normal, mais laisse le goût d'un triomphe volant au secours d'un consensus des bons sentiments, incarné par le public dans la salle.
Beaucoup plus troublant, embarrassant, est apparu le solo Pour, de la Québécoise Daina Ashbee. Nue pour la majeure part d'une picèe d'une heure, corps luisant comme huilé, une très jeune danseuse, au corps idéal d'adolescente déjà magnifiquement galbée, arpente le plateau dans toutes ses dimensions. Elle-même dans toutes les positions. Elle se constitue en sculpture énigmatique d'elle-même. Et cela la tire souvent près de l'exténuation du souffle, du déchirement catalleptique, de la gravité en tension extrême. Elle est totalement ce corps, dans un expressionnisme de l'attente suspendue, aux arêtes vertigineuses, qui n'est pas sans faire penser au butô. Il y a quelque chose de l'écartèlement humain dans un solo où, de manière finalement si rare, on a la sensation que le corps délivre quelque chose – de probablement terrible – qui jamais ne parviendra à se dire par les mots.

On est saisi par ce risque de décomposition de soi, lorsqu'on se rend compte, étrangement, que ce solo a une auteure, qui en fait n'est pas la danseuse (Paige Culley), mais une autre femme, Daina Ashbee, qui vient saluer. Au moment d'échanger, verre à la main, on vérifie que cette chorégraphe québécoise est surtout une descendante amérindienne, et que la douleur qu'elle a à transmettre peut avoir un lien avec le sort réservé à sa communauté, mais encore celui réservé aux femmes au sein de cette communauté.
Et le trouble redouble, à se dire que ce qu'on avait pris pour l'expression en nom propre de la danseuse évoluant sur le plateau, était en fait une interprétation du propos de l'auteure, autre. On est alors excité par les perspectives inépuisables qu'ouvre l'interprétation en danse, quand celle-ci multiplie et complexifie un questionnement identitaire, alors que tout serait tellement plus simple, confortable, à l'entendre comme purement individuel.
Gérard Mayen
Spectacles vus les mercredi 17 mai 2017 au CND, Pantin (Vera Mantero), et le vendredi 19 mai au Colombier, Bagnolet (Jasna L. Vinovrski, Mallika Taneja, Daina Ashbee), dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine Saint-Denis.
Catégories: