« Unrelated » de Daina Ashbee
Il est particulièrement rare de pouvoir comparer les étapes de l'évolution d'un chorégraphe. L'enchaînement production/création/diffusion, le goût des programmateurs pour le tout dernier opus (au risque que cela soit vraiment le dernier), tout concourt à ce que l'ensemble de l'œuvre d'un chorégraphe se résume à sa pièce la plus récente. En proposant cinq pièces de Daina Ashbee, le festival Montpellier Danse permet de façon tout-à-fait inédite de découvrir les lignes de force et la cohérence interne de la démarche créative d'une artiste dont l'univers se révèle particulièrement singulier.
On se souvenait de Serpentine, vu précédemment ( lire notre critique) et qui ouvrait à Montpellier Danse cette quasi rétrospective. Déjà cette proposition radicale faisait sens. Une interprète, rampant rythmiquement le long d'un parcours aussi droit que la gestuelle ondulait (d'où le titre) forçait par son obstination rigoureuse à accepter comme inéluctable ce corps qui s'imposait. Une affirmation de la place des femmes, dans toute leur chair, cheveux, peau, tatouage, humeur, et humidité, dans tout ce qui peut choquer les morales et les bonnes intentions et fait pourtant la femme, qui poussait à repenser ce qu'était une revendication féministe. Le corps non comme destin à assumer ou comme construction sociale à faire ou défaire, mais comme donnée phénoménologique qu'il convient d'assumer et de faire assumer. Par tous, partout. Vaste projet. Mais cette création de 2017, venait après les deux grandes pièces présentées à Montpellier et dont elle ne constitue qu'une manière de mémento, de résumé d'intention. Unrelated et Pour se sont avérées d'une facture encore plus radicale.

Avec ce premier numéro d'opus officiel, Daina Ashbee fixe un style, à la fois dans le traitement formel et par la thématique.
Dès l'entrée, quelque chose de glaçant : tapis de danse blanc butant sur un mur blanc au fond. Pas de décors sinon deux portants auxquels sont suspendus des vêtements. A jardin, tandis que le public s'installe, gît une femme (Areli Moran), face contre terre, nue. Ses cheveux dissimulent tout ce que l'on pourrait voir de son visage. Elle se cabre doucement mais toujours au sol, se tourne, revient à sa position de départ. Elle n'abandonne jamais cette qualité de mouvement à la fois retenue et douloureuse qui va persister tout au long de la pièce. Pas vraiment lent puisque susceptible d'une certaine rudesse et d'accélération – quand les corps se heurtent au mur ; quand les coups de tête font voler les cheveux – mais comme si un poids pesait toujours, pas sur les corps qui restent déliés mais sur les esprits…

Pour le moment, elle est venue au centre à quatre pattes, traversée d'une légère onde de mouvement, et il y a quelque chose de profondément sexuel et pourtant d'anti-érotique dans cette posture d'un corps anonyme puisque jamais le visage n'apparaît, caché qu'il est des longs cheveux noirs. Les sons, légers bruits de ventouses des chairs sur le sol, respiration hachée, renforcent l'atmosphère charnelle qui contraste avec la réification de la danseuse au corps mécanique, animale et glacée à la fois. La danseuse se relève, remonte et se heurte –voire se colle– au mur avec ce que cela signifie de violence renforcée –toujours– de connotation sexuelle puisque ventre et fesses sont vivement sollicités dans ces chocs répétés, désespérés, violents qui laissent le corps effondré.
Galerie photo © Laurent Philippe
Et entre, depuis le front de scène, une seconde interprète (Irene Martinez) laquelle illico se déshabille et nue fait face. Elle s'entortille de quelques vêtements, les laisse tomber, essaie une fourrure comme si plus aucune identité vestimentaire ne pouvait convenir à ce corps dévasté par un séisme inexpliqué. Les deux femmes vont affronter le public, dans un jeu de fixation yeux dans les yeux d'autant plus troublant que ces corps nus sont à portée de main, s'étant aventurées jusqu'aux escaliers des gradins. Mais là encore, aucun apaisement. Les danseuses remontent, s'éloignent, se collent au mur, s'en désespèrent, dans ce trouble mélange d'émotions qui les traversent. Les pauvres culottes en sont martyrisées dans une lutte acharnée pour les enlever de rage tout en les gardant. Sorte de tunique de Nessus au rayon lingerie… Et dans cette étrange qualité de mouvement comme étale qui préside depuis le début et qui va durer jusqu'au terme, dans le noir qui absorbe ces corps réunis par une gestuelle parallèle autant qu'apparemment sans espoir.

A sa création la pièce impose le questionnement sur la place des femmes dans la société canadienne, et singulièrement des femmes autochtones d'autant que la chorégraphe, par son père, est proche de ces communautés. Mais la force de l'interprétation pousse le message au-delà et une petite polémique récente en témoigne. Il faut toujours faire confiance à la petite sottise pour nous révéler le monde… Ainsi, apprenant que pour sa présence à Montpellier la chorégraphe avait fait appel à des danseuses mexicaines, quelques figures canadiennes du milieu de la danse se sont émues et reprochèrent la « douleur » ainsi produite aux artistes (danseuses) locales. Montrant par là qu'elles se fichaient que les populations précolombiennes –donc les ancêtres des mexicaines – aient connu exactement le même sentiment de dépossession de leur corps… Faire danser cette œuvre par des mexicaines c'est réaffirmer l'universalité de ce sentiment d'impasse charnelle (et négliger qu'il y a eu des précolombiens donc des populations proches de celles d'Amérique centrale jusqu'au Missouri – cf. Cahokia- , qui n'est pas si loin du Canada). Involontairement, car le recours à ces interprètes mexicaines a été un peu contraint par la réalité sanitaire, Daina Ashbee souligne la complexité de ce qu'est une a-culturation corporelle. On comprend que cela puisse gratter un peu. Mais Daina Ashbee n'a cure de déranger, la preuve avec Pour. (à lire dans notre prochain article)
Philippe Verrièle
Vu au festival Montpellier Danse le 28 juin 2021
Catégories:












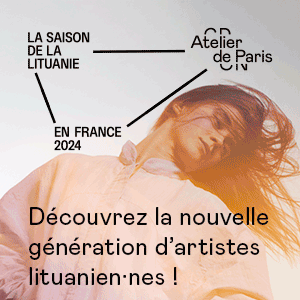







Add new comment