Trois créations marseillaises
Emio Greco (avec Pieter C. Scholten) pour le Ballet national, Mathilde Monfreux et Marc Vincent, artistes vivant et travaillant dans la Cité phocéenne, créaient tous trois à l'invitation du festival Dansem de nouvelles pièces le week-end dernier.
A l'instar de l'eau sur le plumage d'un volatile aquatique, les marques du temps, des modes et des tendances, coulent sur le talent chorégraphique de Marc Vincent sans l'affecter en rien. Son art brille, insubmersible et inoxydable, dans la pièce Impact ! créée le week-end dernier à Marseille, dans le cadre du festival Dansem. A ce détachement, on peut trouver la force d'un engagement inaltérable dans une cohérence de recherche d'écriture ; ou bien la prétention d'une quête d'absolu, plutôt datée en termes de philosophie de la danse, teintée d'un rien d'indifférence. C'est selon.
Une grande forme étoilée géométrique est inscrite en blanc sur le fond noir du tapis de danse. Dans une profonde pénombre, les cinq interprètes danseur.se.s patientent, à l'extrême bord de la cage de scène. Le travail du son, par Floy Krouchi, confère une vaste proportion, pleine de hauteur, à la subtile puissance vibratoire qu'on pressent dans ce lieu.
 C'est par l'arpentage du pourtour, la lisière, abordée de flanc, que les danseur.se.s viendront tour à tour s'amalgammer ou se défaire, en entrant ou sortant de l'aire de jeu compositionnel délimitée au sol. En pointillé, des trajectoires linéaires induisent un entremêlement savant de formes géométriques, qui semblent teinter les variations d'intensité gestuelle, selon l'emplacement où les interprètes évoluent.
C'est par l'arpentage du pourtour, la lisière, abordée de flanc, que les danseur.se.s viendront tour à tour s'amalgammer ou se défaire, en entrant ou sortant de l'aire de jeu compositionnel délimitée au sol. En pointillé, des trajectoires linéaires induisent un entremêlement savant de formes géométriques, qui semblent teinter les variations d'intensité gestuelle, selon l'emplacement où les interprètes évoluent.
Leurs appuis y sont très marqués, avec une acuité de stylet, mais sans jamais s'apesantir. Il ne s'agit pas d'occuper un espace ; mais de le parler. Au-dessus de ces pas vifs, les ceintures pelviennes semblent gommées. L'élan de corps électrise directement les contro-versions latérales des ceintures scapulaires. De la sorte, d'incessantes variations directionnelles sont transportées en incises suspensives, tandis que les membres supérieurs entretiennent une tranquillité de traits dessinés en toute clarté. Il y a du translucide, de l'aérien, du cristallin, dans ce ballet de transferts et de transactions, qui fait songer un instant aux mânes d'une Trisha Brown. L'oeil y virevolte.
Depuis quelques années – et encore pour cette édition – le festival Dansem accompagne le chorégraphe Radouan Mriziga. Lui aussi compose en investissant au sol de complexes architectures tirées des traditions de l'algèbre arabe de haute volée. On rappelant cela, on ne le compare en rien avec Marc Vincent. Simplement, on remarque ce que le geste de ce jeune homme d'aujourd'hui, branché sur les intensités de son époque, conserve d'âpreté, qui touche, outre ses doctes spéculations.
Sur un versant tout opposé, la soirée du festival Dansem avait débuté en malaxant la pâte humaine compacte qu'engage Mathilde Monfreux dans Ackerisme 4 – Effets du réel et de l'imaginaire. Si le titre ne manque pas d'ambition, il faut garder en tête que la réalisation tient d'une mise en situation d'expérimentation partagée en grand groupe – vingt danseurs professionnels, ou en formation, ou amateurs, mêlés – sur un temps resserré d'une semaine tout juste.

On y retrouve le don du geste directement éprouvé, sans rien d'expert ou d'apprêté, dans la grande parabole pulsatile d'un corps politique en mouvement. Il y a du magma secoué, accentué, scissipare, ici disséminé, là compacté, dans un flot d'agencements, ici ordonnés, là chahutés, de corps qui ne craignent pas le tassé, l'affaissé, et encore moins le contact.
Le batteur François Rossi fait des miracles pour tendre la résille d'une trame respiratoire en soutien de cette fouille. Quant à l'Ackerisme il renvoie à l'engagement de la chorégraphe dans la lecture de Katy Acker. A sa compagnie, elle a donné le nom des Corps parlants. A haute voix, ses interprètes se confrontent à cette écriture littéraire. On ne doute pas qu'ils y trouvent une part du sens qui porte leur geste. Mais à notre oreille de spectateur, cette accroche aura plutôt dispensé une vague perplexité. Est-il si sûr que tout ce qui se lit puisse se regarder pertinemment dans le geste.
En termes d'esthétique contemporaine de la scène, on pensait acquis un principe de séparation. Il y a, d'un côté, ce qu'une pièce entend raconter. Mais dans le temps de son action effective, il y a, différemment, ce qu'une pièce est en train de produire. Là se loge toute la pensée de la performativité. On l'a senti très fortement, en observant Apparition, la nouvelle pièce du chorégraphe Emio Greco cosignée avec le scénographe Pieter C Scholten, pour le Ballet national de Marseille, qu'ils dirigent.

On énoncera d'abord un principe de précaution critique : Apparition n'est qu'un volet, dans un projet plus vaste, appelé à se développer dans le temps. Pour l'heure, on y entend les Kindertotenlieder de Gustav Malher, mais dans une réduction pour un seul piano, tandis que le chant habituellement adulte soliste soprano est reversé à un choeur d'enfants (la Maîtrise des Bouches-du-Rhône). Il y a donc une révolution copernicienne dans la dramaturgie de cette pièce. Elle consiste à investir directement la fragilité de l'expression enfantine, quand le chant des poèmes de Freidrich Rückert veut faire entendre sa douleur de père, à la perte de deux de ses enfants.
Dans la pièce marseillaise, le piano est placé au centre du plateau – non sans encombrer une bonne part des évolutions du choeur comme du ballet – sous une lumière crue nécessaire à la lecture de la partition, transperçant douloureusement la pénombre rasante et dorée de l'éclairage très économe porté sur le reste du plateau. A un moment du développement de l'action, un danseur soliste vient évoluer devant l'instrumentiste, qui s'est alors levé en quittant son clavier. Celui-ci fait d'abord mine de répercuter, de ses propres gestes, le mouvement dansant. Mais vite il renonce, s'engonce dans son immobilité, tandis que le danseur s'embrase.

Si on se renseigne après coup sur l'intention dramaturgie, on apprend que le pianiste incarne ici la figure du père. Centrale. Et que bien évidemment, son incapacité à entrer dans la danse dit son état de pétrification mortifère, laissant aux seuls danseurs le soin d'incarner l'envol des âmes survivantes. Soit. C'est donc ce que raconte la pièce. Mais il y a ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, dans son action sur scène.
Or on aura perçu la scène du musicien paralysé comme le signe de ce qui ne fonctionne pas dans cette pièce. Passons sur le niveau de l'interprétation chantée, somme toute cohérent avec l'idée d'une fragilité enfantine – et acceptons la déceptivité de ne pas entendre ce qu'on a d'emgrammé dans l'oreille, des Kindertotenlieder. De la part de ces jeunes enfants – malencontreusement emballés dans tes tuniques jaunes rappelant la communion solennelle, mais encapuchonnées, qui fait djeune – on admet très bien aussi que ce ne sont pas des danseurs. Il faut supporter la lenteur empesée des déplacements d'un choeur de bonne volonté.

Mais c'est l'articulation qui fait problème – un peu à l'image de la lumière du pianiste qui casse tout dans le tableau. Longtemps réduit, pour l'essentiel, à des déambulations, le déploiment chorégraphique s'encastre, comme il peut, ou plutôt s'empile, dans l'interprétation musicale et chantée, plutôt monocorde, hésitante. Et tout est écrasé par le recours maniéré à un tulle de front de scène, sur lequel sont projetées d'immenses images emphatiques, d'une "modernité" datée, qui finissent par noyer le tout.
La scène du père empêché, du musicien engourdi, semble signer le constat de cette inefficacité. Evacuation des enfants, dégagement du plateau. Et place à la danse. Mais là se révèle peut-être le plus inquiétant. Les danseurs du Ballet national de Marseille dupliquent la grande danse lyrique et calcinée, qui était celle, bouleversante, d'Emio Greco, voici deux décennies. A ceci près qu'ils ne sont pas Emio Greco, et que tout crie leur statut d'exécutant – fût-ce de bon niveau – quand ils piaffent du pied, creusent l'arc extrême de leurs cambrures, font crisser les cervicales en hoquets, et jettent leurs bras au ciel en exclamations arrière.

Pas un instant on ne capte ce que cette caricature de style peut vouloir signifier au regard de l'océanique profondeur romantique de l'oeuvre de Gustav Malher. On est pourtant disposé à toutes les hybridités. Encore faut-il qu'elles nous déplacent. Non qu'elles se plaquent.
Gérard Mayen
Spectacles vus à La Friche de la Belle de mai le samedi 2 décembre dans le cadre du festival Dansem et à l' Opéra de Marseille (BNM) le dimanche 3 décembre 2017
Catégories:






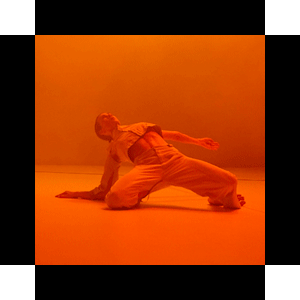





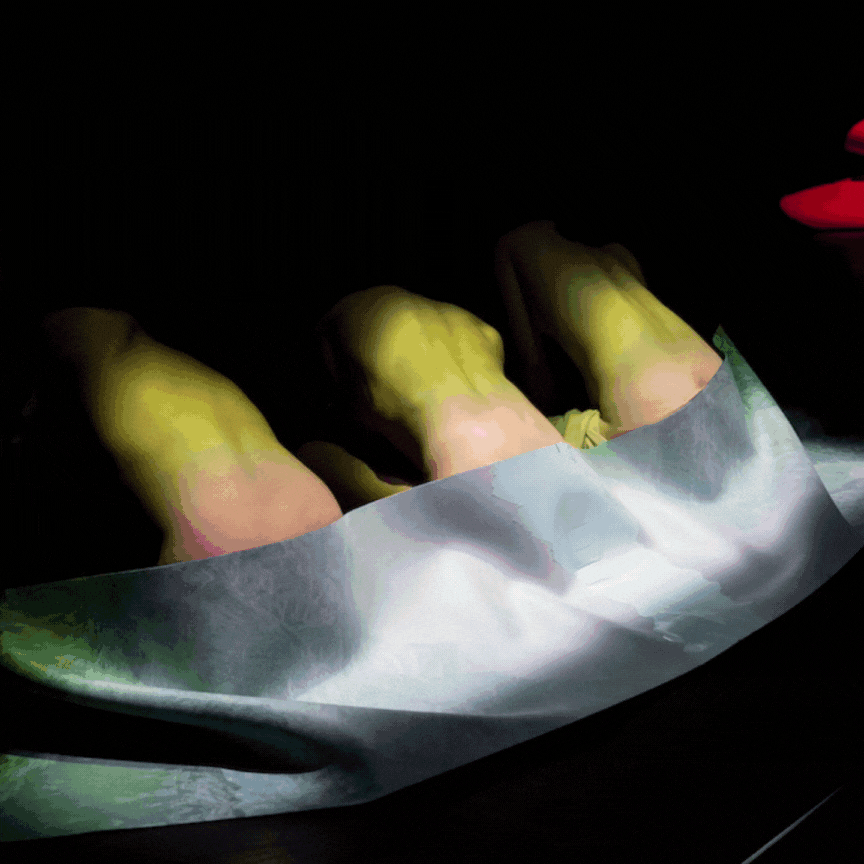






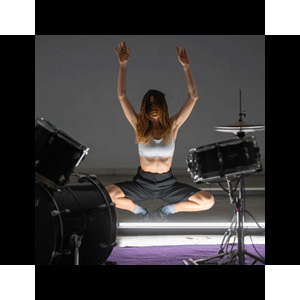

Add new comment