« Saison sèche » de Phia Ménard
Sept danseuses passent à l'assaut des assignations de genre. Elles frappent fort, mais la simplification du propos, comme la surenchère de déploiement scénographique, amoindrissent leur impact.
Un tweet élogieux du service culture de Libération, à propos de Saison séche, de Phia Ménard, déclenche une offensive nauséeuse de la fachosphère. Il faut aller lire ça, pour vérifier à quel point la question du genre, que travaille cette chorégraphe, a de quoi affoler les tenants d'un ordre établi ; et à quel point cela est directement politique. Voilà ces cercles précipités dans des logiques – et en tout cas des lexiques – dont l'Histoire, l'histoire du nazisme particulièrement, a déjà dit clairement le sens ("art dégénéré", et autres notions du même acabit).
A cet égard, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles : ce sont des standing ovations enthousiastes qui ont salué la création de cette pièce au cours du dernier festival d'Avignon, dans la salle de Vedène où l'on n'a pas l'impression que le public soit exclusivement constitué d'activistes queer et théoriciennes postféministes. Quelque chose touche juste, dans l'art, ou en tout cas le propos, de l'ancien artiste circassien devenue chorégraphe.
Galerie photo © Laurent Philippe
Notre position s'en trouve compliquée d'autant. Car nous restons loin, d'un point de vue esthétique, de partager cet enthousiasme. Dans ses propos accompagnant son projet, Phia Ménard dit en quoi « l'enjeu le plus difficile, c'est de faire que […] le spectateur, homme ou femme, puisse être touché. Comment se projette-t-on dans l'autre, si l'autre est la différence. Peut-on se projeter dans un autre corps, un autre genre que le sien ? Et quelles sont les formes pour arriver à cette projection ? Ce sont des questionnements essentiels à l'oeuvre ».
Un premier tiers de Saison séche résonne pleinement avec ces questionnements. La question queer est bien celle de l'acceptation d'une perte de la fixité des repères. Celle du trouble dans le genre. Celle, plutôt joyeuse et inventive, de la fluidité librement consentie dans l'interprération transgressive des rôles culturellement sexués, tels qu'imposés dans une société de contrôle et de domination.
Dans toute cette première phase de Saison sèche, les sept interprètes féminines divagient en-dehors de toute fixité (mais notons qu'elles garderont toujours un formidable niveau d'implication individuelle et collective ; c'est à saluer, c'est l'une des forces de cette pièce). Ni même leur station debout ne relève de l'évidence. Qu'une ronde se forme, et une houle la vient faire tanguer. Leur tenue vestimentaire intrigue, qui les habille sans les "protéger" de la nudité.
Galerie photo © Laurent Philippe
Elle font également un recours intensif à des peintures colorées, pour se profiler en tribu préparant le rituel. Mais le maquillage est à ce point sommaire, débordant de toutes parts, qu'il en vient à brouiller toutes les prétendues évidences des signes sexués normatifs. Sous les applats, les coulures, les dégoulis, une bouche, une paire de seins, une toison pubienne virent dans une dés-indexation, une déterritorialisation, une désarticulation du code culturellement élaboré et du signe bio-organique qu'il est censé nomenclaturer. Saison sèche fraye alors pleinement en indiscipline.
Cela ne durera pas. Un second grand tiers – incroyablement long sans justification – consiste en une sorte de Village People, où les membres de ce gang féminin, à grands coups de pastiche, de postiches et mimiques, s'affublent de looks masculins de chasseur, curé, policier, pompier, footballeur, etc. Comment dire à quel point cela ne dépasse pas le stade, finalement dualiste, ré-assignatoire, des vieilles ficelles du transformisme, en ses croquis grotesques, martelés à l'envi, comme de l'image, rien que de l'image, qui ne permet pas de passer derrière la grossière évidence du leurre. On est là dans un folklore édifiant ; non dans la complexité étourdissante du genre.
Enfin, le troisième grand tiers consiste en l'effondrement, interminable et ronflant, de l'ensemble du cadre scénique, à la façon d'un carton pâte cédant sous le déversement de tonnes d'eau. Cette démesure des moyens était déjà le propre de Belle d'hier, puis des Os noirs, précédentes pièces de Phia Ménard. On discerne bien ce que l'ex-circassienne cultive alors, pour établir un lien entre la matière des corps – capables de toutes les métamorphoses, changement de sexe compris – et plus largement la matière du monde, en proie à tous les soulèvements.
Galerie photo © Laurent Philippe
Fort bien. Mais lorsque l'artiste combinait cela en nom propre, à l'échelle de sa propre personne, elle entrouvrait les perpectives passionnantes de devenirs critiques au coeur de sa performance d'être. Quand elle s'acharne à vouloir y donner des envergures hollywoodiennes, nous y trouvons une boursouflure surexposée, qui au mieux épate, sinon indiffère, et fait écran spectaculaire à l'implication projective du spectateur, qu'elle annonce pourtant être son objectif.
Revenons au tout début. Phia Ménard dévalle patiemment du haut de la salle jusqu'au pied de plateau. Là elle affiche son meilleur sourire narquois. Pour décocher : « Je te claque la chatte ! ». C'est cinglant, intrépide, insolent. Ca dit tout des pouvoirs contradictoires de la représentation, entre provocations joyeuses et agressions subies. Juste après ce prologue, la pièce débute dans la pénombre. On discerne les septs danseuses couchées dos contre le sol, jambes pliées et offertes en écart. Juste une posture, une esquisse, un seul acte collectif ; on y vibre dans l'interpellation de l'origine du monde. Comme on préfèrerait que ce ne soit pas pour finir en pataugeant !
Gérard Mayen
Spectacle vu le 23 juillet 2018 à l'Autre scène (Vedène), 72e édition du Festival d'Avignon.
Catégories:







































































































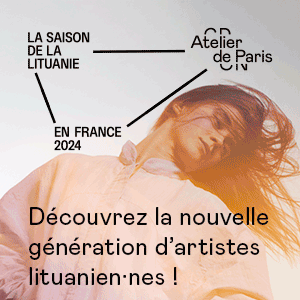







Add new comment