« Politiques du musical hollywoodien » sous la direction d’Aurélie Ledoux et Pierre-Olivier Toulza
Les Presses universitaires de Nanterre publient un volume consacré à la comédie musicale hollywoodienne prise, si l’on en croit les auteurs, sous l’angle de ses enjeux politiques.
Il semblerait que l’ouvrage fasse suite à un « atelier » sur ce même thème qui eut lieu à Paris en décembre 2016 ainsi qu’à un colloque sur un sujet voisin, qui se tint dans la capitale fin 2017. Le pluriel au mot politique élargit le champ des façons d’aborder la question, les diverses stratégies ou modalités de traiter d’un genre lui-même « protéiforme », pour ne plus dire « hybride » ou « rhizomique », comme il n’y a guère.

L’introduction d’Aurélie Ledoux et Pierre-Olivier Toulza résume parfaitement les réflexions d’universitaires européens et américains (de Californie du sud, surtout) autour de trois axes principaux : la relation de la comédie musicale avec la censure (et l’autocensure) apparue en même temps que le parlant (le Pré-Code puis la Production Code Administration ou PCA, plus connu sous l’appellation Code Hays) ; les « normes de représentation, en particulier raciales », liées aux traditions musicales et chorégraphiques du cinéma dominant ; les présupposés idéologiques d’une forme d’expression spécifique à la « culture de masse »
Si, pour une fois, la recherche échappe au monopole de Paris-VIII pour ce qui ressort de la danse (ne serait-ce que par la contribution du théoricien suisse exerçant à Lille, Laurent Guido), il n’est pas indifférent qu’elle ait obtenu le soutien financier de l’« action structurante de recherche PluriGenre/Université Paris Diderot » (et, naturellement, celui de Paris Nanterre). Toujours est-il que l’ouvrage rend compte, ce qui est rare et mérite d’être mentionné, d’un accès privilégié aux archives « non film » de ce que Blaise Cendrars appelait la « Mecque du cinéma », à savoir : les fonds de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Los Angeles (les dépôts du PCA), de l’UCLA (documents de la RKO) et de l’USC (dons de la Fox, de la MGM et de la Warner).
La bibliographie du livre est sélective, comme annoncé mais sans doute un peu trop puisqu’elle ne mentionne pas des auteurs dont les recherches sont aisément accessibles en bibliothèque, y compris en France.* Il est également dommage de passer sous silence le travail de John Mueller, de l’Université de Rochester, qui a beaucoup œuvré pour les films de danse et a publié un ouvrage exhaustif sur ceux, en particulier, de Fred Astaire. En dehors des universitaires, on aurait pu citer aussi un spécialiste du musical de la MGM et du cinéma hollywoodien comme Patrick Brion. Sans parler des écrits et mémoires des gens de cinéma eux-mêmes comme la danseuse-chorégraphe Katherine Dunham, le réalisateur Vincente Minnelli ou le producteur David O. Selznick. De même, il est dommage qu’un article prémonitoire comme celui de Siegfried Kracauer, L’Ornement de la masse (1927) soit cité en note mais n’apparaisse pas dans la bibliographie, tandis que le moindre texte de Théodore Adorno y est mentionné.

Nous pourrons nous demander si l’acception du mot politiques du titre n’est pas non plus un peu trop élastique. Certes, la censure a généralement une justification légale ou juridique mais, en dehors de la période de guerre, son objet n’est-il pas de traiter des questions de mœurs ou de morale ? Si tout est idéologique, nos propos comme ceux des contributeurs de l’ouvrage, tout ne peut être considéré comme politique.
Un des paradoxes du musical est, à en croire les auteurs du livre, que ce genre « mobilisant de gigantesques moyens au profit de la plus pure fantaisie » s’est aussi montré préoccupé par « l’état de la société de son temps », s’écartant par là même du « divertissement ».
Le musical, en ce sens, n’est pas simplement ce « luxe d’oublier le réel social » ou l’âpreté de l’Amérique de la Grande Dépression grâce aux « féeries aquatiques » d’un Busby Berkeley et dans, ce que les spécialistes appellent les « comédies backstage ».
Certains numéros sont d’ailleurs « teintés d’un vernis de réalisme », on pense à ceux chorégraphiés ou mis en scène par Stanley Donen, comme les réunions de travail en usine (The Pajama game) ou les extérieurs en ville, à New York ou à Paris.
Les sujets de société n’y manquent pas, comme par exemple ceux des « juvenile delinquents ». La « Good Neighbor Policy » de Roosevelt et les « enjeux internationaux » comme la lutte contre l’influence allemande en Amérique latine et le « soutien à l’effort de guerre » dans les années quarante. La contre-propagande utilise les mêmes principes que ceux de la propagande de Goebbels dans les années trente : « la manière la plus simple de faire de la propagande est de la faire passer dans un film de divertissement, quand les gens ne se rendent pas compte qu’il s’agit de propagande. » Un autre paradoxe est que le dévoilement des coulisses du spectacle « scrutées sans complaisance » permet au show de continuer, ainsi que le rappelle Laurent Guido dans sa contribution. L’analyse marxiste du spectacle par Adorno (dont s’inspirera Guy Debord qui, pourtant, s’en prendra moins à l’art du divertissement qu’à l’assujettissement du quotidien par la marchandise) se présente sous la forme d’une double contrainte : la transparence du film maintient le spectateur dans l’illusion mais la divulgation du truc de magie ne rompt pas du tout le charme, tout au contraire.
Dès le départ, avec The Jazz Singer (1927), le musical détourne l’un des deux arts américains du XXe siècle, le jazz (l’autre étant le cinéma, qu’il convient de distinguer du « cinématographe »). En maquillant la vedette en blackface, le film, produit par des blancs et destiné à un public de blancs, blanchit l’art noir-américain par excellence. Les compositeurs blancs, dont le talent ne fait pas de doute, piratent, plagient, espionnent les créateurs de couleur (cf. l’immersion des frères Gershwin en Caroline du sud qui aboutit à l’opéra Porgy and Bess) sans problème, réservant quelques numéros de musique et de danse de jazz à des intermèdes dans des longs métrages, à des courts métrages pour public noir, à des vitaphones et des soundies.
Hollywood découvre le jazz véritable au moment de mobiliser la population de couleur pour entrer en guerre. Deux longs métrages All Black cast sont alors produits en 1943 : Stormy Weather d’Andrew Stone et Cabin in the Sky de Vincente Minnelli.
Le meilleur film de jazz reste sans doute un court métrage de l’année suivante, Jammin’ the Blues de Gjon Mili.
L’analyse détaillée, pointue, d’un numéro du long métrage consacré à une disc-jockey blanche, Something in the Wind (1947), par Laurent Guido nous fait songer au court métrage de Roy Mack, The Black Network (1936), avec les Nicholas Brothers chantant et dansant « Lucky Number » ainsi qu’au Paramount Pictorials n° 889, Record making with Duke Ellington and his orchestra (1937), commenté par la vedette de la radio Alois Havrilla, avec l’orchestre de Duke Ellington et la chanteuse Ivie Anderson enregistrant un disquedans un studio de la maison Master/Variety, et décrivant le processus de fabrication d’un 78 tours, dela production de masters bifaces sur plaques argentée au au pressage en série des galettes plastiques.

De la phraséologie post-marxiste des années 70 dont on trouve trace chez un spécialiste du musical comme Rick Altman, on passe à une nouvelle langue de bois, avec la vogue, plus récente, des « études de genre ». Après avoir analysé les fins des films et les « stratégies spectaculaires et industrielles » se concluant par une « attraction qui est un véritable showstopper, un production number », Altman s’est intéressé au début des musicals. Selon lui, ce genre cinématographique coordonne deux projets : « la promotion des relations hétérosexuelles (…) et l’éradication des liens homosociaux. » Cette « idéologie restrictive » justifie en partie « l’attitude conservatrice qui a dominé la société américaine pendant les décennies durant lesquelles le musical prospérait. »
Cela explique pourquoi de nombreux critiques préfèrent de nos jours mettre « l’accent sur la réception, le style ou la persona des stars », alternative « aux lectures centrées sur l’étude du récit » typique des seventies – du structuralisme et de la « french theory ». Les chercheurs anglophones se sont ainsi focalisés sur les études de réception – de « gender et cultural studies ». Selon eux, « les spécificités du style de certains chorégraphes et interprètes déplacent les normes de représentation et encouragent la réception par des publics spécifiques, notamment queer. » Les « inflexions camp » de nombreux musicals peuvent être dues également au personnel gay et lesbien des studios, notamment de celui de la MGM et, plus précisément, de sa Freed Unit. Le style camp n’étant pas défini dans le glossaire du livre, on est en droit de se demander s’il ne serait pas tout simplement synonyme de kitsch.
Nicolas Villodre
Politiques du musical hollywoodien, Paris, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2020, 20 €.
Contributions de Marion Carrot, Marguerite Chabrol, Steven Cohan, Todd Decker, Gaspard Delon, Laurent Guido, Aurélie Ledoux, Adrienne L. McLean, Karen McNally, Allison Robbins, Pierre-Olivier Toulza.
* Larry Billman, Pascale Bouhénic, Gilles Cèbe, Christophe Champclaux, Michel Chion, André-Charles Cohen, Arlene Croce, Frédérique Drouin, Michael Dunne, Lyle Kenyon Engel, Hugh Fordin, Edward Gallafent, Beth Genné, Sarah Giles, Burt Goldblatt, Stanley Green, Stephen Harvey, John Mueller, Viva Paci, Roy Pickard, Alexandre Raveleau, Linda Tahir Meriau, Bob Thomas, Kevin Winkler, Isabelle Wolgust)
Catégories:









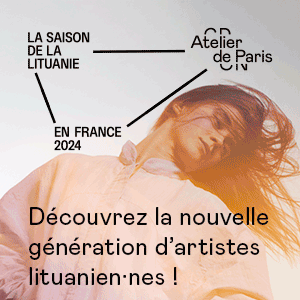







Add new comment