Montpellier Danse : « Mille et une danse (pour 2021) » par Thomas Lebrun
Un véritable torrent de danse qui charrie mémoires, émotions, disparus et même des oubliés qui reviennent faire un tour sur la piste : le Mille et une danse (pour 2021) de Thomas Lebrun, bouillonne et brouillonne de partout. Une déclaration d'amour à la danse, à sa puissance d'évocation et à tout ce qu'elle permet de faire revenir. Une pièce énorme.
Sur le parvis de l'Opéra Comédie, dans la chaleur du soir d'après spectacle, on entendait Schubert. Il était d'autant plus étonnant de l’entendre qu’il est précisément absent des Mille et une danse (pour 2021) de Thomas Lebrun. Pourtant le chorégraphe a fait une Jeune fille et la mort (2012). Mais dans Mille et une danse (pour 2021), on entend Mozart qui peine à démarrer au point que l'on se résout à n'écouter qu'une intro du Requiem avant qu'il ne commence vraiment. Il y a les Doors, Rachmaninov qui passe discrètement avant la Sonate au Clair de lune de Beethoven. Il y a aussi la musique de La Trêve(s) (2004) du même Thomas Lebrun et Purcell. Rachmaninov, c'est pour Julie Bougard, impériale dans cette pièce, qui avait, toute jeune, dansé sur cette musique pour son professeur de classique. Il y a aussi Laurie Anderson qui fait des musiques pas carrées. Quand les danseurs marchent, le contretemps vient en permanence casser les comptes. Debussy passe aussi, histoire d'un faune. Mais pas Schubert et encore moins cette Neuvième symphonie en ut majeur, que l'on appelle la Grande pour la distinguer de la petite (la sixième) et qui est comme un monde énorme, toute de reprises, de thèmes entremêlés, de ruptures et d'émotion. Un immense bazar bigarré et sublime dont la critique reconnut bien tard - le compositeur ne l'a jamais entendue - qu'il y avait là un monde et que ces redites constituaient de « divines longueurs » dixit Schumann.
Galerie photo © Laurent Philippe
Au moins, Thomas Lebrun a vu sa pièce. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup, entre confinement, reports, sans oublier le casse-tête de quinze agendas de danseurs à coordonner - et pas tous français -, quand faire un Tours-Paris en train relevait déjà, en ces mois-là, du Paris-Dakar…
Lorsque Akiko Kajihara apprend que sa mère est très malade, elle part au Japon. Quand elle en revient, après la mort de sa maman, la pièce a avancé et tous les danseurs font, dans une scène, arc de cercle. Akiko, en longue robe blanche, cheveux défaits, se lance, rend hommage… Et voilà Pina. Car cette vaste célébration de la puissance de la danse rencontre aussi tous les souvenirs, les références et les grands noms. Mais non pas comme monuments, juste comme moments : petits clins d'œil de connivence avec l'au-delà et le spectateur que l'on ne prendra pas en otage par l'émotion. Parions que peu nombreux ont noté que dans le solo, de dos et à contre-jour dans un arc-en-ciel diffus, de Thomas Lebrun lui-même qui traverse ensuite au noir la scène pour venir s'offrir dans une douche lumineuse rectangulaire, revenait Bernard Glandier et Pouce ! le bouleversant solo dont l'un des grands interprètes fut un certain Thomas Lebrun.
Galerie photo © Laurent Philippe
Et voilà, au détour, La danse des éventails d'Andy de Groat.
Mais avant… Cela commence par le solo très investi et intense d'une danseuse tout en noir qui s'appelle Jackie Taffanel et qui, du Cri du Guetteur (1988) au Tambours voilés (1997) a produit quelques petits bijoux qui mériteraient d'être redécouverts. Pour le moment, après sa danse, elle retourne à la file des danseurs qui s'est installée sur la scène nue. Chacun va alors, au sein de petits groupes qui se constituent, faire passer la danse de l'un à l'autre comme un mistigri. On trouve quelques moments Trisha Brown et les tours de Raphael Cottin sont d'une précision mathématique. C'est Christine Jouve, comme un oiseau fragile qui donne un petit solo de fleur exotique. Un peu après que soient passés les bras d'Odile Duboc… Forcément, ce foisonnement sans fin de la danse qui rappelle à la vie et revient en arrière vers l'avant est un peu perturbant. Mais qui a dit que la mémoire était logique ?
Il y a ces invités qui osent tout, comme Fabrice Ramalingom qui roule un vrai patin d'amour à son vrai mari. La danse ouvre à l 'amour de la vie et cela fait près de deux heures de scènes parfois folles et outrées qui ne sont pas de très bon goût parce que c'est comme cela ou d'une pudeur extrême. Et cela file en torrent jusqu'à l'ahurissante célébration d'un rituel de transe, sur une musique napolitaine qui roule et raille, d'une précision méticuleuse, sans jamais la moindre répétition et tout en redites. Il faut des danseurs d'exception pour tenir cette exactitude du mouvement, des comptes, des directions, alors que gagne la folie et pèse la fatigue.
Galerie photo © Laurent Philippe
Thomas Lebrun cache une tendresse vive pour la mémoire, en témoigne par exemple Mes Hommages, et ce Mille et une danses (pour 2021) n'est sans doute pas la meilleure pièce de son auteur. Elle est trop pleine de souvenirs et d'évocations, et part dans tant de directions : chaque danseur y est venu avec sa mémoire et ses émotions. Il y a trop d'invités imprévus et de références, même le Bolero et Wilfride Piolet qui réapparait furtivement. Trop d'émotion pour être la meilleure mais sans aucun doute la plus grande, parce que ses défauts sont ceux de la vie elle-même et que ses outrances cachent la pudeur des confessions. Comme la "Grande" de Schubert qui s'est donc invitée, tout cela est trop et c'est pour cela que c'est indispensable.
Philippe Verrièle
Vu le 28 juin à l’Opéra Comédie – Festival Montpellier Danse
Catégories:









































































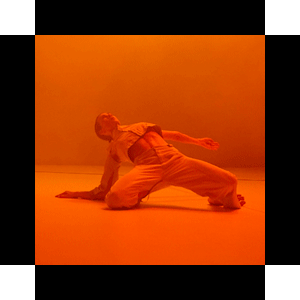





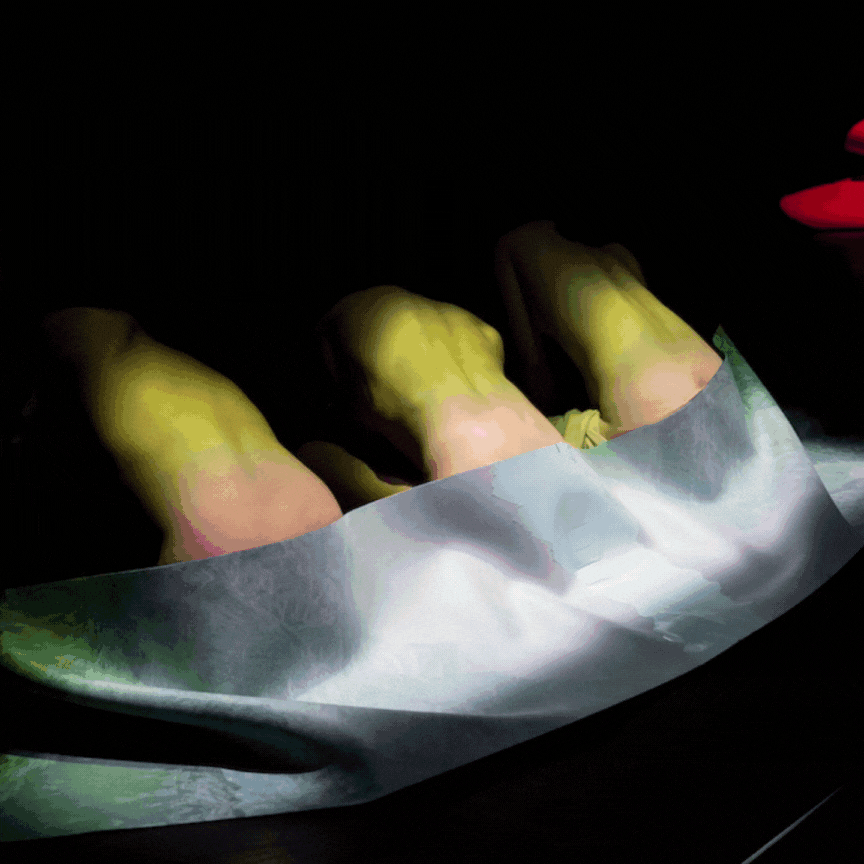






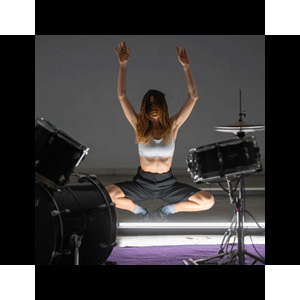

Add new comment