« Lumen » de Jasmine Morand
Création très élaborée d'une chorégraphe en vue, Lumen n'est pas si novateur que ce cela. Mais outre que tout y est très bien fait et construit, cette pièce ouvre quelques perspectives qui mériteraient d'être exploitées plus largement.
 Déjà couronnée de prix – Lumen a reçu celui de l'Office Fédéral de la Culture comme meilleure création danse 2020 – Jasmine Morand, après une jolie carrière d'interprète qui l'a vue passer par les ballets de Nancy, Zurich et Ljubljana, représente la nouvelle garde de la danse suisse. Elle est l'autrice d’une quinzaine de pièces et est implantée au Dansomètre, beau lieu de résidence qu'elle anime avec son équipe, la compagnie Prototype-Status.
Déjà couronnée de prix – Lumen a reçu celui de l'Office Fédéral de la Culture comme meilleure création danse 2020 – Jasmine Morand, après une jolie carrière d'interprète qui l'a vue passer par les ballets de Nancy, Zurich et Ljubljana, représente la nouvelle garde de la danse suisse. Elle est l'autrice d’une quinzaine de pièces et est implantée au Dansomètre, beau lieu de résidence qu'elle anime avec son équipe, la compagnie Prototype-Status.
Sa pièce Lumen se place dans le prolongement de Mire (2016) pièce autant que dispositif pour douze danseurs qui a connu un certain écho (plus d’une cinquantaine de représentations) et dans laquelle le public, allongé, ne découvre les interprètes que du dessus via un grand miroir sauf à s'approcher des fines fentes dans la paroi qui isolent ces derniers, et oblige à n'avoir qu'une vision fragmentée, presque volée. Quasiment même effectif (treize danseurs) et de nouveau un grand miroir, cette fois incliné vers le public assis en salle, et encore un espace restreint, le plateau fait 5m x7m et penche vers le fond de scène au début de la pièce, ce qui déjoue la vision correcte du corps des interprètes couchés, devenant invisibles. La proximité des deux « dispositifs de vision » et la parenté avec Underground, duo de 2012 qui grâce à un cube de surfaces opalescentes traversées de jours étroits interroge le concept du peep-show, constituent les étapes d'une démarche cohérente par laquelle la chorégraphe examine cette « présence immédiate » pour reprendre les termes que Paul Virilio appliquait aux danseurs et comédiens.
Lumen commence donc dans une quasi obscurité que traversent quelques éclairages rasants s'accrochant petit à petit à quelques reliefs abstraits ; d'où cette contrepente du plateau qui empêche toute vision précise. Tout au plus s'y distingue une manière de houle, onde sensuelle qu'une certaine pulsion spéculaire pousse à élucider. D'où le miroir. Dans celui-ci, se lisent peu à peu des formes mais c’est quand se dressent des bras, voire des jambes qui s'attrapent et se remettent mutuellement en place, se retiennent ou se caressent fugacement, que la scène prend sens de corps. La gestuelle s'amplifie au fur et à mesure que la lumière s'impose, passant du rasant impalpable à l'éblouissant face public, écrasante et violente quand au bout d'une heure, les danseurs s'étant graduellement levés, animées, dégagés des combinaisons noires et texturées qu'ils portaient, ayant tourné vers le public leur visage, toute une rangée de projecteurs braqués vers la salle avale dans la chaleur et l'intensité lumineuse ceux qui avaient mis près d'une heure à émerger du noir. Lumen se situe ainsi entre deux invisibles, celui du noir et celui de la toute lumière.

Ce type de construction comme indexée sur un crescendo lumineux a déjà été exploité dans des pièces majeures des années « non-danse » comme le Mua d'Emmanuelle Huyhn (1995) ou, dans un registre très différent Sens 1 (2003) de Pedro Pauwels. Le dispositif du plateau en pente et de ce qu'il génère de contrainte au mouvement voire à la vision a été exploité par Damien Jalet pour Skid (2017) pour ne prendre qu'un exemple récent. Quant au miroir et ses usages dramaturgiques, le récent D'un Matin de printemps (2022) d'Emilio Calcagno pour le Ballet de l'opéra d'Avignon en fait un usage assez comparable à celui de ce Lumen, sans même revenir à l'usage aussi malicieux que raffiné qu'en put faire le grand maître en illusion qu'était Nikolais. En somme, le concept de Jasmine Morand ne mérite pas tout à fait les enthousiasmes relevés quant à sa nouveauté.

Il est pourtant un détail qui n'est guère souligné. Dans le miroir qui trahit le déplacement discret des danseurs, dégageant l'espace et se regroupant en fond de scène ou sur un des côtés du plateau, apparaît fugacement sur le sol un halo blanchâtre et incertain. Au début, quelques traces, à peine une forme. Puis ce halo, à la manière des anthropométries de Klein, garde la forme des corps, « figur » (on se souvient que le mot, en allemand signifie silhouette) chargé de mystère car non seulement ces traces ne s'estompent pas – donc impossible d'y voir la seule transpiration – mais elles se mêlent et évoluent – donc pas des empreintes – donnant le sentiment qu'une réalité fuligineuse se fige sur le plateau. Cela ressemble aux halos blanchâtres et inquiétants des dessins du plasticien-dessinateur Richard Laillier qui semblent se dégager du noir comme un mauvais cauchemar. Tout à l'agitation bien réglée des corps en tutti, l'attention tend à oublier que le blanchâtre s'incruste et, quand le plateau finit par pencher vers le public, il aura pris une nuance grisâtre incertaine et un rien inquiétante.

Le dispositif, une peinture thermosensible et un système de chauffage, permet au plateau de devenir entièrement gris pâle et comme opalescent, effaçant au fur et à mesure les empreintes des danseurs. Leur trace disparaît donc avec la montée de la musique tandis que le mouvement s’homogénéise en tutti.
Comme si la clarté signifiait l'uniformisation malgré le fait que l'identité de chacun semble s'affirmer puisque les visages sont visibles… Il y a là une très intéressante contradiction que la pièce n'exploite pas tellement. Mais Jasmine Morand n'en a sans doute pas fini avec ces dispositifs de vision…
Philippe Verrièle
Vu le 12 janvier 2023 au Théâtre de la Ville/Les Abbesses, Paris.
Catégories:






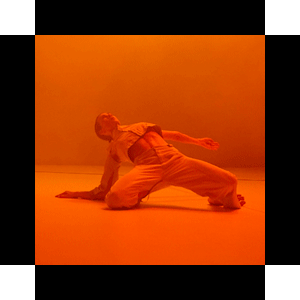





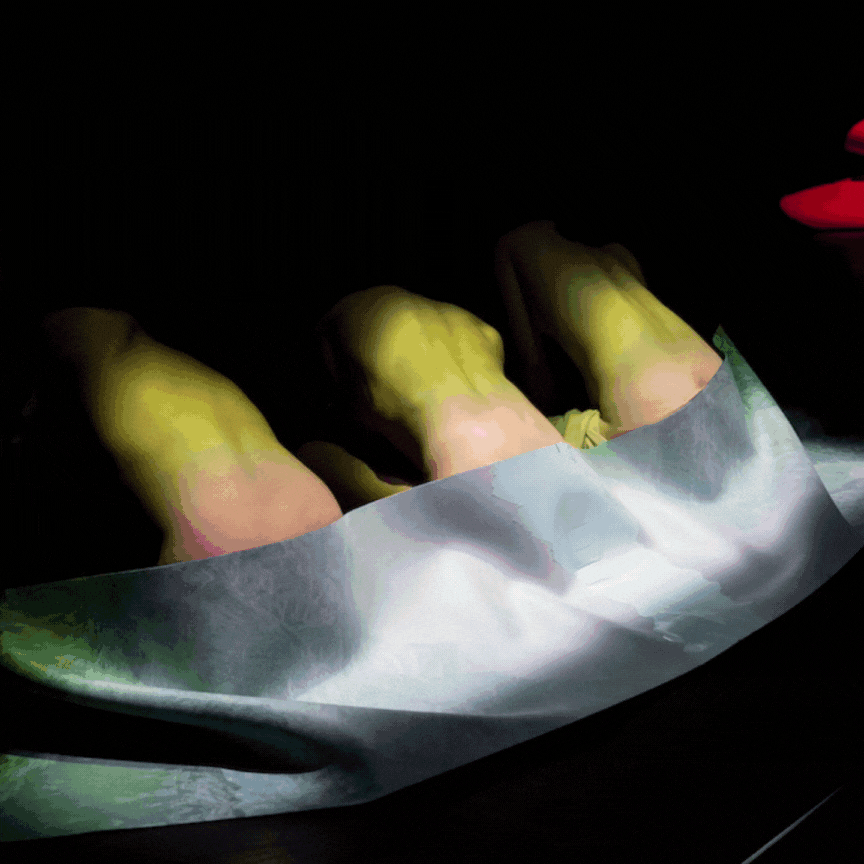






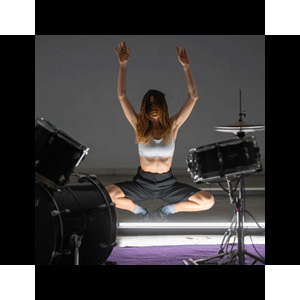

Add new comment