« Letter to a man »: Mikhaïl Barychnikov/Robert Wilson
On était resté plus que réservé sur la première collaboration entre Robert Wilson et Mikhaïl Barychnikov (The Old Woman, présenté à Paris l’an dernier). Cette fois, on s’incline devant le très bel hommage théâtral, visuel, et même furtivement chorégraphique, que ces deux stars de la scène rendent à une autre étoile, Vaslav Nijinski. En s’inspirant des « Cahiers » du danseur écrits en 1919 au moment de basculer dans la folie, ils font entendre avec une force bouleversante les mots d’un artiste qui, bien qu’au bord du gouffre, se tient au plus près de la vérité.
Bien sûr, on retrouve dans cette création d’art total - à laquelle a collaboré également Lucinda Childs - toute la machinerie habituelle dont use et abuse depuis des décennies Bob Wilson : éclairages monochromes, attitudes hiératiques, plans découpés façon cinéma muet etc. Mais là où ces marques de style semblaient, dans les derniers spectacles du metteur en scène américain, plaquées et vides de sens, elles illustrent ici parfaitement les différents états mentaux de celui qui fut le danseur le plus célèbre de son époque.

Barychnikov prête sa présence, son corps et sa voix aux phrases de Nijinski, que l’on entend pour la plupart en off, alternativement en anglais et en russe. Il a dit, au cours d’une interview, quel bonheur ç’avait été pour lui de renouer, grâce à cette pièce, avec sa langue maternelle. En l’entendant se glisser ainsi dans l’esprit d’un autre, on ne peut s’empêcher de songer aux similitudes entre les deux hommes. Tous deux nés en Russie, tous deux passés par l'école Vaganova et le Mariinski à Saint-Pétersbourg puis émigrés à l’ouest, tous deux adulés par un public enthousiaste. Heureusement, pour Micha, la comparaison s’arrête là. Et l’homme de 68 ans qu’il est aujourd’hui a su non seulement gérer sa carrière d’interprète, mais surtout trouver une nouvelle voie dans la création et la direction d’un centre ouvert à toutes les formes d’art, le Barychnikov Art Center à New York.

Nijinski n’eut pas cette chance, et son esprit resta pour toujours enfermé dans ce point de non-retour où sa sensibilité artistique fut submergée par un trop plein d’émotions et d’angoisses. Les phrases des « Cahiers » plusieurs fois répétées dans les deux langues, les apparitions / disparitions de silhouettes projetées, dont celle d’un homme littéralement à l’envers, tête vers le sol et pieds en l’air, les attitudes de mime et le fard blanc qui composent à Barychnikov un masque tragi-comique, disent assez combien ce naufrage mental fut vertigineux, et pourtant source une dernière fois d’élan créateur. Car les paroles de Nijinski, même lorsqu’elles déraillent, font sens.
Galerie photo © Lucie Jansch
En témoigne la dernière partie de la pièce, consacrée à l’obsessionnel ressassement du danseur sur ses relations orageuses et passionnelles avec Serge Diaghilev. Elle résonne avec une intensité encore plus douloureuse dans cet opéra Garnier de Monaco, où le tyrannique directeur des Ballets Russes se produisit avec sa troupe - et son danseur vedette - dès 1911. Lorsque le rideau tombe sur la scène finale, avec ses deux cygnes blancs posés devant une façade de théâtre, on comprend que le plus fou des deux n’est pas celui qu’on pense : Vaslav Nijinski, l’homme qui se défendait d’être un dieu, avait saisi à la fois l’essence divine de son art, et sa totale illusion.
Donné en première française à la Maison de la danse de Lyon en juin dans le cadre des Nuits de Fourvière, le spectacle sera aussi présenté en décembre-janvier à l’Espace Cardin à Paris (programmation du Théâtre de la Ville).
Isabelle Calabre
Vu le 1er juillet - Salle Garnier, Opéra de Monte-Carlo, Monaco,
Catégories:

















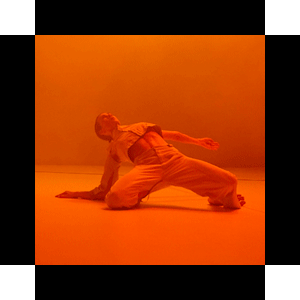





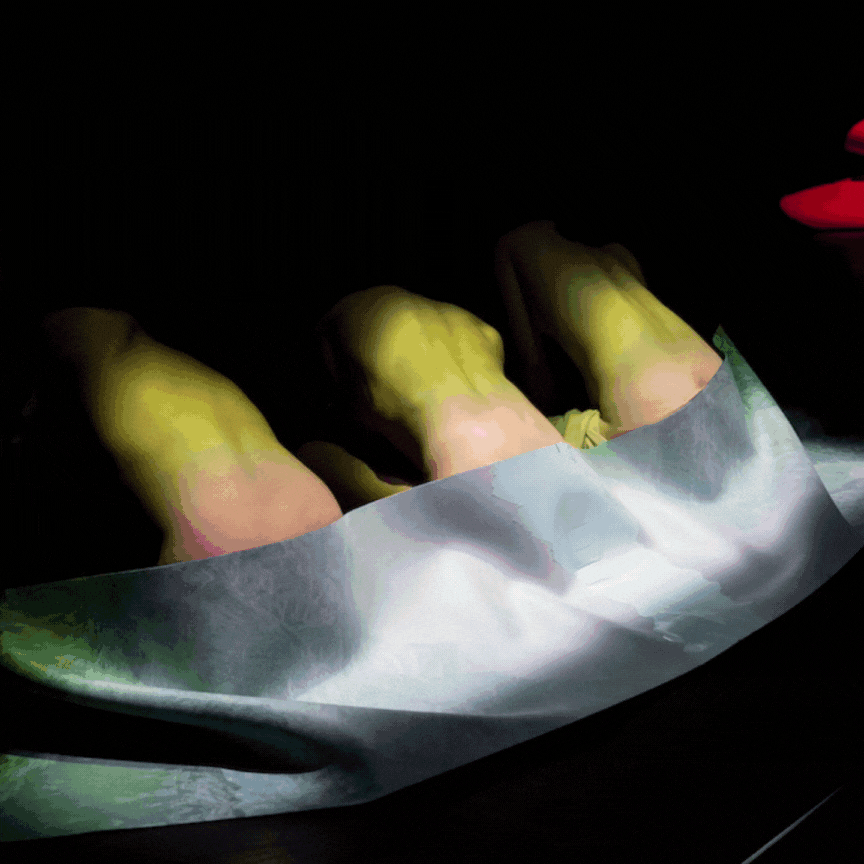






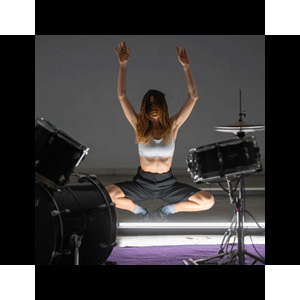

Add new comment