Le Festival 360° à La Passerelle de Saint-Brieuc
La scène nationale de la préfecture des Côtes d'Armor s'est transformée en "théâtre d'expériences sensorielles". Extraordinairement diverses. Y compris audacieuses.
Tout arrive : chercher une portion de far breton à Saint-Brieuc à 17h en semaine, peut tourner à l'expédition d'une heure quasiment (pour se conclure à la boulangerie la plus proche de l'hôtel, qu'on avait loupée au départ du périple). Moyennant quoi s'effectue l'exploration d'un centre ville granitique, qui ne laisse pas indifférent. Mais les pas de porte s'y partagent entre, d'une part ceux qui sont fermés et à vendre, d'autre part ceux des franchises qui standardisent nos existences et font qu'on serait aussi bien à Tarbes ou à Valence sans trop voir la différence.
Plus déprimant : le chaland est très rare, on se coirait un lundi en janvier alors que ça pète le printemps. Pendant ce temps, on suppose que la foule grouille dans les centres commerciaux de périphérie. On transportait un peu de ce blues, vers 18h30, au moment de pousser la porte du "Théâtre", sur la place de la Résistance. Aujourd'hui, on dit "La Passerelle - Scène nationale".
Or là, jusqu'à minuit passé, on a croisé tant de gens, vécu toute une atmosphère de curiosité, de disponibilité, des jeunes pas blasés vraiment craquant.es, et puis tous les âges, avec un DJ qui remue la tonalité, une programmation si foisonnante qu'on ne peut tout voir, un genre d'excitation tranquille, qu'on a voulu croire à deux choses : sur fond de naufrage de nos vies, on était bien là en place de Résistance, parce qu'on était dans un "théâtre d'expériences sensorielles", tel que s'annonce le Festival 360°, parvenu à sa neuvième édition en ces lieux.
On vient d'avoir le préambule assez long. Il le fallait pour gueuler un coup, contre l'injonction populiste qui voudrait culpabiliser ce peuple du partage sensible, qui a envie, qui prend la peine, de faire chemin dans l'incertain, la découverte. A Saint-Brieuc, préfecture de moins de 50 000 habitants quelque part en France en 2017, cela fait tout un public, contributif à un moment d'exception. Il n'y a pas que les autoroutes des réseaux sociaux. Les parkings des centres commerciaux. On ne va quand même pas avoir honte de goûter l'excellent, le fragile, l'étonnant. Voilà. C'est dit.
La Passerelle est un équipement moderne, mais encastré dans un vieux bâtiment. On ne sait trop pourquoi s'y offre un espace hors du commun, grande fosse qui crève son hall, en rappelant ce qu'était celle du Centre Pompidou (ensuite liquidée par souci d'efficacité dans la gestion normative des flux de visite). Qu'on la surplombe depuis la galerie supérieure en pourtour, on qu'on descende au fond, fréquenter cette fosse est en soi un début d'expérience sensorielle.
Le chorégraphe Francis Plisson y avait disposé, avec le plasticien Jérémie Bruand, une horlogerie géante de fléaux suspendus, tournoyant à ras du sol, en balayant de grands cercles de cendres répandus là. Cette installation performative brasse un souffle philosophique, que le danseur (toujours Francis Plisson), aborde avec retenue, le plus souvent sur le bord. Dans Autre Aurore, il a décidé de nous faire entendre Ainsi parlait Zarathoustra, de Nietzche. Ce qui n'est pas rien ; et qu'on salue en soi.

L'énoncé même du texte a été confié à une comédienne, qui peine à ajuster sa tonalité dans ce volume, et souvent rajoute de la théâtralité à un texte qui n'en a pas besoin pour flamboyer dans l'esprit. Ainsi l'attention se dispute. Mais on a vibré au geste retenu, frissonnant, patient, du danseur d'âge confirmé, qui laisse résonner l'appel à « tuer l'esprit de pesanteur » et « vivre au-delà de l'époque, au-dedans de [soi]-même ». Ce qui suffit à indiquer un fort projet de corps-à-être.
 Dans tout le bâtiment, loges et bureaux compris, sous les sun-lights du bar, dans l'air vivifiant du parvis zébré de cris de mouettes, Malena Beer proposait ensuite son Un-visible. Le participant unique y évolue yeux fermés, dans un périple guidé par le toucher de la performeuse.
Dans tout le bâtiment, loges et bureaux compris, sous les sun-lights du bar, dans l'air vivifiant du parvis zébré de cris de mouettes, Malena Beer proposait ensuite son Un-visible. Le participant unique y évolue yeux fermés, dans un périple guidé par le toucher de la performeuse.
L'expérience n'a rien d'incroyablement neuf. Mais elle fait vivre avec plénitude un déplacement dans les fonctions sensorielles. Yeux fermés, tout se perçoit différemment par l'oreille, la peau, le sens de la gravité, la proprioception exacerbée. Les sens ne relèvent pas d'un fonctionnement automatique et toujours identique. Il est bon que tout spectateur, voire tout citoyen, prenne la mesure de cette relativisation, et expansion, de son potentiel sensible dans le monde.
Jean-Sébastien Bach traversait ensuite la soirée. Cela dans le théâtre à l'italienne que recèle le bâtiment – un bijou d'un peu plus de deux cents places à peine, qui vaut à lui seul le déplacement . violoncelliste Gaspar Claus et le producteur techno Antoine Hussen, alias Electric Rescue, s'allient pour faire sonner le compositeur de manière peu coutumière. Le problème réside dans le fait qu'il faut d'embler soumettre le son du premier à un régime d'amplification, pour que la connexion technologique opère avec le second.
Ainsi l'écoute bascule-t-elle d'emblée dans une artificialisation de sonorités vulgarisées. D'où l'impression que le musicien baroque est parti se promener dans une galerie marchande, dilué dans une décoration d'effets acoustiques. On ne doute pas du talent qui s'investit ici, ni même de la puissance de la démarche. Mais on ne capte pas ce qu'on gagne à ce Bach qui n'est plus lui-même sans pour autant devenir autre chose qui serait unique.
Si on avait fait le déplacement de Saint-Brieuc, c'était, pour bonne part, en lisant le nom de Lorenzo De Angelis à l'affiche, dans les recherches en cours d'une grande pièce composite. Mais on a fini par se dire qu'on aurait plus de chance de voir son travail ici ou là, alors qu'il est rarissime de voir celui de Camille Mutel, qu'on confondait bêtement jusque ce soir là avec… Camille Boitel.

Totale confusion, c'est peu de le dire. Il faut des programmateurs très déterminés, pour montrer un travail que n'importe quel édile mal intentionné aurait tôt fait de désigner comme pornographique. Go, Go, Go, Said the Bird rappelle ce qu'on peut supposer de quelque rituel érotique japonais. Une rigueur extrême dans la maîtrise du rythme et de l'espace – au blanc glacé – orchestre les actions de deux performeurs (Philippe Chosson, au côté de la chorégraphe), que leur nudité icônique sculpte au-delà d'une évidence incarnée des corps.
Le chant d'Isabelle Duthoit creuse le souffle de la respiration jusqu'à râcler les cordes extrêmes de la vocalisation. Les actions, rares et emblématiques, développent un imaginaire du partage érotique transgressant tout usage conventionnel, dont la plupart des spectateurs se découvrent alors – suppose-t-on – d'assez paresseux dépositaires. Il en va notamment du maniement de la figure très symbolique de l'oeuf, intromissible dans les orifices du corps, mais dont le jaune aussi, retenu dans sa membrane, affole un partage des peaux ou des bouches. A en juger par l'extrême concentration dans la salle, cet essai transporte loin dans une philosophie stupéfaite, aux ressorts possiblement psychanalytiques, des usages intimes et partagés du corps. On nous avait bien parlé d'un "théâtre d'expérimentations sensorielles".
Gérard Mayen
Spectacles vus le mercredi 29 mars 2017.
Catégories:









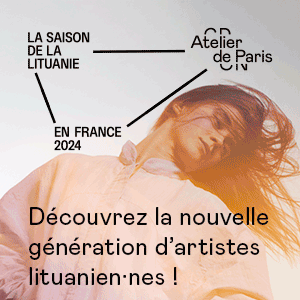







Add new comment