« La procession » de Nacera Belaza
Ce n'est pas toujours d'un cœur léger qu'on se rend au MUCEM (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) de Marseille. Il en va de son architecture bavarde, de sa charge politique et urbanistique (la reconquête de la cité phocéenne par les logiques néo-libérales), et l'overdose communicante qui dès lors le submerge. On y entre avec le sentiment d'être déjà accablé par un formatage du sensible, une médiation obligée du savoir, une politique de remplissage à la clé.

Dans le même temps, les élus marseillais font assaut de négligence, pour laisser mourir à petits feux le passionnant musée d'art contemporain que compte aussi leur ville. Or la chorégraphe Nacera Belaza vient d'avoir l'occasion de redonner transcendance artistique et optique contemporaine au cœur même du musée ethnographique qui surplombe le Vieux port. Cela grâce à la programmation Objets déplacés, conçue par la curatrice d'origine libanaise Samar Kehdy, comportant quatre rendez-vous cette saison.
Il est proposé aux artistes invités de "déplacer" des objets de la collection du musée (on y met des guillemets, car les conservateurs veillent à l'observance de toute une série d'interdictions, dont justement celle de toucher réellement aux objets). Ce dernier point paraîtrait absurde, si au contraire et par excellence, le projet ne visait à déchaîner les tensions vivantes que recèle la confrontation entre logique muséale d'une part (conservation, documentation scientifique, immobilisation, fixation dans l'exposition, mais aussi déambulation du visiteur) et logique des arts vivants d'autre part (performance, acte unique, production éphémère, licences imaginaires).
Objets déplacés travaille exactement la notion du croisement. Croisement entre disciplines, matières, époques, logiques, usages sociaux. Cette option s'aiguise lorsqu'on constate que les partis pris architecturaux dans ces lieux ont totalement ignoré pareille préoccupation. Par exemple, le MUCEM ne comporte aucune salle de spectacle (seulement un auditorium). L'acte artistique y opère par plongeon. Et cela s'aiguise par le parti pris que les performances doivent se produire ailleurs que dans les réserves ou les galeries d'exposition.

Nacera Belaza, et sa sœur Dalila Belaza y auront conçu une envoûtante procession. Celle-ci aura touché exactement à la question du statut réservé au visiteur spectateur : celui d'un consommateur modèle, sagement soumis au pré-cadrage des techniques de la médiation et de la communication muséographique ? Ou, pour les deux soirées de Procession, celui d'acteur d'une transcendance de ces lieux, où les objets suggèrent d'épouser d'immenses perspectives temporelles et géographiques ?
Les deux artistes ont d'abord prélevé une énorme roue circulaire, lourde pierre percée en son centre pour laisser passer un moyeu – sans doute une meule, suppose-t-on. Elles l'on fait déposer au cœur du hall du musée. C'est un lieu impersonnel, habituellement voué au dispatching fonctionnel des flux tendus de visiteurs et opérations de marketing afférentes (boutique, billèterie, etc). Mais, cette fois en dehors des horaires normaux d'ouverture, on s'y retrouve plongé dans une pénombre conséquente, seulement percée d'une douche lumineuse éclairant la masse de pierre.
C'est une immersion dans un contexte incertain. Il faut y réenvisager tous ses repères spatiaux, inventer le sens de sa possible déambulation, sinon déterminer le choix de son arrêt immobile en un point fixe. L'intérêt esthétique de la meule ne suffit pas à induire l'habituelle station du visiteur de musée s'arrêtant devant une œuvre dans une galerie. Il n'y a pas non plus matière à s'attarder sur des indications qui documenteraient l'objet, lesquelles sont absentes, au profit d'une présence brute. La déambulation se fait plutôt divagation, assez déstabilisante, en attente, peu définie. Un point dur, matériel et central (la pierre) s'entoure d'un nuage cosmique de quatre-vingt corps humains dérivant doucement, flottant, enfin affranchis de l'injonction para-scolaire d'être guidés au musée.
Mais voilà que parmi ces corps, vient à sen dégager un, qui capte peu à peu l'attention, met subtilement en tension, par seulement son pas d'une infinie lenteur, sa densification de présence, sa conscience d'une action, d'une trajectoire, dont on pressent subtilement qu'il est animé. Il s'agit de Dalila Belaza, que la grande majorité ici ne connaît pas, mais en qui on consent à reconnaître l'artiste supposée attendue ce soir-là, sur la frange, le liminaire, la vibration du presque rien.

Ce statut d'artiste désigné est lui aussi mis en crise. On s'en convaincra lorsqu'on apprendra, à l'issue de la performance, que trois ou quatre autres personnes présentes, adoptant d'emblée la même attitude que Dalila Belaza, ne sont pas des danseurs, ni même amateurs, mais des agents de médiation du musée, invités pour une fois à opérer par le seul geste.
Il y a pure définition d'une notion chorégraphique, ramenée à son paramètre minimal, quand toute une petite foule, que rien n'y avait préparé, se résoud, très progressivement, à entrer, chacun l'un après l'autre – il y faudra de très longues minutes – dans une marche processionnaire, suivant des guides non autoritaires, sans injonction à le faire. Cela, de sorte qu'à la longue, un immense tableau gravitationnel se forme, tournant d'abord imperceptiblement en ronde autour de l'objet central consacré, ouvrant à de très profondes résonances.
Il se révèle, chez tous ces citoyens rassemblés, un besoin abyssal, semble-t-il, d'écouter le silence, de prendre son temps, d'envisager son semblable qu'on croise lui aussi en train de marcher, et tous d'entrer en méditation collective, parce que l'heure paraît grave – et elle l'est –, parce que cet instant est rare, parce que l'art fait sortir de soi, vers l'in-su, parce qu'on peut l'acter, le partager, faire collectif, et politique en définitive. Il est alors possible que les larmes viennent aux yeux, et qu'on renoue les fils d'un sens originel possible de la danse, faisant lien par la façon d'envisager de peupler un espace.
Quelle est la puissance d'un geste qui, même infinitésimal, parvient à contaminer, infuser, un collectif entier, jusqu'à le déterminer dans l'action ? Cela en dehors de tout programme annoncé, ou injonction explicitement formulée. L'essentiel de la soirée continuera de se composer de cette sorte (même si Nacera Belaza y insèrera aussi la séquence d'un solo de danse effectif, au péril du pas de côté). On retiendra aussi un long tableau suggérant une sacralité de diva, dans la personne de Dalila posée au lointain, révélée à travers, là encore, un antique objet juste percé sur le passage d'un rai de lumière.
Au final, s'autorisant un rien pagailleuse, moins hiératique, la foule se jettera encore en nuée de derviches tournoyant pour hâcher de furieuses lumières. Ces soirs-là, les sœurs Belaza auront inventé – et risqué, car enfin rien ne garantissait que cela allait fonctionner – une pièce qui n'exista que par la décision de ses propres spectateurs, d'assumer la responsabilité de la réaliser par eux-mêmes.
Gérard Mayen
Spectacle vu le 19 décembre au MUCEM (Marseille).
Catégories:






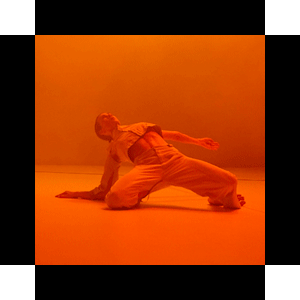





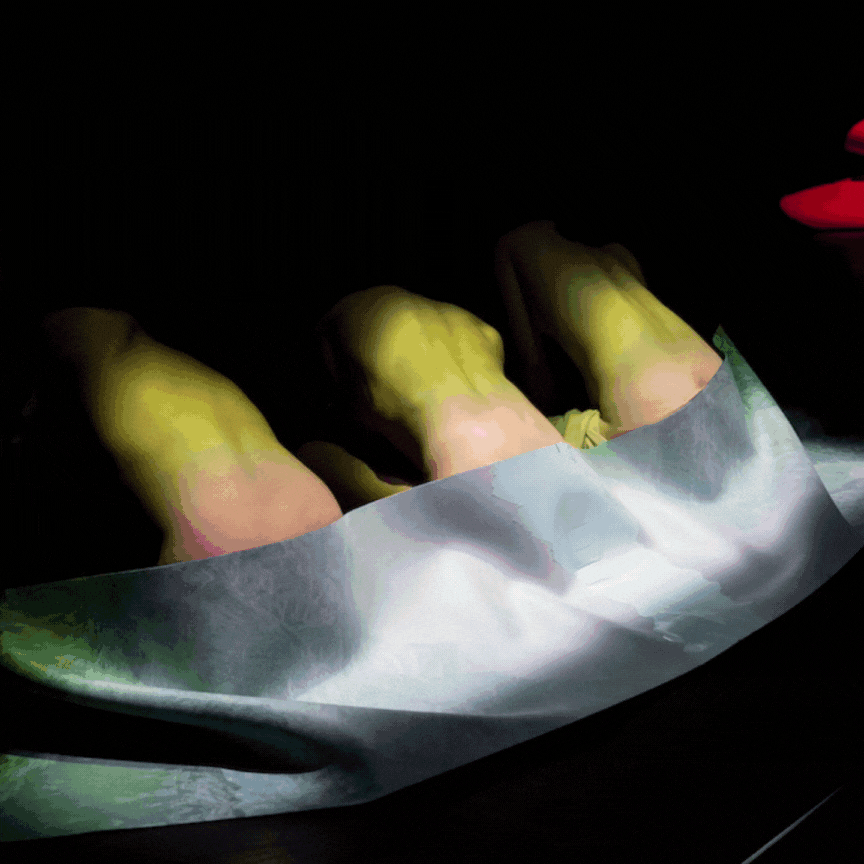






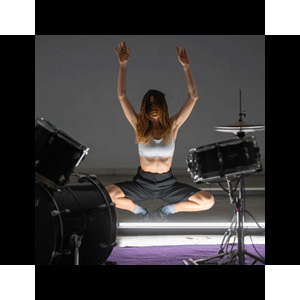

Add new comment