Entretien : Jean-Marie Didière nous parle de Patrick Dupond
Sa biographie officielle commence par « Il entre a l'école de danse de l'Opéra de Paris, où il partage quatre années d'apprentissage turbulentes avec Patrick Dupond » ; sur la page de dédicace d'Etoile, la biographie de Patrick Dupond, celui-ci le remercie comme son « deuxième moi » ; Jean-Marie Didière est sans aucun doute le témoin le plus précieux. Ne serait-ce que parce qu'en véritable ami, il n'était pas dupe mais toujours là. Et il a accepté de nous expliquer quelques-uns des aspects les plus marquants de sa personnalité.
Danser Canal Historique : Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Patrick Dupond ?
Jean-Marie Didière : C'est un peu flou. J'ai eu une scolarité un peu compliquée. Je me suis retrouvé dans la classe de Patrick et c'est son sens de l'humour qui m'a tout de suite plu. Nous avons fait des blagues, mais tout cela était assez anodin en définitive. Nous avions surtout une surveillante que nous trouvions odieuse et nous étions assez rebelles. Pour donner un exemple, pendant les moments libres, nous nous cachions dans les les studios pour attraper des bouts de répétitions. Patrick avait déjà un culot qui m'impressionnait. Par exemple, avec Gilbert Mayer, il établissait un rapport de force assez étonnant pour son âge. Je me souviens l'avoir vu sortir en protestant contre ce qu'on venait de lui apprendre en menaçant le professeur d'un procès !

DCH : Pourquoi l'idée et l'envie de participer au concours de Varna ?
Jean-Marie Didière : Nous savions que ce concours existait pour nous, c'était presque un modèle. Nous avions tous l'image de Mikhaïl Baryshnikov. Pour Patrick, le modèle était plutôt Vladimir Vassiliev. Nous venions de le voir danser avec Ekaterina Maximova, et Patrick avait été enthousiasmé. Patrick, c'était un peu un genre de Vassiliev qui rêvait d'être Baryshnikov. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus sensuel chez Patrick et de beaucoup plus intellectuel chez Baryshnikov.
Pour Patrick à cette époque, il fallait être au niveau des meilleurs ou rien et passer par Varna parce que Baryshnikov l'avait fait. Alors, pour lui, participer au concours, c'était pour gagner le premier prix et la médaille d'or, parce que c'était cela être le meilleur. Il avait une confiance étonnante.
Mais il était beaucoup aidé par son charme et avait toujours eu de la chance. Quand il est arrivé à Varna il est parvenu à travailler avec le vieil Anton Dolin et a aussi été coaché par John Gilpin. Je ne sais pas comment il a réussi, mais cela a été déterminant.

DCH : Patrick et vous aviez la réputation d'avoir été turbulents voire indisciplinés. Qu'est-ce que cela signifiait ?
Jean-Marie Didière : En réalité, pas grand-chose. Patrick était un peu menteur, un peu frondeur mais toujours charmant et jamais méchant. Quand nous étions convoqués pour avoir fait une bêtise, nous nous mettions d'accord pour partager les fautes et atténuer la sanction.
Comme il avait parfois la tentation de sécher les cours, je servais d'alibi. D'ailleurs Max Bozzoni avait compris le truc : il avait fini par me permettre de suivre gratuitement ses cours, comme cela il était certain que Patrick serait là !
Mais sur le fond, Patrick n'a jamais su « se tenir comme il faut ». Il n'était pas de la même trempe qu'un Hughes Gall, qu'une Brigitte Lefèvre. Il allait toujours un peu comme il le sentait, là, juste au moment présent. Il ne calculait pas. C'est un peu pour cela que je n'ai pas voulu collaborer avec lui quand il a été nommé à la direction du Ballet.

Tout le monde me disait, « maintenant que Patrick est là, tu vas devenir maître de ballet » , mais je n'ai pas voulu. D'abord parce qu'il n’était pas question que je sacrifie même cinq minutes de ma carrière sur scène, j'aimais trop cela, ensuite parce que je savais très bien que c'était un peu dangereux de travailler avec Patrick. Il était généreux et sympathique, mais il y avait toujours un moment où il risquait de se défausser. C'est comme cela. Et avec ses excès…
DCH : Mais, à propos de cela, que cherchait-il à exorciser ?
Jean-Marie Didière : Évidemment une part de son enfance. Sa mère l'a eu très jeune, elle avait dix-huit ans, et c'était plus une grande sœur qu'une maman. Le papa breton, il ne l'a pas connu. Il a vécu les choses comme cela et l'on ne se rend pas compte quand cela commence à détruire.

DCH : Il en était conscient ?
Jean-Marie Didière : Patrick ne se retournait pas sur le passé. Ce n'était pas un analytique ; il ne prenait pas de recul. Il improvisait sur chaque situation. Il a eu des tas de rendez-vous incroyables avec des personnalités énormes, John [Neumeier], Maurice [Béjart], Roland [Petit], il n'a jamais su construire quelque chose avec eux. Il a toujours tout brûlé ! Et avec Maurice vraiment [rires] ! Une blague a circulé quand la maison de Patrick a brûlé, avec toutes ses affaires. C'était très peu de temps après la mort de Béjart et on disait « Maurice s'est vengé du chalet ! »

DCH : Et avec Rudolf Noureev ? Il y a eu cette fameuse interprétation des Chants du Compagnon errant. Comment se considéraient-ils ?
Jean-Marie Didière : C'était pour la carte blanche à Jean Guizerix. Je dansais le Chantavec Patrick, et ils ont décidé, lui et Rudolf de le danser ; c'était très simple. Patrick était très respectueux de Rudolf et lui l'aimait bien. Il lui a dit « vous et moi, même danseur de caractère. Mais moi je suis Rudolf Noureev ». Cela voulait dire, « moi j'ai énormément bossé ». Mais il y avait une vraie tendresse entre eux. Et une vraie générosité des deux côtés. Quand Rudolf est revenu monter Raymonda, il fallait que la première soit un gros coup, alors Patrick a accepté de venir simplement danser la danse espagnole avec Françoise Legrée.
DCH : Comment était-il avec ses partenaires ?
Jean-Marie Didière :Il était assez simple. Il n'avait pas besoin d'écraser les autres pour exister. Il avait suffisamment de charme, même s'il était très cabotin. Mais du coup, avec ses danseuses, il en était toujours amoureux quand il dansait et il savait rester derrière. Il y allait, il donnait tout, même quand la fille était un peu difficile. Et il y en a !
Je l'appelais Prem's, parce qu'il fallait toujours qu'il soit devant. Je le surveillais un peu pour éviter qu'il délire trop ! Mais il était très généreux. C'est grâce à lui que je suis devenu Sujet. Pour le concours, il était venu en coulisse et j'étais tétanisé. Lui regardait tous les danseurs, il me disait, « tiens celui-là il a raté ça ou ça, tu as ta chance. » Il avait profondément le sens de la « compet ». Moi je n'ai jamais fonctionné comme cela et je ne me sentais pas capable de monter sur scène. Mais il m'a littéralement poussé, il m'a presque obligé à danser et je me suis fait applaudir alors qu’il était toujours le seul qui se faisait applaudir au concours.
 Mais il ne faut pas se tromper, il n'était pas dupe et surtout de lui. Il avait un formidable humour sur lui-même. Un jour, avec le groupe Dupond et ses stars, nous répétions dans la Rotonde des abonnés et nous avons commencé à le blaguer et lui dire qu'il ne faisait pas assez d'effort pour faire ses arabesques. Alors il s'est mis à détailler ses jambes, à nous montrer ses pieds trop puissants, ses jambes légèrement arquées et à nous montrer que s'il faisait vraiment une arabesque « d'école » cela ne collait pas et qu'il n’était pas fichu physiquement pour entrer dans les codes. Et tout cela en se moquant de lui-même. C'était un joueur-danseur-animateur.
Mais il ne faut pas se tromper, il n'était pas dupe et surtout de lui. Il avait un formidable humour sur lui-même. Un jour, avec le groupe Dupond et ses stars, nous répétions dans la Rotonde des abonnés et nous avons commencé à le blaguer et lui dire qu'il ne faisait pas assez d'effort pour faire ses arabesques. Alors il s'est mis à détailler ses jambes, à nous montrer ses pieds trop puissants, ses jambes légèrement arquées et à nous montrer que s'il faisait vraiment une arabesque « d'école » cela ne collait pas et qu'il n’était pas fichu physiquement pour entrer dans les codes. Et tout cela en se moquant de lui-même. C'était un joueur-danseur-animateur.
Cela explique aussi son rapport au public. Pour lui, il fallait toujours qu'il se passe quelque chose. C'était aussi sa façon de prendre en charge les attentes du public. Cela se traduisait jusque dans ses saluts. A l'Opéra, il se tenait encore, mais au Japon, par exemple, il faisait des gags et cela pouvait durer.
Je peux très bien comprendre qu'il énervait, mais personne ne pourra lui enlever son côté à part.
Propos recueillis pas Philippe Verrièle






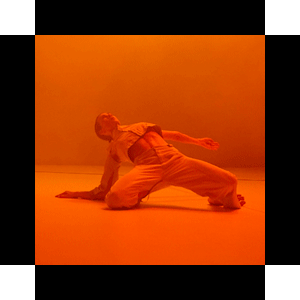





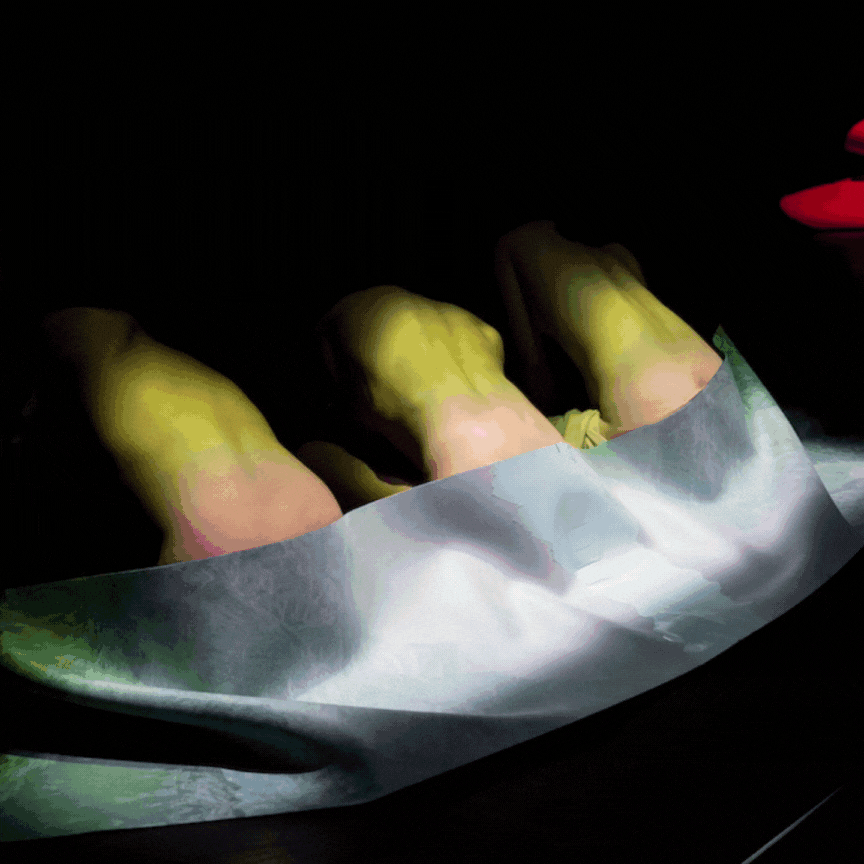






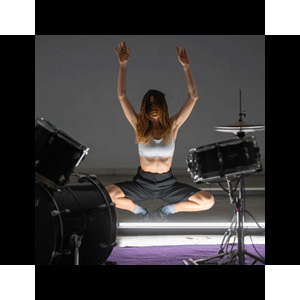

Add new comment