Dominique Brun/François Chaignaud : « Nijinska|Voilà la femme »
La Biennale du Val-de-Marne et Chaillot ont dévoilé les nouvelles noces entre Bronislava Nijinska et le monde actuel, entre Stravinski et Ravel.
Cinq décennies après nous avoir quittés, Bronislava Nijinska (1891-1972) peut-elle enfin être plus que la sœur de son frère ? Largement oubliée au profit de Vaslav, elle avait pourtant à son arc des dizaines de pièces, ayant notamment chorégraphié les créations de deux monstres sacrés de l’histoire musicale : Stravinski et Ravel. De ce dernier, rien de moins que le Boléro. Et pourtant, le public identifie le patrimoine familial uniquement au Sacre et au Faune, et crédite Béjart pour le Boléro, alors que le Lausannois venu de Marseille revisita l’original créé en 1928 par la Nijinska.

Celle-ci, unique femme admise à chorégraphier pour les Ballet russes de Diaghilev, créa Les Noces à la Gaîté Lyrique à Paris en juin 1923, dix ans après la création de la chorégraphie du Sacre du printemps par son frère. Dominique Brun, aujourd’hui reconnue comme celle qui réveille, par une lumière contemporaine, certaines « survivances et lueurs » - en ses propres termes - de la révolution chorégraphique survenue il y a un siècle, est à son tour passée par le Sacre et L’Après-midi d’un Faune, avant de recréer Les Noces et de proclamer aujourd’hui : « Voilà la femme ». Bronislava, donc.
Le sacrifice par le mariage
Comme Le Sacre, Les Noces se place dans un ensemble de forces ancestrales. Nijinska reprend ici le flambeau de son frère en exprimant, à travers des gestes très contraints, que le mariage paysan aussi est un rite ancestral où on sacrifie une jeune fille pour que l’ordre social, défini par les hommes, puisse perdurer. La communauté s’empare d’une jeune femme, dans le souvenir de celles qui l’ont précédée, sachant que la prochaine suivra, inexorablement. Les couples des Noces, souvent immobiles, paraissent comme pétrifiés. La scène la plus iconique, celle des têtes de femmes empilées, est la métaphore de tous les sacrifices : coutumes ancestrales, guerres, révolutions...

On mesure à quel point la gestuelle a pu dérouter en 1923, même si le public parisien était habitué aux surprises esthétiques des Ballets russes et des Ballets suédois. Les unissons de bras angulaires aux poings serrés renvoient au labeur de la terre, au travail, à la violence sexuelle... Etre aujourd’hui confronté à ce langage entre constructivisme et Bauhaus donne la curieuse sensation de vivre à nouveau, dans un frémissement toujours palpable, un bond en avant dans l’histoire de la danse.
Ces gestes, tantôt sculpturaux, tantôt saillants, parlent de détresse. Ils peuvent cependant être asservis pour incarner, paradoxalement, puissance et optimisme. Le réalisme socialiste en témoigne. A contrario, le travail de Nijinska semble ici le démasquer et annoncer la face cachée derrière la propagande. Côté femmes comme côté hommes, ni joie, ni liberté. La sobriété des costumes et de la mise en scène est aussi celle de la rigueur et des difficultés à vivre dans un pays dévasté par des années de guerre civile. On est loin du « divertissement » imaginé à l’origine par Stravinski en composant les quatre tableaux musicaux.
Galerie photo © Laurent Philippe
Trois siècles de noces
Contrairement au Sacre du printemps, la chorégraphie des Noces est richement documentée. Dominique Brun a pu consulter un ensemble d’archives : celles du fonds Nijinska de la bibliothèque du Congrès de Washington documentant la création en 1923 ainsi que la partition en système Laban d’après la recréation par Nijinska en 1966 pour le Royal Ballet de Londres. C’est une chance, mais aussi un défi, puisque la tâche est d’autant plus complexe quand il s’agit d’introduire une distanciation qui permet d’inscrire la recréation dans notre époque.
L’idée : introduire, entre les quatre parties dansées, trois tableaux vivants reconstituant des œuvres peintes au XVIIe siècle par Rubens et Brueghel le Jeune, qui représentent justement noces et danses paysannes. Ceci, non pour souligner la modernité de l’écriture de Nijinska, mais pour augmenter le vertige déjà ressenti. Car ces groupements immobiles, ces instants figés d’une ambiance festive et mouvementée, se présentent tels les souvenirs d’un autre monde qui relèvent plus encore l’austère noir et blanc des Noces. Dans les tableaux, une joie de vivre, mais figée. Chez Nijinska, une joie de vivre, juste rêvée. Mais ces rondes colorées se font aussi le reflet de la vision de Stravinski, pour lequel les « scènes chorégraphiques russes avec chant et musique » devaient être réalisées dans des costumes colorés, à l’instar du Sacre. Achevant la première version en 1917, il la composa en effet dans une continuité avec le Sacre du printemps.
Galerie photo © Laurent Philippe
Cymbalums et masques anti-covid
Par contre, la présence des musiciens et du chœur sur scène correspond effectivement aux intentions de Stravinski. En 1923, Nijinska et Diaghilev les avaient placés dans la fosse. L’instrumentation crée ici un effet d’étrangeté qui nous plonge directement dans l’époque – où Nijinska rejoignit Diaghilev et les Ballets russes depuis Kiev, où elle avait fondé sa propre école de danse pour former les interprètes d’une nouvelle ère chorégraphique. Car Dominique Brun choisit ici la surprenante version de 1919 pour un harmonium, un piano mécanique, deux cymbalums, des percussions, un chœur et quatre solistes, interprétée par l’Ensemble Aedes et cinq musiciens de l’orchestre Les Siècles, les tableaux vivants étant présentés sur des musiques électroniques de David Christoffel. A noter qu’à Chaillot le chœur chantait... avec masques anti-covid.
En raison de la pandémie actuelle, il faut souligner la situation spéciale où la première a eu lieu, même dans la salle Jean Vilar de Chaillot-Théâtre National de la Danse, devant un public très restreint. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle les lignes ci-dessus ne sont pas une « critique ». Disons plutôt que la critique s’est exprimée en 1923 et que pour une pièce hors époque, nous serions hors sujet, n’ayant pas vécu les mêmes guerres. Il y eut notamment André Levinson, fustigeant en 1923 une pièce « marxiste », où la masse avale l’individu. Sans doute aurait-il été ravi, s’il avait pu voir la compagnie Les Porteurs d’Ombre de Dominique Brun réinterpréter cet univers. Car notre époque s’y inscrit notamment par l’individualité des interprètes, forts de parcours et de personnalités divers et variés.
 Le Bolero ? Un Bolero !
Le Bolero ? Un Bolero !
Pas de critique donc, mais beaucoup de matière autour des Noces. Par contre, Brun et Chaignaud assument pleinement maternité et paternité de leur Bolero. Comme dans Les Noces, l’idée de fête est présente quand Nijinska chorégraphie, en 1928, Ida Rubinstein en soliste, dansant sur la table d’une taverne, entourée d’hommes. En confiant ici un solo à François Chaignaud, Brun écarte d’emblée toute idée de reconstitution et laisse à l’interprète les libertés qui sont sa signature, pour composer à partir de son riche parcours.
Trois éléments lient pourtant Un Bolero aux Noces. D’abord, dans la version présentée à Chaillot, le chœur des Noces chante aussi Le Bolero ! Vous avez bien lu! En effet, la partition de Ravel est ici chantée – sauf pour la caisse claire et les cymbalums. Mais le chœur est loin de participer à la mise en scène. On aurait pu l’attendre autour de la table. Par ailleurs, le style campagnard de celle-ci ferait merveille pour le banquet nuptial. Et puis, le costume de Chaignaud, entre tutu et robe flamenca, rappelle ceux des tableaux vivants, en plus vif. Car nous sommes (peut-être, quand même) en Espagne et Chaignaud esquisse parfois un peu de braceo. Fait gicler le jus d’une orange qu’il écrase de sa seule main. Se cabre, se jette au sol...
 En son corps, son visage, ses frappes de pied, ses ongles spectaculaires et autres cabrioles grotesques se chevauchent les esprits de la Rubinstein et du Jorge Donn de Béjart, du baroque de son autre Orlando, du butô des cabarets qu’il a rencontré avec Akaji Maro et même un soupçon de Duchesses, son duo hula hoop avec Marie-Caroline Hominal. Dans toutes ces créations, Chaignaud va au fond de quelque chose qui le dépasse, qui nous dépasse. Il y grandit, il nous grandit. Il nous ouvre un monde.
En son corps, son visage, ses frappes de pied, ses ongles spectaculaires et autres cabrioles grotesques se chevauchent les esprits de la Rubinstein et du Jorge Donn de Béjart, du baroque de son autre Orlando, du butô des cabarets qu’il a rencontré avec Akaji Maro et même un soupçon de Duchesses, son duo hula hoop avec Marie-Caroline Hominal. Dans toutes ces créations, Chaignaud va au fond de quelque chose qui le dépasse, qui nous dépasse. Il y grandit, il nous grandit. Il nous ouvre un monde.
Voici, par contre, Un Boléro dans lequel il ne joue pas selon les mêmes principes. L’idée de départ était de célébrer la Nijinska. Qu’il y creuse une de ses facettes, et il nous emmènerait plus loin. Nous et elle... Seulement, par le brassage, son solo devient un hommage à Chaignaud lui-même. Non pour dire qu’il ne le mérite pas, cet hommage. Mais pourquoi ici ? Même s’il y passe de Kiev à Séville et de Paris à Tokyo, une estrade de l’histoire de la danse n’est pas forcément l’endroit idéal pour un autoportrait. A Chaillot, trop de Chaignaud tua le Bolero. Heureusement, l’histoire continue, et il n’est pas à exclure que dans la version avec orchestre symphonique, disposé au pied de l’estrade, son impact sera autre, la balance moins biaisée. A voir...
Thomas Hahn
Vu le 23 mars 2021, Chaillot-Théâtre National de la Danse / 21eBiennale de danse du Val-de-Marne (représentation réservée aux professionnels)
Catégories:












































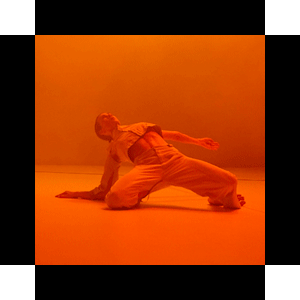





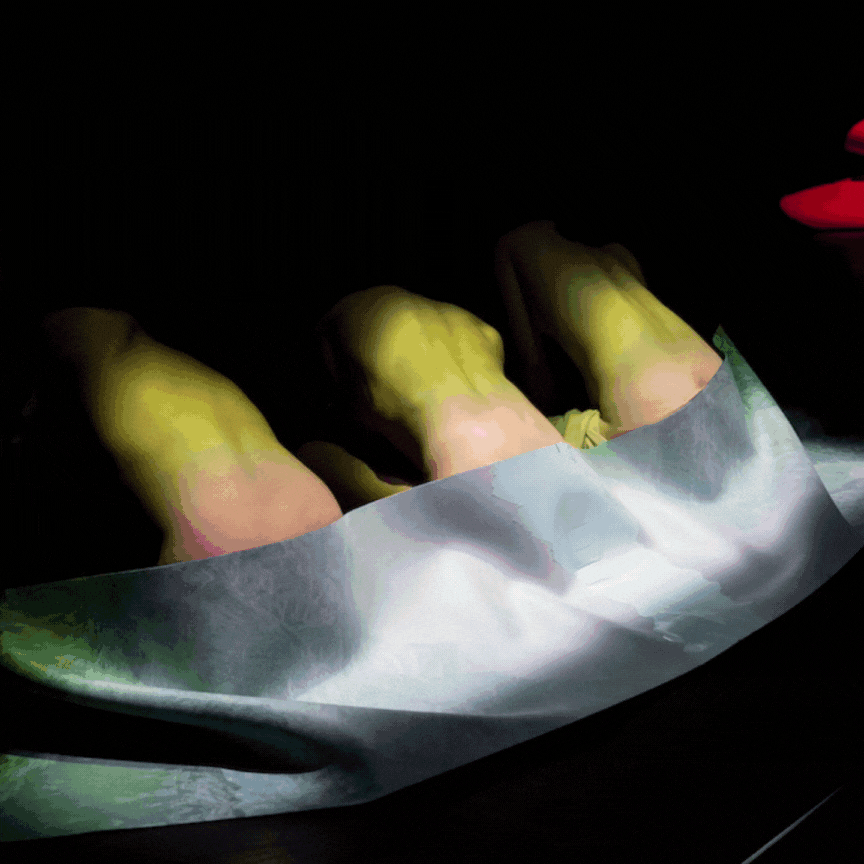






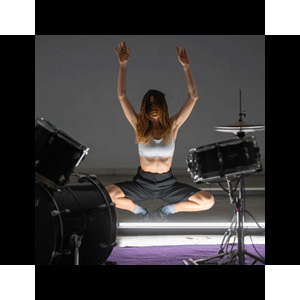

Add new comment