« Alcione » de Marin Marais à l'Opéra Comique
D’abord, il faut dire le bonheur de retrouver une salle au rouge Favart restauré, enfin dotée d’une climatisation efficace grâce à l’installation de 850 ( ! ) bouches d’aération. En réouvrant ses portes le 26 avril après vingt mois de fermeture pour travaux, l’Opéra Comique a de surcroît offert à ses spectateurs le plaisir de découvrir une œuvre jamais jouée en version scénique depuis 1771, Alcione du compositeur Marin Marais.

Pour ressusciter cette ‘tragédie en musique’ en un prologue et cinq actes, créée en 1706 à l’Académie Royale de Musique, Olivier Mantéi, directeur de la salle Favart, a fait appel à une équipe artistique de poids : à la direction musicale le maestro Jordi Savall, spécialiste incontesté du compositeur, dans la fosse et sur le plateau les chœur et orchestre du Concert des Nations, enfin un trio émérite de solistes : Lea Desandre dans le rôle d’Alcione, Cyril Auvity dans celui de Ceix, son futur époux et Marc Mauillon en Pelée, rival jaloux et malheureux.
A la mise en scène, Louise Moaty et Raphaëlle Boitel étaient chargées de donner vie à cette œuvre totale associant, selon la pure tradition baroque, le chant, la danse et des effets que, sans crainte d’anachronisme, on n’hésitera pas à qualifier de spéciaux dans l’esprit des films hollywoodiens. A commencer par la fameuse tempête du IVe acte, attendue comme un morceau de bravoure à chacune des reprises d’ Alcione au XVIIIe siècle.

Venue de l’univers circassien, Raphaëlle Boitel a fort astucieusement relié les cordages, voiles et agrès des navires - Alcione, rappelons-le, est la fille du dieu des vents Eole - à ceux de la machinerie théâtrale et des chapiteaux de cirque. Cela fonctionne, notamment pour souligner l’alternance entre le monde des dieux, au Prologue et à l’Acte IV, et celui des Enfers dans l’Acte II, ou pour évoquer le départ du navire emportant Ceix à l’acte III, et bien évidemment dans la scène de la tempête.
 La chorégraphe rappelle ainsi indirectement l’origine commune de ces machineries complexes, puisque les premiers techniciens d’opéra étaient d’anciens marins habitués à grimper au mât des navires, donc aptes à manœuvrer de lourds décors du haut des cintres. Mais elle souligne aussi - parfois jusqu’à la saturation - la dimension proprement vertigineuse de cet espace musical et esthétique à l’infinie richesse ornementale. Celle-ci, toutefois, va de pair avec une profonde cohérence d’ensemble. Comme sur un vaisseau, chacun ici tient son rôle et concourt à la bonne marche de l’ensemble. Par leurs spirales aériennes ou leurs tournoiements au sol, les huit circassiens-danseurs soutiennent ainsi la trame d’une intrigue aux rebondissements constants.
La chorégraphe rappelle ainsi indirectement l’origine commune de ces machineries complexes, puisque les premiers techniciens d’opéra étaient d’anciens marins habitués à grimper au mât des navires, donc aptes à manœuvrer de lourds décors du haut des cintres. Mais elle souligne aussi - parfois jusqu’à la saturation - la dimension proprement vertigineuse de cet espace musical et esthétique à l’infinie richesse ornementale. Celle-ci, toutefois, va de pair avec une profonde cohérence d’ensemble. Comme sur un vaisseau, chacun ici tient son rôle et concourt à la bonne marche de l’ensemble. Par leurs spirales aériennes ou leurs tournoiements au sol, les huit circassiens-danseurs soutiennent ainsi la trame d’une intrigue aux rebondissements constants.
Hormis quelques brèves occurrences, notamment dans le dernier acte, on peine toutefois à identifier clairement les références avouées de Raphaëlle Boitel à la gestuelle baroque, utilisée ici plutôt comme un « lexique détourné ». En revanche, on s’est amusé à reconnaître, dans la belle scène du mariage de l’acte I, un emprunt - volontaire ? - à la fameuse danse des rubans, revue par Frederick Ashton, de « La Fille mal gardée », créé en 1789 par Dauberval et devenu ensuite le premier ballet classique de l’histoire.
Isabelle Calabre
Opéra Comique, jusqu’au 7 mai.
Catégories:

















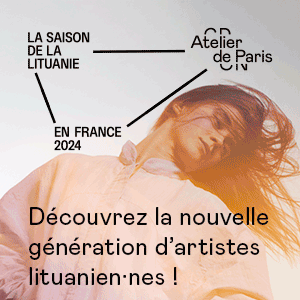







Add new comment