Soirée Sharon Eyal et Mats Ek à l'Opéra de Paris
Vers la mort, une création de Sharon Eyal et la reprise d'Appartement, une pièce créée en 2000 par Mats Ek pour l'Opéra de Paris, constituent un programme bien pensé, avec une distribution exceptionnelle.
Sur le coup, ça peut paraître une drôle d’idée de rassembler dans un même programme deux œuvres aussi différentes que Vers la mort de Sharon Eyal, et Appartement de Mats Ek, qui semblent n’avoir aucune correspondance si ce n’est d’avoir été toutes deux créées pour les danseurs de l’Opéra de Paris, l’une en 2025, l’autre en 2000. Mais, en poussant un peu la réflexion, il s’avère que ces deux pièces parlent d’amour, mais pas de vie en rose.

La première, d’une beauté sombre et fascinante, s’inspire d’une des pièces précédentes d’Eyal, OCD Love, construite à partir d’un texte du poète Neil Hilborn décrivant une relation dans laquelle une femme amoureuse finit par être exaspérée des troubles obsessionnels compulsifs (OCD en anglais) du narrateur. La seconde ironique, drôle et grinçante, raconte l’amour au quotidien d’êtres seuls ou en couple – Appartment signifiant aussi en anglais « séparation » et « isolement » - une suite des petits drames de la vie, conjugale ou pas.
Galerie photos Vers la mort © Laurent Philippe
Vers la mort s’ouvre, comme pour OCD Love, dans la pénombre, sur le solo d’une danseuse, gainée d’une tunique et d’un collant chair, tout en extensions et étirements, enserrée dans un halo de lumière blafarde, articulant chacun de ses mouvements à l’extrême, poussant le vocabulaire classique dans ses retranchements. Bientôt un homme entre en faisant le tour du plateau, il tient un bras devant l’autre ouvert, comme s’il tenait un grand instrument. Il va vers elle mais l’évite en la contournant, reprenant sa marche horlogère et indifférente, évoquant le port altier d’un centaure, tandis qu’elle se tord dans une gestuelle brisée, en pliés ramassés, avant de se cabrer de nouveau, ou de s’allonger en cambrés élégiaques.
Galerie photos Vers la mort © Laurent Philippe
D’une certaine façon, tout est dit dans cette introduction très caustique, qui oppose à un mâle un peu fat, qui répète sans cesse le même chemin, à une femme blessée. Un quatuor (trois hommes/une femme) vient rompre ce hui-clos, portant une femme comme on transporte une armoire, à moitié à l’horizontale que l’on redresse, puis se lançant dans des unissons en miroir. De nombreuses figures issues du vocabulaire classique parsèment cette chorégraphie, tout en hyperextensions du dos, des bras, utilisant indifféremment la gestuelle Gaga apprise chez Naharin ou des figures classiques. On retrouve bien sûr toutes ces variations chorégraphiques dans les ensembles. À tel point que Vers la mort a parfois des allures de Balanchine revisité, parfois fluide, parfois cassant, mais jouant toujours sur la désarticulation et la réarticulation des corps.
Galerie photos Vers la mort © Laurent Philippe
Il faut ajouter que Sharon Eyal s’est manifestement inspirée des corps et des techniques des interprètes du Ballet. Du coup, cette création, tout en gardant les mêmes principes, s’émancipe d’OCD Love, substituant aux piétinements usuels d’Eyal une gestuelle plus riche et plus inattendue, mixant grands jetés, retirés ou tours, voire petite batterie, avec des enchevêtrements et des mouvements tranchants, arrêtés dans l’élan avec une précision de scalpel. D’une virtuosité époustouflante, d’une maîtrise parfaite, les danseurs et danseuses de l’opéra campent une humanité mystérieuse, d’où surgissent d’impossibles chimères, d’ambigus désirs, dans une atmosphère sombre et grave, mais où subsiste toujours cette satire du mâle narcissique, dans des duos brutaux, comme une chanson d’amour « triste ou folle ».

Beaucoup plus subtile dans ses intentions, la chorégraphie de Mats Ek pour Appartement distille une tragi-comédie, laissant le spectateur toujours au faîte d’une situation prête à basculer dans l’un ou l’autre registre. Ici, la construction dramaturgique de chaque séquence est un travail d’orfèvre où chaque geste s’enchâsse avec l’autre pour donner du relief à la chorégraphie et ciseler le récit de ses multiples significations simultanées. Et même si le vocabulaire de Mats Ek, avec ses grands pliés, sa gestuelle ample et souple, ses mouvements habilement contrariés, est reconnaissable entre tous, sa syntaxe est travaillée de manière à faire sens. Mais le plus étonnant est que, contrairement à ce que l’on peut voir aujourd’hui chez de nombreux chorégraphes, la composition ou les fils de la fabrication, sont totalement invisibles. Pas la moindre démonstration de savoir-faire, de mise en exergue de la forme.
Donc onze séquences se succèdent, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, entremêlant la danse et la vie, dans un seul et même mouvement. Il faut ajouter ici qu’une pléiade d’étoiles et de Premiers danseurs et Premières danseuses composent cette distribution hors normes ! De même, la scénographie qui place en majesté le rideau de l’Opéra, la musique jouée sur scène par le Fleshquartet, les costumes et décors de Peder Feiiij et les lumières d’Erik Berglund, contribuent à faire de cette pièce une réussite absolue, convoquant le surréalisme d’un René Magritte, l’absurde d’un Eugène Ionesco, la noirceur d’un August Strindberg. Le tout sans oublier un humour presque clownesque et une poésie d’où peut surgir un coup fatal. Mais surtout, chez Mats Ek, il est presque toujours question de lutte contre l’oppression, et Appartement ne déroge pas à la règle.

Ainsi s’ouvre cette chorégraphie sur « La Salle de bain » et surtout la variation du « bidet » dansé par Ludmilla Pagliero. D’abord engoncée dans son corps devant l’objet, la voici qui se déploie dans cette ampleur, si caractéristique du chorégraphe Suédois, tournant autour de la « chose » au sens propre comme au figuré, passant furtivement une main entre ses cuisses, elle danse les pensées contradictoires que suppose l’intimité liée à cet objet, avant que quatre comparses (Marc Moreau, Jack Gasztowtt, Antoine Kircher et Pablo Legasa) n’en donnent une version beaucoup plus jazzy, aérienne, et plus « fun » ! Mais qui finit mal. S’ensuit la séquence de « La Télévision ». Sur un fauteuil conçu spécialement pour l’avachissement, un homme (Hugo Marchand) est littéralement hypnotisé par les images du poste. Il leur parle, s’énerve, et retourne s’affaler dans son siège. La gestuelle est étrange à souhait, jouant d’une gestuelle se contredisant sans cesse, façon très fine de signifier que son corps ne lui appartient plus. L’autre indice étant son costume à « pustules » qui nous dit à quel point cet homme est mal dans sa peau.
Galerie photos Appartement de Mats Ek © Agathe Poupeney / OnP
Pour la scène de « La Cuisinière » c’est la femme (Valentine Colasante) dont le costume est hérissé de protubérances bizarres, et les tenues grisâtres donnent un aperçu de ce couple banal aux bustes courbés, mais non dénué de désir, avec leurs enlacements souples, et quelque chose de tout à fait « tordu » dans leurs gestes … aussi cruels que la fin de cette « fable ». Le trio réunissant Germain Louvet, Antoine Kirscher et Daniel Stokes, est à la fois poignant, tendre et fraternel, et joue comme contrepoint avec le duo formé par Hannah O’Neill et Pablo Legasa, beaucoup plus drôle. Enfin, la « Marche des aspirateurs », sur une fausse écossaise joué par le Fleshquartet est un morceau d’anthologie contre l’oppression ménagère.
La suite du ballet mérite d’être soulignée, car même si tout ce qui précédait était burlesque, mais avec sa marque d’ordinaire, cette partie nous fait entrer dans un autre monde. Plus onirique. Comme ce fascinant duo « des embryons » ( ?) dansé par Germain Louvet et Antoine Kirscher, suivi de celui de « La Porte », dansé par Ida Viikinkoski et Marc Moreau. Tous deux sont émotionnellement intenses, ils roulent, glissent, ondulent, s’accrochent, s’accordent ou s’étreignent, c’est beau à couper le souffle et triste à en pleurer à la fois.

Avant le final, Mats Ek a eu l’intelligence de laisser le spectateur reprendre son souffle. Les danseurs et danseuses quittent le plateau, seul le Fleshquartet joue derrière des rubans de scotch de chantier. Ceux-ci symbolisent un passage piéton. « Il se situe, en réalité, nous dit Mats Ek, devant le bistro Mistral, juste à côté du Théâtre de la Ville, où, durant de nombreuses années, j’ai eu maintes occasions d’observer le théâtre banal des piétons ». Et c’est là l’origine, qui a permis au chorégraphe de tisser à partir de là, un vrai chef-d’œuvre chorégraphique. Chapeau !
Agnès Izrine
Vu le 27 mars 2025. Jusqu'au 18 avril 2025. Opéra Garnier.
Distributions
Vers la mort
Chorégraphie et costumes : Sharon Eyal
Co-création costumes : Gai Behar
Musique : Ori Lichtik
Lumières : Thomas Dreyfus
Assistant à la chorégraphie : Léo Lérus
Interprètes : Naïs Duboscq, Caroline Osmont, Nine Seropian, Adèle Belem, Marion Gautier de Charnacé, Mickaël Lafon, Yvon Demol, Nathan Bisson, Julien Guillemard.
Appartement
Chorégraphie : Mats Ek
Musique : Fleshquartet (Jonas Lindgren, Örjan Högberg, Leo Svensson Sander, Christian Olsson)
Décors et costumes : Peder Freiij
Lumières : Erik Berglund
La Salle de bain : Ludmilla Pagliero, Marc Moreau, Jack Gasztowtt, Antoine Kirscher, Pablo Legasa
La Télévision : Hugo Marchand
Le Passage piéton : Hannah O'Neill, Clémence Gross, Ida Viikinkoski, Germain Louvet, Marc Moreau, Antoine Kirscher, Pablo Legasa, Daniel Stokes
La Cuisine : Valentine Colasante, Jack Gasztowtt
Trio-Pas de deux : Germain Louvet, Antoine Kirscher, Daniel Stokes
Valse : Hannah O'Neill, Pablo Legasa, Valentine Colasante, Jack Gasztowtt, Ludmilla Pagliero, Hugo Marchand, Ida Viikinkoski, Marc Moreau
La Marche des aspirateurs : Valentine Colasante, Hannah O'Neill, Ludmilla Pagliero, Clémence Gross,Ida Viikinkoski
Duo des embryons : Germain Louvet, Antoine Kirscher
La Porte : Ida Viikinkoski, Marc Moreau
Police Tape : Fleshquartet
Catégories:
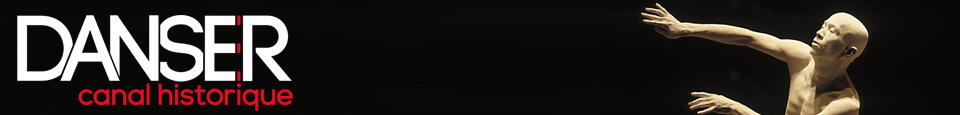
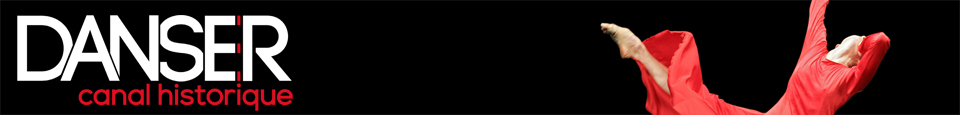




















































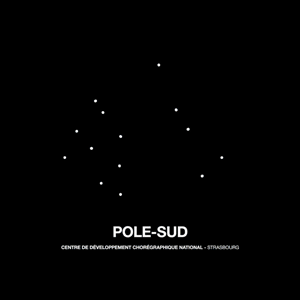








Add new comment