Romeo Castellucci : « Democracy in America »
Un spectacle d’une beauté époustouflante, aux allures de fresque picturale, inspiré par l’esprit de l’essai de Tocqueville, saturée d’images à décrypter, le tout avec une distribution exclusivement féminine.
Democracy in America de Romeo Castellucci ouvre comme à la parade, avec des sortes de majorettes à clochettes qui composent et décomposent des mots ou des phonèmes en maniant avec dextérité leurs drapeaux marqués chacun d’une lettre. Partis d’ « aerodynamic ceramic » en passant par « cocain army medicare » nous voici arrivés quelques virevoltades plus loin à « Democracy in America ». Castellucci, comme souvent, procède par « images-valises ». Dans cette première scène s’accumulent déjà les pom-pom girls mais vêtues d’un uniforme sudiste, la comédie musicale à la Busby Berkeley, le goût très yankee du drapeau et les défilés récurrents des minorités composant l’American Dream sur la 5e Avenue de la communauté polonaise aux irlandais de la Saint-Patrick en passant par le nouvel an Chinois.

Mais dans ce « melting pot » où une culture chasse l’autre, où les mots se cherchent sans toujours se trouver, on arrive vite au cœur même de la démocratie : à savoir le pacte implicite d’un langage commun pour cimenter ce système politique toujours fragile, notamment « au risque de tyrannie de la majorité », comme le signale Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique » dont Castellucci a tiré son titre.
Cette question du langage est centrale dans cette œuvre. Dès le début, juste après les jeux de mots Castellucci nous fait entendre des « glossolalies » ces prières pentecôtistes décrites comme « parler en langues » dans les actes des apôtres, ou délire d’une parole qui prononce des mots inintelligibles, censés n’être compris que de Dieu. Bientôt, un dialogue entre deux indiens Obijwe pose la question de la langue du colon. L’un s’appliquant à apprendre l’anglais pour s’adapter, l’autre voulant résister au motif que « leurs mots ne disent pas nos choses ». Vaste question de l’assimilation, vite résolue dans le monde réel par l’extérmination des indiens. Enfin, c’est le tétragramme de Dieu, innommable en Hébreu selon la tradition, descendant suspendu des cintres, qui va être le deuxième fil conducteur de cette Amérique naissante. Ainsi deux pauvres paysans en plein doute sur leurs prières, si pauvres qu’il a vendu son cheval et elle leur fille, décident d’appeler Dieu : « je suis », référence à l’ancien Testament qui le désigne comme « je serai qui je serai» ou « je suis qui je suis » dans l’Exode.
Nouant les fils comme autant de points, le motif finit par apparaître sur le tapis multicolore que tisse sous nos yeux Castellucci, et fait surgir l’essence de l’Amérique réelle ou imaginaire. Une Amérique puritaine, où les lois sont rigoristes car garanties par la Bible, où les non-dits sont partout, et la peur, rampante. Une Amérique de colons, de congrégations, presque de sectes, en quête de Terre Promise, pour qui la question du territoire est vitale et celle du péché, primordiale. Il y a du blasphème, il y a un sabbat de sorcières en frous-frous roses un peu osés, Salem n’est jamais loin, le jardin du bien et du mal non plus. Castellucci nous fait voir, sans jamais les montrer, les prolongements de ces origines tumultueuses, du second amendement au ku kux klan, du mythe du self made man à l’égotisme triomphant. Et au-delà, se peint en filigrane les problèmes bien actuels de nos démocraties d’aujourd’hui, aux prises avec le retour du religieux ou le délitement d’un langage (et d’une culture) commun.e nécessaires à en comprendre les enjeux.
Mais la force de Castellucci tient tout autant à son talent de plasticien qu’à celui de l’homme de théâtre. Et de ce point de vue, le spectacle est grandiose et traverse toutes l’histoire de l’art occidental, d’une fresque grecque au cinémascope, en passant par une évocation (volontaire ?) des monochromes de Rothko, à des anges rouges et or à la Fra Angelico, en passant par Millet ou autres, enfouis dans notre inconscient pictural. Chaque détail est signifiant et les images produites s’amalgament ou s’étoilent, prolongeant les effets de discours. C’est d’une beauté à couper le souffle, brassant l’idée de l’Amérique et celle de la Démocratie, le mythe américain et la mystique divine. À la fin, l’inconnu déploie une mécanique abstaite dans le ciel ou forment les lettres d’un mot illisible. Le mystère reste entier.
Agnès Izrine
Le 18 octobre 2017. MC93, Maison de la Culture de Bobigny
Mise en scène, décors, costumes, lumières, Romeo Castellucci
Librement inspiré du livre d’Alexis de Tocqueville
Avec Olivia Corsini, Giulia Perelli, Gloria Dorliguzzo, Evelin Facchini, Stefania Tansini, Sophia Danae Vorvila et un ensemble de douze danseuses : Nais Arlaud, Stéphanie Bayle, Sara Bertholon, Adèle Borde, Maria Danilova, Ambre Duband, Fabiana Gabanini, Flavie Hennion, Juliette Morel, Marion Peuta, Flora Rogeboz, Azuza Takeuchi, Marie Tassin
Textes, Claudia Castellucci et Romeo Castellucci
Musique, Scott Gibbons
Chorégraphies librement inspirées par les traditions folkloriques d’Albanie, de Grèce, du Botswana, d’Angleterre, de Hongrie, de Sardaigne, avec des interventions chorégraphiques d’Evenlin Facchini, Gloria Dorliguzzo, Stefania Tansini, Sophia Danae Vorvila
Assistante mise en scène, Maria Vittoria Bellingeri
Mécanismes, sculptures de scène et prothèses, Istvan Zimmermann, Giovanna Amoroso
Réalisation des costumes, Grazia Bagnaresi
Chaussures, Collectif d’Anvers
Régisseur Plateau, Daniele Ferro
Machinistes, Andrei Benchea, Pierantonio Bragagnolo
Technicien lumières à la consolle, Marco Alba
Technicien du son à la consolle, Paolo Cillerai
Habilleuse, Elisabetta Rizzo
Photographe de scène, Guido Mencari
Direction technique, Eugenio Resta
Catégories:


















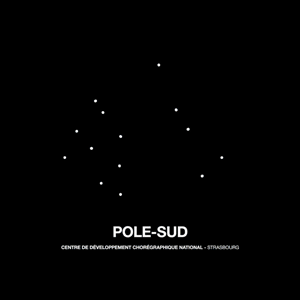









Add new comment