Pour une histoire vraie du répertoire
Le répertoire est la bouteille à l’encre de la danse.
Opposé systématiquement à la création contemporaine, il est considéré comme l’apanage de la danse classique… Or, rien n’est plus faux.
On assimile souvent le répertoire à la danse classique. On a même pu lire récemment que « À l’opposé du ballet classique, le contemporain a longtemps été réfractaire au répertoire », véhiculant l’idée que le ballet a « conservé » son répertoire de siècle en siècle. En réalité, le seul ballet donné sans interruption depuis sa création en 1871 est Coppélia, rafraîchi par Michel Descombey dans une version très personnelle en 1966, puis confié à Pierre Lacotte pour en retrouver sa saveur « originelle » en 1973. 1973 ?
C’est l’année où Carolyn Carlson est invitée à l’Opéra de Paris en tant qu’étoile-chorégraphe, celle de la création d’ Un Jour ou deux de Merce Cunningham pour ce même Opéra, qui entre donc au répertoire un an avant La Belle au bois dormant. De quoi bousculer pas mal d’idées reçues concernant la danse classique considérée comme parangon de la tradition conservatrice.
Un Jour ou deux de Merce Cunningham
Mais alors, qu’est-ce qu’ils dansaient avant ? La réponse est simple : des créations. Mieux, il ne serait venu à l’idée de personne de s’amuser à reprendre des ballets – fussent-ils des chefs-d’œuvre – datant de plus de cent ans et l’incontournable Giselle (1841) abandonnée en 1868 serait tombée dans l’oubli si Marius Petipa ne l’avait pas conservée, moyennant quelques aménagements, en Russie.
L’idée même de répertoire, en France, est donc une notion résolument moderne, née en même temps que la danse du même nom et que la venue des Ballets russes à Paris.
 Car ce sont eux qui ont ramené la fameuse Giselle version Marius Petipa dans leurs bagages à l’Opéra de Paris en 1910 (année du décès de Petipa, donc encore contemporaine), et qui constitue la première pièce de danse à s’inscrire dans une vision patrimoniale. Serge Lifar sera d’ailleurs le premier à la réinscrire au répertoire de l’Opéra en tant que directeur de la danse en 1932.
Car ce sont eux qui ont ramené la fameuse Giselle version Marius Petipa dans leurs bagages à l’Opéra de Paris en 1910 (année du décès de Petipa, donc encore contemporaine), et qui constitue la première pièce de danse à s’inscrire dans une vision patrimoniale. Serge Lifar sera d’ailleurs le premier à la réinscrire au répertoire de l’Opéra en tant que directeur de la danse en 1932.
Un engouement aussi tardif que suspect
On peut s’interroger sur l’engouement que le répertoire va susciter un demi-siècle plus tard, devenant même le cheval de bataille de nombre de chorégraphes contemporains cherchant à préserver par tous les moyens (vidéos, films, notations…) la pérennité de leurs œuvres. Comme si le « devoir de mémoire » avait envahi tous les secteurs de notre société, et que la danse, longtemps considérée comme art de l’éphémère, se devait brusquement de conserver ses traces ou de regarder en arrière.
En réalité, la question est suffisamment complexe pour susciter de multiples explications.
La première tient d’abord aux danseurs. C’est sur eux que sont créés les ballets qui deviendront le répertoire de demain… qui est donc soumis à leurs formes et à leurs possibilités physiques. On piquerait sans doute un fou-rire si l’on voyait aujourd’hui Le Lac des cygnes dansé comme en 1895.

La seconde est banale : c’est le syndrome espèces en voie de disparition. L’accélération du temps, la vitesse, les mutations rapides qui sont le propre du XXe siècle nous ont sans doute incité à nous pencher sur notre passé avant qu’il ne soit trop tard.
La troisième est circonstancielle : la démocratisation de la culture implique des œuvres de référence rendues visibles par le plus grand nombre, ouvertes au public, donc un patrimoine à montrer.
La quatrième plus paradoxale, tient à la notion d’œuvre et donc d’auteur. Il n’est pas anodin que ce soit Serge Lifar, l’un des premiers à revendiquer haut et fort le statut de « choréauteur » qui ait remis Giselle à l’honneur.
 De fait, les premiers à vouloir modifier cette conception de la danse – considérée comme « art mineur », furent bien entendu les créateurs. Pour entrer dans l’Histoire encore faut-il en avoir une, tout comme il faut une œuvre pour se hisser au statut d’auteur – donc un répertoire ! On comprend mieux pourquoi cette idée date du XXe siècle : elle est consubstantielle à l’essor de la création contemporaine et de la prise de conscience de la singularité de chaque chorégraphe. Répertoire et création sont donc, d’une certaine façon, les deux facettes du même souci de reconnaissance de la danse en tant qu’art majeur et sont plus inséparables qu’il n’y paraît.
De fait, les premiers à vouloir modifier cette conception de la danse – considérée comme « art mineur », furent bien entendu les créateurs. Pour entrer dans l’Histoire encore faut-il en avoir une, tout comme il faut une œuvre pour se hisser au statut d’auteur – donc un répertoire ! On comprend mieux pourquoi cette idée date du XXe siècle : elle est consubstantielle à l’essor de la création contemporaine et de la prise de conscience de la singularité de chaque chorégraphe. Répertoire et création sont donc, d’une certaine façon, les deux facettes du même souci de reconnaissance de la danse en tant qu’art majeur et sont plus inséparables qu’il n’y paraît.
Patrimoine et danse d’auteur
À ce titre, on s’étonnera moins de constater que la constitution d’un « patrimoine » chorégraphique s’amplifie au même rythme que se développe la danse contemporaine en France tandis que nos institutions donnent peu à peu à la danse une place plus prépondérante. Ainsi c’est en 1973 que la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) accorde enfin aux chorégraphes un statut d’auteur à part entière. Et les dix ans d’expansion inouïe de la danse contemporaine en France (1982-1992) correspondent à la mandature de Noureev (1983-1992) à l’Opéra de Paris qui s’empressera de revisiter et d’inscrire tous les chefs-d’œuvre perdus de Petipa à son répertoire.
Ce couplage bipolaire aura des conséquences inattendues mettant en tension interprétation et création, danseur et chorégraphe, classique et contemporain, conservation et conservatisme, élitisme et démocratisation… et invitera le milieu de la danse à se questionner, sinon à prendre position. Car, on le devine, à travers cette question se pose celle de toute la structure de l’art chorégraphique et de ses enjeux : création, transmission, évolution, interprétation, préservation…
Agnès Izrine










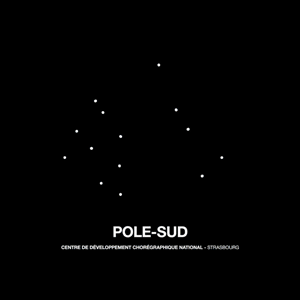







Add new comment