Montanari : Le grand entretien
Passionnant, intelligent, sincère, Jean-Paul Montanari éclaire son histoire avec Montpellier Danse qui croise, bien évidemment, celle de la danse.
 DCH : Qu’est-ce qui a présidé à votre engagement dans cette aventure de Montpellier Danse ?
DCH : Qu’est-ce qui a présidé à votre engagement dans cette aventure de Montpellier Danse ?
Jean-Paul Montanari : Je suis entré dans la danse, il y a presque un demi-siècle, car j’avais senti que l’écriture du corps pouvait apporter quelque chose de radicalement neuf dans la représentation. Pour moi, qui venait de la littérature, elle survenait comme une création aussi essentielle que l’écriture des mots, que la nécessité de la langue. L’écriture des danses étant un langage, il était nécessairement produit par des auteurs. Ainsi s’est défini mon univers chorégraphique et je ne m’en suis jamais échappé. Ces auteurs, tous ceux qui fréquentent Montpellier Danse les connaissent, et savent quel style me passionne. Ça a commencé par les Américains, Merce Cunningham, Trisha Brown et Lucinda Childs, que j’ai découverte grâce à Einstein on the beach de Bob Wilson, en 1976 en Avignon – même si je sais parfaitement qu’une partie de la danse était signée Andy DeGroat – mais tout démarre là. Parce que cette modernité américaine me rattachait à ce que j’aimais le plus dans la littérature de l’époque. Et puis, il a bien fallu s’accrocher à cette génération de la danse française en train de surgir, encore sous influence américaine mais pas tant que ça. Voire pas du tout. Car à part Michel Hallet-Eghayan et Kilina Cremona, les grandes équipes comme celle de Dominique Bagouet ont jailli. Avec cette question, qui était forte alors, pour définir cette danse : art de divertissement ou art majeur ? La danse pouvait-elle, au même titre que la peinture, la musique ou la littérature, écrire le monde qui l’entourait ? Cela a été vrai longtemps. À l’heure où nous parlons, je suis persuadé que c’en est terminé. Ce grand moment de l’histoire de l’Art que l’on a nommé danse contemporaine, est en train de s’achever, car nous sommes revenus d’une certaine manière au XIXe siècle, à des danses divertissantes, très agréables à regarder et qui ne racontent pas grand-chose, sauf le rythme peut-être, ou une manière d’illustrer la musique, ou encore de participer à un certain événementiel.
J’ai été frappé par le Concours de l’Eurovision, où toutes les performances étaient accompagnées de chorégraphies pas si mal dansées, avec une sorte d’exigence et d’imagination. Et ma foi, c’est peut-être le prix que la danse a dû payer pur devenir populaire. Il faudrait creuser, mais enfin, tant que cette question de l’écriture l’étreignait, elle était élitiste, indéniablement, comme la recherche en biologie, en médecine ou en informatique. Pourtant c’est ce qui avait justifié l’idée de mettre plus de moyens sur la danse, dernière arrivée des arts de la scène. Qui représente, encore maintenant, le dixième des budgets qui concernent la musique, la moitié de ceux du théâtre, alors qu’elle suscite davantage de spectateurs pour la danse.
DCH : Quel est le secret du succès d’un festival comme Montpellier Danse ?
Jean-Paul Montanari : Je crois faire toujours le même festival, que je creuse et approfondis à chaque fois, avec quelques variantes, mais l’essentiel est toujours identique, je n’aurais pas programmé une quarantaine d’éditions et environ vingt-cinq saisons sans le savoir. C’est ainsi que l’on développe sa relation avec les artistes. Je suis sidéré par l’effet éphémère de l’apparition – et de la disparition – des chorégraphes sur le « marché ». Au point que nous n’arrivons plus à nous souvenir d’un nom qu’il est déjà remplacé par un autre à une vitesse extravagante. Ce phénomène existe depuis longtemps, mais il s’est tellement accéléré, que le côté jetable de l’artiste se révèle au grand jour.

Un festival est fait de constantes. C’est le temps qui m’a permis de construire tout cela, et le fait de présenter régulièrement les mêmes auteurs chorégraphiques, car ce sont ceux auxquels je crois. Cunningham qui va clore cette édition, comme Bagouet l’année dernière, des auteurs comme Wayne McGregor ou Angelin Preljocaj, qui écrivent, indéniablement de la danse. Nous allons retrouver Anne Teresa De Keersmaeker, c’est la dix-sept ou dix-huitième fois qu’elle vient à Montpellier, ce qui est normal, il aurait dû y avoir la Batsheva Dance Company à laquelle nous avons renoncé pour des raisons politiques mondiales. Tout le monde se souvient de Raimund Hoghe, qui a présenté quinze fois son travail, idem avec Emanuel Gat, Mathilde Monnier, Dominique Bagouet, bien sûr, et de nombreux autres. Mais il n’existe pas d’autres moyens, pour comprendre l’univers d’un artiste important, que de fréquenter son œuvre. Comme pour la littérature. Il faut lire plusieurs livres d’un même écrivain pour saisir son univers, son style, l’évolution de sa pensée. Et au fond, il n’y a que ça qui m’intéresse. Passer un bon moment à un spectacle de danse n’a aucun sens pour moi. Je n’en ai pas besoin. Je m’intéresse à la danse parce qu’elle dit quelque chose de fort, de fondamentalement différent des autres arts. Elle est très particulière, énigmatique. Elle renvoie à un inconnu, une recherche, à une intériorité, à un mystère qu’elle est la seule à développer à ce point.

Ensuite, les temps peuvent changer. Nous voyons bien que ce ne sont plus les préoccupations des chorégraphies actuelles. Toute ambiguïté a disparu. Pour certains l’argent est primordial – et pourquoi pas ? Les temps sont durs – pour d’autres, l’image rapide, vite assimilable, comme le sucre du même nom, est devenue l’étalon auquel comparer tout le reste. Mais il existe une telle pression, des réseaux sociaux, de la télévision, sur l’acte de danser, que finalement, il n’est pas étonnant que ça file de ce côté-là. Enfin, ceux qui ont le désir, et le talent, pour écrire une œuvre, ou du moins une histoire autour de cet art, ne sont pas ceux qui sont préférés, ni ceux auxquels sont confiées des institutions ou attribués des moyens importants. Je le regrette.
DCH : Vous pratiquez une sorte de programmation performative : ils sont connus, ou importants, parce qu’ils passent à Montpellier Danse, et non l’inverse…
Jean-Paul Montanari : Et j’en suis assez content. Mais il est normal, qu’après quelques exercices, ils partent dans d’autres grands festivals. Ça a été le cas de ceux cités précédemment, et de beaucoup, beaucoup d’autres…
Avec le temps Montpellier Danse est devenu un endroit de prescription, mais surtout, ma curiosité ne s’est jamais éteinte. Si je continue encore à voyager, au Canada, à Tel-Aviv ou Marrakech, c’est que j’y découvre encore de jeunes gens et jeunes filles, qui portent des propositions étranges, que je n’ai jamais vues, et pour lesquelles je perçois une sorte d’effraction dans le présent, une rupture, une nouveauté radicale. Je pense, dans un sourire, que mon grand âge me procure d’autant plus de perspicacité pour observer ce qui est en train de se passer. Mais je ne suis jamais dupe. Soudain, je vois répéter Armin Hokmi ici, en résidence, et en moins de dix minutes sa danse m’intrigue tellement, qu’à la sortie de la répétition, alors que la programmation était quasiment bouclée, je l’engage dans le festival. Pour voir. Comme au poker. Je n’aime que ce risque-là. Et ça ne s’apprend pas. Il n’y a aucune explication. C’est un feeling. Comme pour les galeristes qui sentent à la première visite d’atelier le peintre qu’il faut suivre. Ou Jérôme Lindon à qui je pensais ce matin, qui aura eu deux prix Nobel de littérature à son palmarès alors que tout ce qu’il a édité était d’une difficulté invraisemblable.

Donc, c’est le piment d’un festival, et peut-être la réussite de ce truc appelé Montpellier Danse. Cette addition de la mémoire, des artistes que j’estime, et ces moments de découverte absolue de gens qui viennent des quatre coins du monde, ou d’à-côté d’ailleurs, peu importe. Évidemment, j’ai certains goûts, par exemple pour les artistes iraniens. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me trouble profondément dans cette civilisation perse qui a été l’une des plus grandes du monde. Même si la situation politique que traverse l’Iran en ce moment est épouvantable pour les artistes et pas seulement pour eux !
DCH : À ce sujet, vous écrivez dans votre édito du dossier de présentation du festival que « ce festival n’est pas seulement international (il l’a toujours été) : il est cosmopolite. » International et cosmopolite, ce n’est pas la même chose, que mettez-vous derrière ces mots ?
Jean-Paul Montanari : C’est même le contraire, en tout cas, ce n’est pas la même chose. Nous sommes dans une zone médiatique qui tourne autour des Jeux Olympiques en France, et ce, jusqu’à la fin de l’été. Très bien. C’était une sorte de clin d’œil. La différence, c’est qu’international c’est une juxtaposition de nationalités, et cosmopolite, un mélange. Donc, quand on choisit la proposition d’un Josef Nadj, né en Voïvodine, dans l’ancienne Yougoslavie, mais qui parle hongrois, et vit aujourd’hui à Budapest, après avoir dirigé un Centre chorégraphique national français et avoir été l’un des artistes les plus en vue de sa génération, et qui, pour cette édition, crée avec un groupe de danseurs africains dont la plupart sont en exil en Europe… Plus cosmopolite, est impossible ! D’autres portent en eux leur cosmopolitisme, comme Arkadi Zaides, né en Biélorussie, vivant quasiment en émigré en Israël, puis s’installant en France, avant d’habiter en même temps à Bruxelles. Ce sont ces artistes qui m’intéressent le plus, car ils charrient en eux des mémoires différentes, des réflexions sur des espaces hétéroclites, sur la solitude. Car au fond, le cosmopolitisme, c’est le contraire du nationalisme, le contraire de la guerre. Ce qui vibre en pointillé derrière cette phrase, c’est que nous sommes confortablement installés à l’Agora, bouffés par la terreur de la guerre, qui est d’ailleurs, comme le reste, mondialisée. Car elle n’est pas circonscrite à l’Est de l’Ukraine ou entre le Jourdain et la Méditerranée, elle se passe aussi chez nous, sous l’angle télévisé, sous celui des perturbations numériques et informatiques avec lesquelles certains pays nous agressent, donc il s’agit d’une déstabilisation mondiale, parce que, pendant ce temps là, la guerre continue au Darfour, et partout…

Je suis suffisamment vieux pour avoir vécu un autre temps, où l’on a cru, étrangement, comme pour la danse contemporaine sans doute, que la relative paix que nous avons vécue après la Deuxième Guerre mondiale, était l’état normal du monde. En fait, l’état normal du monde, c’est la guerre ! La paix arrive après une énorme déflagration, la monstruosité de ce qui s’est passé dont peut-être, l’humanité ne se remettra jamais, ni de la Shoah, ni des crimes de Staline, ni d’Hiroshima. Peut-être est-ce la fin de ce que nous avons connu. Aujourd’hui, tout est terrifiant, en Ukraine, en Israël le 7 octobre, ou à Gaza. Donc je veux bien organiser un festival de danse, mais j’ai des doutes. Je n’ai pas de culpabilité, mais j’en ai la conscience. Je suis chargé d’une mission, par la Ville de Montpellier, soutenue par le ministère de la Culture, la Région, et les autres tutelles, je la mène jusqu’au bout. Un énorme public nous suit et nous soutient, c’est tellement rassurant, les salles sont pleines…
DCH : Par rapport à cette mémoire de la Guerre qui a permis de la tenir à distance, pendant presque 80 ans, cette danse de divertissement dont vous parlez, n’est-elle pas aussi la conséquence de cette perte de mémoire, qui fait que les enjeux qui ont présidé à l’avènement d’une danse contemporaine sont effacés ?
Jean-Paul Montanari : Nous sommes d’accord. Sans paraître passéiste, il est vrai que nous avons connu une perspective artistique de très haut niveau, avec une réflexion sur le temps, l’espace, l’énergie. Mais aujourd’hui, personne n’a d’intérêt pour ça. Tik Tok nous a tués. Et même si, dans le hip-hop, il existe de vrais auteurs qui ont quelque chose à dire, comme Kader Attou et Mourad Merzouki, que nous avons défendus et tout de suite accueillis, avec Guy Darmet, Christian Tamet et Olivier Meyer, et je m’en félicite, c’est aussi une technique codifiée – au même titre que la danse classique – qui travaille, disons moins sur la pensée, que sur le plaisir de danser, d’être sur la musique, sur la performance physique. Alors, qu’aujourd’hui ça prenne la quasi-totalité du marché, est un peu angoissant. Il n’y a plus de place pour le reste. Je ne suis pas certain que la majorité des Centres chorégraphiques devraient être confiés à des gens du hip-hop. Même si, de nouveau Kader et Mourad ont fait leurs preuves. Mais actuellement, il existe un glissement de ces structures vers l’animation en général, vers le gratuit, vers le populaire. Je suis très dubitatif.

Je brandis toujours la métaphore de la télécommande. Pourquoi la majorité des gens appuient-ils plutôt sur le 1 ou le 8 et non sur le 7 ? Ils pourraient. Arte coûte le même prix. Ils vont sur le 1 ou le 8 parce que c’est plus divertissant. Ils sont fatigués. Ils n’ont pas envie de réfléchir. Maintenant, quelle est la personne, réellement de gauche, ou simplement éduquée, qui préférera le système commercial de la 1, à celui, plus intelligent, plus sérieux de la 7 ? Or, dans les arts du spectacle, par une sorte de culpabilité, les élus ont peur du reproche de donner de l’argent à des intellectuels, à des artistes, qui leur permettrait d’avancer dans leur art. Donc ils leur demandent d’assurer des animations, afin d’être plus tranquilles face à leurs électeurs. C’est très bien, les événements gratuits, dans la rue. J’en ai inventé beaucoup. C’est même formidable. Si ce n’est que l’aspect principal de notre travail, consiste à donner des moyens à des artistes en pleine recherche. Comme pour la médecine ou la biologie. Il faut chercher. Parfois, ça prend du temps. Mais il faut cette insistance et cette durée pour imaginer de nouvelles formes, comme de nouveaux médicaments. C’est pourquoi la danse de rue ne suffit pas et ne suffira jamais.
DCH : Quel regard jetez-vous aujourd’hui sur cette histoire de plus de quarante ans de Montpellier Danse ?
Jean-Paul Montanari : C’est l’histoire du temps qui passe. Il y a peu d’expériences culturelles, artistiques, en France, qui aient duré si longtemps, avec une pareille évolution. C’était un big bang. Nous sommes partis de zéro. Un studio sous les toits de l’Opéra Comédie, avec le premier bureau du festival dans les sous-sols, à hauteur de pot d’échappement des voitures stationnées sur la rue. Aujourd’hui, nous avons cet énorme bâtiment au cœur de ville, une cristallisation appelée l’Agora, un peu plus de 7000 m2 consacrés à la danse contemporaine, représentant une forme d’aboutissement. Avec l’immense plaisir que m’a fait le maire de Montpellier, Michael Delafosse, à l’occasion de travaux, de rebaptiser l’arrêt de Tramway Louis Blanc-Agora de la Danse. Je n’avais rien demandé. J’ai été très ému. Parce que des centaines de milliers de personnes toute l’année entendent que ce bâtiment a été, volontairement, par les pouvoirs publics, dévolu à cet art un peu étrange. Mais je n’aurais jamais pu monter ce festival et l’Agora de la danse sans le soutien indéfectible de Georges Frêche, dont c’’était l’idée. Il disait « je vous ai construit un royaume », et c’est vrai. Le nom de la ville est intimement associé à la question de la danse, et j’ai toujours eu un sincère et profond souci d’intégrer cette manifestation artistique à la vie de la ville. Et ma foi, si j’en crois le nombre de gens que je ne connais pas qui m’arrêtent dans la rue, c’est plutôt réussi. Ils savent la qualité de Montpellier Danse. Ils en sont fiers. C’est pourquoi la suite est essentielle.
DCH : Justement, pouvez-vous nous en parler ?
Jean-Paul Montanari : J’arrive à un âge où le moment me paraît venu de m’arrêter. J’ai repoussé. Parce que j’ai encore l’énergie, parce qu’il y a des échéances politiques, parce que j’avais encore la force et le goût de faire ça. Et un public qui ne me tourne pas le dos et ne trouve pas que je suis trop vieux. Mais ce public vieillit en même temps que moi, et il faut laisser la place à une nouvelle manière de faire les choses, à de nouveaux artistes, même si, je me retrouve difficilement, dans la plupart des propositions faites aujourd’hui par les jeunes chorégraphes. Parce que je ne vois pas, par exemple, en quoi les problèmes écologiques viennent affecter le spectacle vivant. À ce titre, peut-être pourrait-on s’intéresser davantage au monde du sport ou au tourisme de masse. Bref. C’est le moment de changer de mains. J’ai 76 ans. J’avais prévu de lâcher prise après cette édition, mais ce sera un peu plus tard, Michael Delafosse m’ayant proposé de signer l’édition 2025. Je m’en irai donc fin 2024. Tout en gardant un œil, à travers l’équipe formidable de Montpellier Danse, sur la réalisation de cette 45e édition.
C’est une manière de surseoir, peut-être. Mais il m’était impossible, à titre personnel, de quitter le festival d’un bond. Montpellier Danse est ma vie depuis cinquante ans. Je n’en ai pas d’autre. Pas de compagnon, pas de compagne, pas d’enfant, pas de chat, ni de chien, pas de tableaux, de voiture ou même de permis de conduire. C’est sans doute ce qui a donné à ce festival sa chair si particulière. Je lui ai tout donné. J’en suis heureux. C’est un choix. Je ne pense pas qu’on aurait pu faire un festival aussi important, aussi tenace, aussi audacieux et aussi long sans lui consacrer une vie entière. Il y a une mystique, sans doute, dans mon rapport à Montpellier Danse. La personne suivante n’aura pas ce sacrifice à faire, qui n’est plus nécessaire d’ailleurs, puisque ça existe déjà.
DCH : Quelle forme Montpellier Danse pourrait prendre ?
Jean-Paul Montanari : Aujourd’hui, l’engagement de Michael Delafosse, est largement aussi entier que celui de Georges Frêche. Il faut une véritable indépendance d’esprit par rapport à la suite, qui ne doit ressembler en rien à ce qui précédait. C’est pourquoi, m’ouvrant à lui de mon départ, nous sommes convenus qu’il fallait trouver une qualité d’acte et de réflexion, une dynamique similaire à celle qui présida à la création du Centre chorégraphique confié à Dominique Bagouet en 1980, et du festival six mois plus tard. Avec, entre temps, l’élection des socialistes au pouvoir. Ce moment historique qui a permis que Montpellier Danse soit devenu le cœur battant de la danse, de la création dans l’Hexagone, sans doute en Europe et peut-être même dans le monde.

Je crois avoir convaincu Michael Delafosse – qui s’est révélé très facile à convaincre– de l’idée d’un rapprochement institutionnel entre ces deux associations qui occupent l’Agora et peuvent tout à fait fonctionner ensemble. Ce qui était d’ailleurs le cas à l’époque de Mathilde Monnier où nous présentions un front uni pour la danse, à travers la saison, les créations de l’artiste qui dirigeait le CCN, les préoccupations, les équipes, les publics. Depuis, nous n’avons pu faire bloc et l’ensemble s’est affaibli. D’où mon souci, mon inquiétude, pour que tout ne s’effrite pas après mon départ. Ainsi est née l’idée de provoquer ce rapprochement entre les deux structures pour inventer quelque chose de plus fort, de plus lisible, de plus pertinent. Parce que les temps qui viennent ne vont pas être meilleurs.
Heureusement, en ce qui concerne l’Agora, la ville est propriétaire du bâtiment, et majoritaire dans le financement. Même si nous avons beaucoup de respect pour le ministère de la Culture, et sommes prêts à travailler ensemble, la décision finale sera prise par le maire de Montpellier, c’est ainsi depuis 45 ans, et ça continuera. C’est un gage de pérennité au vu de ce qui pourrait se passer lors des prochaines élections présidentielles. Même si je ne suis pas directement mêlé au processus de renouvellement, j’ai un festival à finir, si j’ose dire, – Le président de l’association Montpellier danse, la présidente du CCN, la Conseillère pour le spectacle vivant de la ministre de la Culture se réuniront en ce sens – le jour où l’on aura besoin de mes conseils, j'espère que Michael Delafosse fera appel à moi.
En quarante ans, j’ai exploré tout ce que je voulais faire, j’ai pu donner toutes les réponses que j’ai voulu apporter aux situations sociales, inviter les artistes que je souhaitais, sauf quelques-uns qui m’ont échappé, soit qu’ils sont morts avant, soit qu’ils n’ont pas voulu ou pas pu passer par Montpellier. Je n’ai aucun ressentiment ni regret, je n’ai que de la satisfaction, et une vraie paix intérieure.
DCH : Question corollaire : quelles seraient aujourd’hui les bonnes structures, les bonnes institutions pour la danse en France ?
Jean-Paul Montanari : La France est, et a toujours été, relativement en avance sur la création des institutions. Pour la danse, elle est sans doute le premier pays européen à inventer ces Centres chorégraphiques, même si je suis intimement persuadé qu’aujourd’hui, il faut refondre ces structures. Il faudrait laisser la place à de nouvelles institutions, plus imaginatives. Et au vu de l’évolution extrêmement rapide des arts du spectacle, avec l’informatique, les réseaux sociaux, la perception du corps, la musique, et la prégnance des images, la création d’organisations innovantes me semble indispensable. Il faudrait donner des moyens aux chercheurs pour chercher, tout simplement. Il n’existe que peu d’endroits qui le proposent. Je présume que les politiques de résidences pourraient être beaucoup plus abondées. Ici, il est très responsable de la part de la Fondation BNP Paribas de nous allouer des sommes importantes pour accueillir des artistes qui travaillent à des créations en cours. Mais nous aimerions aussi qu’ils viennent juste répéter pour rien ! Voilà ce qui serait le plus nouveau, le plus intelligent. Ça se fait ailleurs. Au CNRS ou à la Villa Médicis. S’ils ne trouvent pas, aucune importance. Ce n’est pas compris dans le prix. Dans la prochaine édition, trois tables rondes aborderont le sujet. D’ailleurs, il y a beaucoup d’inscrits, avec des gens comme Guy Saez, observateur aguerri des politiques culturelles et de l’action publique, et des structures institutionnelles du spectacle. Et beaucoup d’autres comme Jacques Renard, qui savent de quoi ils parlent. La tendance politique va-t-elle dans cette direction ? Rien n’est moins sûr. Mais ce serait peut-être l’occasion – surtout si la gauche est éloignée du pouvoir dans les mois ou les années qui viennent – de réfléchir à une nouvelle manière de soutenir le spectacle vivant. L’autre idée, du même ordre, serait de favoriser les projets, les artistes, en rapprochant les peintres, les musiciens, les chorégraphes.

On connaît, historiquement, le rôle qu’ont joué les Ballets russes, pour inventer des formes surprenantes, novatrices. C’était l’une des hantises de Dominique Bagouet qui, lui au moins, aura réussi, par exemple autour du Saut de l’Ange à réunir Christian Boltanski et Pascal Dusapin, les deux plus grands musicien et plasticien de leur époque. C’était une drôle d’idée, mais il était parfaitement conscient de ce qu’il lançait. Actuellement, il manque ce lieu de rencontres, de travail, où l’on peut essayer toutes sortes de formules sans obligation de résultat. C’est une idée que j’ai émise ici, à plusieurs reprises. Montpellier Danse n’est pas assez grand, et nous avons un festival et une saison à produire, pour offrir seul, ce lieu qui réunirait plasticiens, musiciens, vidéastes, metteurs en scène, auteurs et chorégraphes. Mais ça pourrait être une nouvelle mission. Parce que, peu à peu, la création des images va prendre le pas sur tout le reste. Peut-être se cantonnera-t-elle à être un ingrédient nouveau, comme les projecteurs au XXe siècle… Le malheur, serait que ce soit l’image qui commande et que Tik Tok devienne l’aune des imaginaires du futur.
Propos recueillis par Agnès Izrine










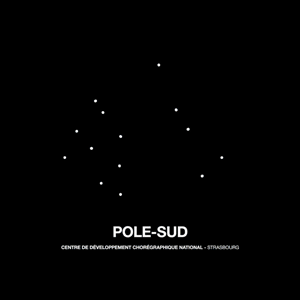









Add new comment