Festival d'Avignon : « Canzone per Ornella » de Raimund Hoghe
En apparence immuable, l'art du portrait-hommage ici offert à Ornella Ballestra, constate le désastre italien, et provoque le chahut.
On aimerait que soit conduite une analyse fine du public avignonais dans son approche de la danse. C'est très différent de ce qu'on observe dans les événements marseillais, montpelliérain ou lyonnais. Au Festival d'Avignon, le public semble plus occasionnel, brassé, touristique, mais également pétri de certitudes théâtrales (et parfois abîmé par des effluves émanant du chaudron du "Off", qui ne sont pas toutes râgoutantes).
Alors la rencontre de ce public bigarré, hétéroclite, assez carré et parfois naïf, avec l'art sophistiqué, ultra-référencé, de Raimund Hoghe, peut se faire déroutante ; et se conclure de manière houleuse au moment des applaudissements de Canzone per Ornella, au tout dernier soir du dernier Festival. La réception du chorégraphe allemand peut se jouer sur un fil ; basculer d'un côté, ou de l'autre.
Sans pitié. Quand très tôt dans la pièce, la musique attaque fort sur Carmina Burana, ronflante à souhait, quand s'y dresse la légendaire danseuse Ornella Ballestra, hissée sur des talons aiguilles tutoyant le demi-pointe, chevelure rousse, rouge à lèvres carmin, il faut choisir. L'image peut méduser, frôler l'excès, inspirer la dérision. Sinon, c'est qu'on veut y croire, comme à un trait de folie géniale, exaltation dans la croyance en les puissances de métamorphose, de transusbsantation, que soulève l'art scénique.
Galerie photo © Laurent Philippe
C'est tout l'un. Ou bien tout l'autre. Cela demande au spectateur une forme d'attention soutenue. Une acceptation du doute. Une disponibilité avant toute chose. D'emblée, on sait la chose pliée pour son voisin de gradin, obstiné dans la manipulation de son smartphone pendant la représentation, chez qui tout laisse pressentir une passion tournée vers l'acquisition de son prochain 4 X 4 (ou quelque chose de cet acabit, suppose-t-on).
Canzone per Ornella s'inscrit dans la tradition des portraits-hommages que Raimund Hoghe tend en offrande à certains de ses interprètes fidèles. La ritualisation y est portée à son comble, dans une boucle d'actions minimalistes, relancées, parfois répétitives. Cette boucle est déroulée autour d'une danseuse au parcours de légende, dont la personne s'expose en gracile suspension, d'où émergent d'intermidables bras à la légèreté de plume, mais acuité de stylet, qui se déroulent dans un velours de battements d'ailes d'oiseau, déploiment de roues de paon, ondulations de col de cygne. Tout au bout : d'interminables doigts, tout en caresses dansantes de flammèches.
Non sans suggérer quelque chose de l'ordre de l'adoration, la situation vaut par ce qui se retourne en miroir, entre l'interprète et son chorégraphe. Que dire du rôle de ce dernier, qui paraît tour à tour officiant, assistant, directeur, inspirateur, serviteur, muse, célébrant, camarade, et encore… Physiquement, Ornella Ballestra a parfois une position penchée du buste, dans une verticale contrariée en oblique. A distance plus ou moins proche, le corps de Raimund Hoghe lui répond, dans une posture analogue. Les causes en sont distinctes. Contraintes morphologiques chez l'un. Etude de la posture pour l'autre. Mais cette mise en regard bouleverse l'horizon des intentions, dégagé sur le monde.
Galerie photo © Laurent Philippe
Avouons-le : quant à l'écriture du mouvement, quant à la composition chorégraphique, Canzone per Ornella nous a paru risquer le reproche de la redite, voire du ressassement, en ayant déjà vu, précédemment, toutes les autres pièces de ce même auteur. Or sa résonance n'en est pas moins totalement singulière, précisément quant à cet horizon des intentions, dégagé sur le monde. C'est affaire de contexte et de référence culturelle.
Ornella Ballestra est italienne. Et la situation politique – morale en définitive – de l'Italie en ce début d'été 2018 ne signifie pas rien pour le reste du monde. Au sens le plus aigu du mot, la pièce de Raimund Hoghe cultive cet élément de contexte. Cela se joue dans la bande son, où la référence cinématographique joue autant que la musicale. Pier Paolo Pasolini y est invité, grandement. N'est-ce pas à lui qu'on doit la pensée de "jeter son corps dans la bataille", que le chorégraphe a reprise comme proclamation fondatrice de son propre engagement scénique ?
En parcourant Canzone per Ornella à la façon d'un livre d'images, de souvenirs, et de philosophie, on se pince à se souvenir de la place gigantesque qu'occupait l'Italie, naguère, dans le concert de la pensée et de la création en Europe. Anciennement l'opéra. Puis le 7e art, à un sommet resplendissant de la deuxième moitié du vingtième siècle. Berlusconi, qu'as-tu fait de cet héritage, pour intrôniser les Salvini d'aujourd'hui, et préparer ce monde qui inspire aux spectateurs d'user de leur smartphone durant une pièce de Hoghe...
Galerie photo © Laurent Philippe
Les fidèles de ce dernier connaissent bien la lettre qu'il s'obstine à lire en scène, de deux adolescents africains s'adressant, pleins d'espoir, aux dirigeants de la sublime Europe, avant de trouver la mort dans leur effroyable tentative d'atteindre cette dernière en se glissant dans l'appareillage d'un avion. Dite et redite, cette lettre trouve dans cette pièce une puissance inégalée jusqu'à ce jour. Tandis que Raimund Hoghe strie la cour du cloître des Célestins dans des trajectoires empressées, affolées, voire apeurées, on saisit l'ombre portée de son parcours, qui s'initie dans les décombres du nazisme et vibre jusqu'à nous.
De façon sourde, Canzone per Ornella résonne comme nouvel – voire ultime – avertissement, avant nouvelles catastrophes. Patiemment, son inlassable broderie scénique débute avant la tombée de la nuit, pour épouser un temps des transitions. Puis cela gagne les zones les plus obscures pour y rechercher ce qui rend la vie lumineuse. Pourquoi pas une vie de star. Dans son dernier rituel, comme à son habitude, Raimund Hoghe ordonne au sol les objets icôniques de l'être qu'il révère : une étole, une paire de lunettes, des talons aiguilles, un étrange Sacré-coeur de pacotille tiré de la liturgie.
Puis il déplie une couverture de survie, pour l'étaler par-dessus ces riens, tout à l'avant du plateau. Elle scintille, c'est un brillant enchantement – devenu tic de tant et tant de scénographies désargentées. Mais alors ses plis et froissements lui donnent l'allure d'une mer en proie aux houles. Quatre malheureux cailloux retiennent son frissonnement dans le mistral d'une nuit provençale. Et dessus il dispose la miniature d'une barque dont pourraient jouer les enfants sur un bassin d'agrément. Sauf que cette image maritime renvoie autant à la réalité des naufrages (en Méditerrannée) comme à l'hypothèse de celui d'une civilisation toute entière.
Voilà tout ce qui ne se capte pas en pianotant sur son smartphone.
Gérard Mayen
Spectacle vu le 24 juillet 2018, au Cloître des Célestins (72e Festival d'Avignon).
Catégories:


















































































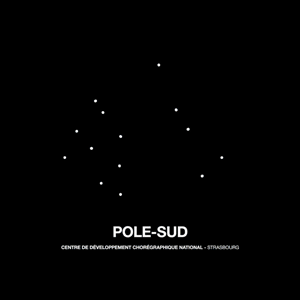








Add new comment