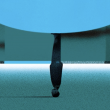Entretien avec Marina Gomes : La Trilogie en scène !
À Suresnes Cités Danse, Marina Gomes présente pour la première fois l’intégralité de sa trilogie : Asmanti, La Cuenta et Bach Nord. Trois pièces, trois angles, un même geste artistique : reprendre la parole sur les quartiers populaires, réhumaniser des vies trop souvent réduites à des clichés, et affirmer la danse comme espace de résistance, de mémoire et de résilience.
 DCH : Vous présentez à Suresnes Cités Danse La Trilogie qui réunit vos trois pièces récemment créées. Comment ce projet s’est‑il construit ?
DCH : Vous présentez à Suresnes Cités Danse La Trilogie qui réunit vos trois pièces récemment créées. Comment ce projet s’est‑il construit ?
Marina Gomes : Au départ, nous n’avions absolument pas imaginé que ces trois pièces seraient un jour présentées ensemble. Asmanti a été la première, et à l’époque, je n’aurais jamais, même rêvé, d’une pièce d’une heure vingt avec seize interprètes. Nous avons avancé pas à pas, en créant trois épisodes d’environ trente minutes. C’est parce qu’ils existaient que nous avons imaginé les présenter ensemble parce qu’ils racontent une seule et même histoire. Aujourd’hui, les jouer séparément me frustre presque. Réunies, sans entracte, elles forment un seul geste, trois tableaux d’une seule pièce. C’est ainsi que la trilogie prend tout son sens.
DCH : Commençons par Asmanti. Comment est‑elle née ?
Marina Gomes : Asmanti est née d’une envie très simple : créer avec nos amis, sans imaginer que cela deviendrait un projet professionnel. Nous voulions poser un décor, raconter le quartier de midi à minuit. C’est une métaphore du passage de l’enfance à l’âge adulte. À midi, tout est lumineux : le quartier est un terrain de jeux, de solidarité, de rires. Puis, au fil de la journée, la lumière décline et les violences sous‑jacentes — économiques, sociales, policières — prennent le dessus si nous n’avons pas de porte de sortie. La pièce fonctionne comme un plan‑séquence : nous traversons différents états, différents âges, différents basculements. La lumière accompagne cette traversée, mais c’est surtout la danse qui guide le spectateur vers les zones plus sombres, vers ce “minuit” symbolique où les tensions deviennent palpables.

DCH : Votre deuxième pièce, La Cuenta, aborde les « narcomicides ». Comment ce sujet s’est‑il imposé ?
Marina Gomes : J’ai vécu à Medellín, c’est là que j’ai initié la compagnie. Je travaillais avec des collectifs de jeunes rappeurs qui œuvraient pour la paix dans des quartiers très marqués par les assassinats. Ces collectifs, comme Agroarte, menaient des actions esthétiques, mémorielles, de résilience. Leur philosophie était simple : chaque vie compte. Dans ces quartiers où l’État est absent, ils défendaient l’idée que la paix devait être construite par les habitants eux‑mêmes. Lorsque je suis rentrée à Marseille, la ville traversait une flambée de violence. Nous avons eu envie de ramener cette philosophie-là : défendre toutes les vies, même celles des jeunes qui ont fait le “mauvais choix” d’entrer dans le trafic. Parce que ce n’est jamais un choix simple. Et parce qu’un enfant de quatorze ans qui prend les armes, c’est un échec collectif.
La Cuenta © Pierre Gondard
DCH : Vous abordez ce sujet depuis le point de vue des femmes. Pourquoi ?
Marina Gomes : Parce que nous ne voulions pas raconter littéralement des garçons qui se tirent dessus. Nous voulions parler de celles qui restent : les mères, les sœurs, les amoureuses. Celles qui traversent le deuil, la colère, l’envie de vengeance, la résistance, et qui malgré tout construisent un futur. On parle beaucoup des morts, mais jamais de ceux qui survivent. À Marseille, tout le monde connaît quelqu’un qui a été assassiné. Les enfants ont entendu les armes, ont vu des drames, connaissent des victimes. Pendant longtemps, nous avons banalisé cela. La Cuenta cherche à briser cette honte, à ouvrir des espaces de parole, de soin, de solidarité. L’art doit pouvoir permettre cela. Et le collectif, est ce qui traverse tous mes spectacles.
DCH : Venons‑en à Bach Nord, votre réponse au film de Cédric Jimenez. Comment est née cette pièce ?
Marina Gomes : Au départ, c’était presque une blague. Le film BAC Nord nous a beaucoup heurtés à Marseille : encore une fois, il donnait une image déshumanisée, criminalisée des jeunes des quartiers. Et il renversait le rapport de culpabilité dans une affaire où une unité de police était pourtant sur le banc des accusés. Un jour, en passant, j’ai vu un tag sur un mur des quartiers Nord : Écoutez Bach, évitez la BAC. Ça m’a fait rire. J’ai appelé Arsène Magnard, le compositeur avec lequel je travaille, et lui ai demandé : « Si nous faisions une bande‑son autour de Bach, mais retravaillée en trap, drill, hip‑hop ? Et que nous appelions ça “Bach Nord” ? » À Marseille, la “guitare” est le surnom de la Kalachnikov. Nous avons donc commencé la pièce par un solo de Bach à la guitare. C’était un contre‑pied total : là où l’on nous attend avec une arme, nous arrivons avec un concerto. Nous avons créé la pièce avec des jeunes des quartiers Nord. Nous ne pouvions pas parler d’eux sans leur présence active. Et depuis, nous la rejouons en tournée avec des groupes d’amateurs locaux. À Suresnes, nous serons environ quarante sur scène avec de jeunes amateurs réunis par la Maison de la musique de Nanterre.

DCH : Pourquoi les « Kalach » sont-elles appelées « guitares » ?
Marina Gomes : Alors, bonne question. Je pense que c'est à cause de la forme. Il y a aussi un film avec Antonio Banderas où il cache sa mitraillette dans un étui à guitare. En fait, je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais de nombreuses chansons de rap y font allusion. Les jeunes le savent, bien sûr. Les autres, pas toujours. Quand on dit de quelqu'un qu'il est guitarisé, cela signifie qu'il est armé, et moi ce rapport de codes culturels qui sont maîtrisés par les uns, et non par les autres m'intéresse. Souvent, les experts de la culture qui fréquentent les théâtres comprennent ce qui se passe sur scène, là où les gens issus des quartiers se sentent exclus. Nous avons tenté d’inverser ces rapports de domination culturelle dans un spectacle où les jeunes captent toutes les images et où les « pros » me posent des questions.
DCH : Les jeunes se reconnaissent‑ils dans votre travail ?
Marina Gomes : Oui, beaucoup. Nos publics sont très mélangés, et c’est essentiel. Les jeunes de Marseille nous suivent encore ; certains sont même entrés dans l’équipe professionnelle. Ils nous disent souvent : “Ça parle de nous.” Et c’est important pour nous que la gestuelle et la musique soient ancrées dans l’actualité. Avec Arsène, nous composons des musiques hip‑hop très contemporaines, ce qui est encore rare dans la danse.

DCH : La guitare semble être un fil rouge entre les trois pièces. Pourquoi ?
Marina Gomes : Arsène est guitariste et compositeur de musique de film. La guitare s’est imposée naturellement. Entre Marseille et Medellín, on parle souvent du narcotrafic, de la violence. Nous voulions faire le lien par l’art. Dans La Cuenta, il y a des passages inspirés des productions de Jul, d’autres en reggaeton, rythmé par le son des kalach. Nous voulions affirmer que nous pouvions danser même avec ça ou malgré ça. La création est une forme de résilience. Dans Bach Nord, le solo de guitare renverse le cliché du guetteur cagoulé. Nous jouons avec les codes, nous les retournons, nous les déplaçons.
DCH : Votre écriture chorégraphique mêle hip‑hop et influences contemporaines. Comment travaillez‑vous ?
Marina Gomes : Je viens du hip‑hop, mais j’ai aussi une formation en danse contemporaine. J'ai même commencé avec de la danse classique que j’ai étudiée pendant de nombreuses années. Mais pour moi, c'était vraiment deux univers parallèles. Mon travail en danse au conservatoire et mon rapport au hip-hop qui était vraiment rattaché à la rue. De même, j'ai longtemps cru que mes études de psychologie ne pouvaient pas cohabiter avec la danse. C’est en vivant en Colombie où tout s'est mis à fleurir ensemble que j'ai commencé à vraiment percevoir les liens. Le hip‑hop est donc mon socle culturel, mais je ne reste pas dans ses codes gestuels. Je cherche des gestes qui racontent. Je pars souvent du cliché — les cagoules, les postures — puis je les transforme, je les déconstruis.
Marina Gomes : J'aime beaucoup le cinéma qui m’a peut-être plus influencée que le spectacle vivant, de par mes racines sociales et culturelles. Donc je travaille à partir de cet imaginaire cinématographique : J’aime les plateaux où il se passe plusieurs choses en même temps, où les trajectoires se croisent, où les contrepoints créent une dramaturgie visuelle. Je ne suis pas dans la frontalité, qui est parfois très présente dans le hip-hop. J’aime les multidirections, les décalages, les accumulations, les ruptures de rythmes ; C’est là que mon passé en danse contemporaine réapparaît : dans la manière d’habiter l’espace, de construire des ensembles. Mais l’énergie, la pulsation, la qualité du mouvement restent profondément hip-hop. C’est un langage hybride, mais qui ne cherche pas à être “fusion” : il cherche à être juste, à raconter ce que nous vivons.
DCH : Votre parcours vous a menée de Toulouse à Paris, puis à Medellín. Comment cela nourrit‑il votre travail ?
Marina Gomes : Je suis née près de Toulouse, j’y ai fait ma formation. Je suis montée en région parisienne en 2006, puis je suis partie en Colombie en 2017. Medellín a été un choc. J’y ai chorégraphié, j’ai travaillé avec des collectifs, j’ai vu la violence de près. J’étais jeune, seule, un peu inconsciente. Quand je suis devenue mère, j’ai vu les choses autrement. Le contexte n’était plus compatible.

DCH : Vous venez de créer Nidal, une pièce en détention. Pouvez‑vous nous en parler ?
Marina Gomes : Nidal signifie “la lutte, le combat”. Nous l’avons créée avec des détenus du centre pénitentiaire d’Aix‑en‑Provence. Ça a été un projet renversant, humainement très fort. Nous avons joué une première en détention, puis une version extérieure où deux détenus, libérés en fin de peine, ont pu monter sur scène avec nous. La culture en prison est de moins en moins soutenue, mais c’est essentiel. L’art peut être un outil de résilience, de réinsertion. Je suis très heureuse que Nidal soit présenté au Festival de Marseille en juin.
DCH : Que représente pour vous votre présence à Suresnes Cités Danse ?
Marina Gomes : C’est très symbolique. Suresnes est un festival historique du hip‑hop. L’une des dernières auditions que j’ai passées avant de partir en Colombie, il y a dix ans, c’était là. Je n’avais pas été prise. Alors revenir aujourd’hui, avec une grande équipe, par la grande porte, c’est une forme de revanche douce et joyeuse.
Propos recueillis par Agnès Izrine le 16 décembre 2025.
La Trilogie à voir à Suresnes Cités Danse les 23 et 24 janvier 2026
Catégories: