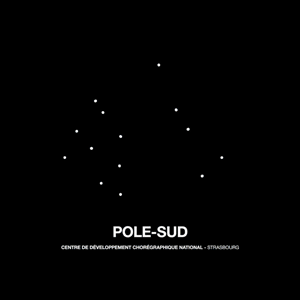Cuba à tâtons (volet I)
En octobre 2017, notre critique Gérard Mayen participait au colloque Memoria fragmentada, organisé par le département de danse de l'ISA – Instito superior de las artes – à La Havane (Cuba). A cette occasion il a pu explorer le paysage de la jeune création chorégraphique, dans un pays en pleine mutation, incertaine. Nous entamons ici la publication de son reportage, qui se fera en trois volets.
Ils habitent une île que guettent les regards de la planète entière ; mais restent isolés, sous un régime en transition incertaine. Où se situer ? Comment se projeter ? A La Havane, de jeunes artistes de la danse et de la performance frayent le chemin hésitant de leur indépendance.
A l'automne 2017, pour parler de la scène artistique contemporaine à Cuba, il n'est pas difficile de réussir un article branché. Il suffit de se rendre à la FAC, Fábrica de Arte Cubano. Le quotidien Libération ne s'y est pas trompé, qui y a dépêché un "envoyé spécial". Rien que ça (reportage de Christian Losson, accessible en ligne, daté du 28 avril 2015). Dans ces lieux, le journaliste français a entrevu un mix entre Point éphémère et Centquatre-Paris.
 Téléphoné sous les tropiques, c'est le modèle normatif de la friche artistique, désormais décliné sur tout le versant occidental de la planète. Le réseau Tripadvisor ne s'y est pas trompé non plus, qui place la FAC en tête de sa liste des attractions touristiques de La Havana. Une attraction touristique ? De quoi mettre, tout de même, la puce à l'oreille. Non pas sur la qualité du lieu. Mais sur la nature des évolutions à Cuba, dont ce lieu témoigne. Le magazine Cuba-On assure même qu'on y aurait entraperçu Lady Gaga, Mick Jagger et Michelle Obama.
Téléphoné sous les tropiques, c'est le modèle normatif de la friche artistique, désormais décliné sur tout le versant occidental de la planète. Le réseau Tripadvisor ne s'y est pas trompé non plus, qui place la FAC en tête de sa liste des attractions touristiques de La Havana. Une attraction touristique ? De quoi mettre, tout de même, la puce à l'oreille. Non pas sur la qualité du lieu. Mais sur la nature des évolutions à Cuba, dont ce lieu témoigne. Le magazine Cuba-On assure même qu'on y aurait entraperçu Lady Gaga, Mick Jagger et Michelle Obama.
Le soir où l'on se rend à la FAC, nous nous contenterons de rencontrer Isabel Busto. Elle y présente une pièce avec sa compagnie de Danza Teatro Retazos. Instigatrice d'une danse-théâtre aujourd'hui fanée, Isabel Busto est un archétype de Pina Bausch du cru, comme on en trouve un specimen dans toutes les capitales du monde. Elle prend un air désolé, pour constater comment rien, à La Fábrica, n'est aux normes techniques d'une représentation scénique. N'empêche, il faut en être. « C'est un moyen pour toucher des publics autres que ceux qui nous suivent habituellement », soupire cette inlassable pionnière.
Tout semble ambigu dans cet établissement de pas moins de 7000 mètres carrés, ancienne huilerie industrielle abritant discothèque, restaurant, salle de concert, salle de cinéma, galeries d'exposition, ateliers, bars. Et encore des bars. Et d'autres bars encore. C'est ambigu, comme un signe extraordinaire de foisonnement artistique porté par l'initiative privée (soit X Alfonso, célébrité de la musique afro-cubaine), grande bouffée d'air attendue à La Havane ; mais accompagné par l’État cubain, qui fournit les locaux, et dont on n'a jamais vu qu'il soit neutre et ingénu dans son rapport aux artistes.
La Fábrica est ambiguë comme sa programmation de bonne tenue, portée par un pool de curateurs incontestables chacun dans son domaine, au fil d'une saison entrecoupée de longues pauses où le projet se redéfinit ; mais qui donne accès à une culture entre deux verres de mojito et deux peintures aux murs, le plus souvent détournées en toiles de fond à selfies par des noctambules en joie.
Ambigu comme l'extraordinaire énergie juvénile qui s'en dégage, mais dont le modèle économique rappelle le statut d'auto-entrepreneur des employés du lieu, artistes par ailleurs. Ambigu comme le tarif, à deux euros l'entrée, une paille côté jet-set, mais qui n'est pas loin d'équivaloir le dixième d'un salaire de base local ; sinon une cinquantaine de trajets en transports en commun. Ambigu comme tout semble l'être dans un Cuba en transition, qui voudrait le marché… mais sans le capitalisme (pour paraphraser Le Monde diplomatique d'octobre 2017).
Longtemps, la jeunesse de La Havane sans moyens de se payer une entrée en discothèque, néammoins festive et hyper lookée avec les moyens du bord, follement inventifs, se rassemblait dans un Woodstock à plusieurs milliers, les nuits de week-end sur le Malecon du bord de mer, s'agrippant au Bim Bom, frustre bar à bières et glacier. Le Bim Bom est aujourd'hui fermé. La police rode, avec une pointe d'homophobie mal dissimulée. L'envoûtant rendez-vous de cette libre jeunesse pauvre, mais branchée côté vie côté nuit, a été dispersé. C'est fou, la vitesse à laquelle La Havana glisse sur la voie de la normalisation de la société du spectacle, du contrôle et de la marchandisation.

Il n'y a pas que la FAC. Il n'y a pas que feu le Bim Bom… A mi-chemin, dans une courbe de l'interminable avenue Linea qui les relie, se dresse l'edificio Lopez Serrano. En 1930, ce gratte-ciel art déco était le plus élevé de La Havane, dans l'immense quartier du Vedado, qui fleurait bon son modèle urbain américain. D'ailleurs, ce bel immeuble surplombe la place-forte que demeure l'ambassade des USA à Cuba, hérissée de mâts à caméras. Un vrai décor de cinéma. Surgi d'un album de Tintin, d'un film de James Bond en leur temps, l'édifice est bien délabré, comme l'essentiel du bâti cubain sous régime communiste finissant, et bloccus américain. Partout ailleurs, on aurait tôt fait d'y installer le siège d'une banque. Or l'edificio Lopez Serrano n'abrite, osbtinément, que de simples logements.
Au septième étage ce soir-là, l'un de ces appartements accueille un rendez-vous du Laboratoire scénique d'expérimentation sociale. On s'y propose d'explorer les voies possible de « l'autonomie, l'autogestion, l'auto-organisation des créateurs contemporains ».Deux artistes se succèdent au programme.

Le premier est le jeune danseur Luis Enrique Carricaburu. Tout le monde s'en tient à Carri, son diminutif. Carri est sorti de la compagnie nationale Danza contemporanea. Et c'est tout un choix, dans un contexte où (presque) rien n'existe pour soutenir les artistes indépendants. Même chiches, Danza contemporanea verse des salaires à ses membres, leur garantit des tournées internationales, et conserve le prestige des grandes institutions artistiques entretenues par le système communiste.
Encore faudrait-il s'entendre sur ce qui est contemporaneo. « Le danseur cubain sue énormément. Il incarne un magnifique héritage. Mais la danse contemporaine se résume-t-elle à y aller pieds nus, et effectuer quelques passages au sol ? A constamment reconduire leur talent à l'identique, ces danseurs s'entretiennent aussi dans une zone de confort. Pour ma part, je n'en peux plus de les voir tellement excellents, tellement parfaits, mais toujours tous les mêmes, dansant de la même façon » s'exclame Noël Bonilla, équivalent d'un Délégué général de la danse auprès du Ministère de la Culture – mais sans réel pouvoir pour en élaborer la politique (d'ailleurs, il vient juste d'être contraint de quitter ses fonctions avec fracas).
 Désormais affranchi, le jeune Carri verse dans la performance. Sous le titre Trabajo voluntario, on est dans les canons du genre. Son public l'accompagne dans le hall de l'Edificio Lopez Serrano. Là, pelle en main, le jeune artiste s'entête à greffer le faux luxe de palmiers, qu'il s'obstine à y dresser.
Désormais affranchi, le jeune Carri verse dans la performance. Sous le titre Trabajo voluntario, on est dans les canons du genre. Son public l'accompagne dans le hall de l'Edificio Lopez Serrano. Là, pelle en main, le jeune artiste s'entête à greffer le faux luxe de palmiers, qu'il s'obstine à y dresser.
Puis on le suit au fin fond du garage en sous-sol, qui abrite des débris de la flotte automobile pré-révolutionnaire, rafistolée avec génie par les autochtones. A même sa peau, le danseur demande aux spectateurs d'inscrire des mots, au stylo-feutre, qu'il efface en les frottant de ses doigts, non sans rappeler les théories du corps-texte. Après quoi, on se hisse au sommet des quinze étages de l'immeuble. Là, sous les yeux d'une résidente médusée, vêtu en ouvrier du bâtiment, l'artiste entreprend de décaper les croûtes du méchant enduit de la cage d'escalier.
Un débat suivra, avec les spectateurs. Carri s'y épanche sur le sort de l'artiste en proie au doute et en quête de sens. On lui suggère une mise en relation des notions de déconstruction de la représentation – ce qui l'anime – mais aussi de destruction physique, de délabrement d'un cadre architectural puissamment évocateur de toute l'histoire de son pays au XXe siècle. Là, il ne voit pas de quoi on parle. Sans doute est-on en train de lui adresser ici un regard, un discours, de touriste, en définitive.

Mais cette limite du dialogue inter-culturel fait signe. Les Cubains se rendent-ils bien compte que les regards de la planète restent braqués sur eux, sur leur histoire unique, sur leur place tout aussi unique dans la géo-politique, sur le sens de leur société, sur leur place dans la mondialisation, sur leurs acquis culturels ? Savent-ils qu'un pet de mouche à La Havane résonne toujours vingt fois plus fort qu'un pet de mouche à Luxembourg ? A tout le moins, l' artiste chorégraphique et de la performance cubain a autant à faire et dire dans le monde, que son homologue sud-africain, libanais, brésilien ou iranien, eux désormais émergés.
Gérard Mayen
A suivre ...
Catégories: