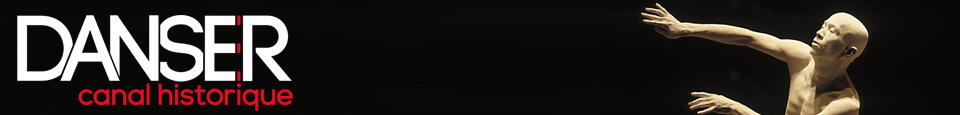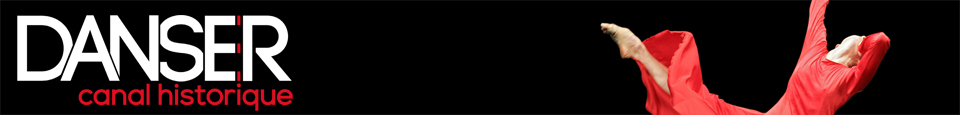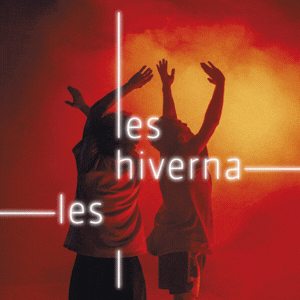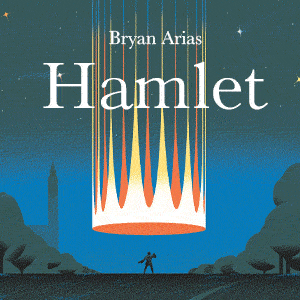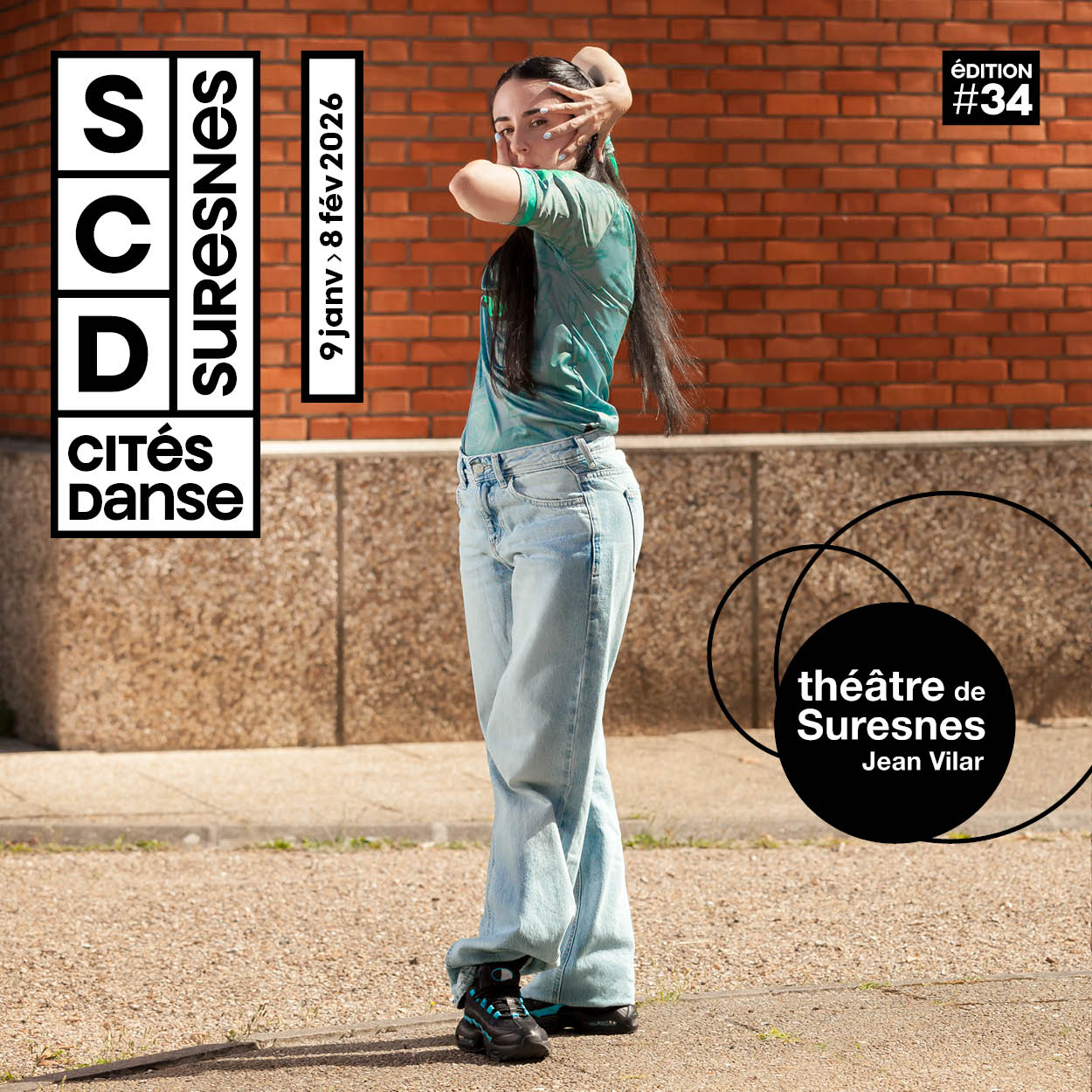« Close Up » de Noé Soulier
Six danseurs, les mélodies de Bach, dont L’Art de la fugue, jouées en direct par cinq musiciennes de l’ensemble baroque il Convito, le tout sublimé par une installation vidéo en temps réel qui fait réfléchir sur la fameuse « présence » des interprètes…
Créé pour le festival d'Avignon, mais dans le contexte d'un théâtre à l'italienne (l'Opéra municipal), Close Up de Noé Soulier trouvait dans ce passage en « boîte noire » un cadre particulièrement adapté. Car au-delà d'un dispositif impressionnant et d'un excellent travail musical, cette pièce qui rappelle le goût des spéculations autant que la sensibilité du directeur du CNDC d'Angers, est une manière d'hommage au mystère de la présence physique d'une troupe de danseurs.Mais un peu de patience ! Cela commence virtuose, mais presque banal… Un ensemble baroque est placé à bas de jardin (clavecin, violon, viole de gambe, traverso – en gros, l'ancêtre de la flûte traversière–, violoncelle). Les cinq musiciennes de l'ensemble Il Convito que dirige Maude Gratton entrent, s'accordent (l'accord des instruments anciens est toujours délicat) et jouent. L’Art de la Fugue de Jean-Sébastien Bach soit la partition la plus spéculative du compositeur ici très bien servie. Immédiatement une danseuse se rapproche des musiciens et dans le petit espace que ceux-ci délimitent d'avec le front de scène, entame une variation d'une virtuosité époustouflante : un genre de Cunningham mâtiné de Gourfink et Forsythe… Un truc improbable qui tient de la contorsion et du morceau de réception chez les compagnons du Devoir version saltatoire ; à mémoriser cependant car cela va revenir et être utile. Mais c'est déjà anticiper.
Galerie photo : Laurent Philippe
Ensuite par deux ou seul, les autres interprètes viennent ajouter du mouvement en accumulation (bonjour madame Trisha Brown, Noé Soulier est un chorégraphe très cultivé) tandis que les musiciennes développent les premières fugues, puis s'arrêtent. Les danseurs continuent dans le silence. Le développement chorégraphique repose sur une manière dialectique entre le duo à l'unisson très travaillé et un solo en simultané, avec des variantes qui montent jusqu'au sextuor à l'unisson tandis que la musique a enchaîné les contrepoints successifs de la partition entrecoupés de temps de silence. Un genre de composition très inspirée d’une De Keersmaeker (qui a beaucoup œuvré dans l'exploration de Bach), mais sans les fluidités de mouvement dans les entrées qui sont ici marchées avec fermeté et décision… Reste de la très belle danse, de la très belle musique, un chorégraphe très affûté qui a fait travailler ses danseurs à la perfection. Tout cela est fort bien mais déjà vu… Un peu de patience !
Tout bascule à la fin de la demi-heure. La scène a basculé dans l'ombre. Les instrumentistes continuent à jouer puis s'amuissent.
Galerie photo : Laurent Philippe
Un dispositif apparaît au fond. Cyclo blanc sur deux ou trois mètres au milieu du fond, deux colonnes de projecteurs rasant de chaque côté, devant l'espace de danse (le cyclo), un quadrillage de bandes noires délimitant des zones « cadrées » ; un appareil de prise de vue est positionné devant l'une de ces zones qui devient une fenêtre découpée dans le réel pour signaler là où « ça se regarde ». Surtout, surplombant, un écran de 45m2. La lumière dégagée éclabousse l'avant-scène tandis que dans le petit espace sur-éclairé une danseuse vient donner sa variation ; la musique a repris au début de la partition, mais au clavecin seul (Bach n'a pas précisé l'instrumentalisation pour L'Art de la Fugue, on y fait donc sur ce plan ce que l'on veut) et le mouvement « cadré » par les bandes noires apparaît à un format démesuré au dessus de l'endroit d'où « cela danse ». Le résultat étourdit l'œil, écrase la perception et impressionne. Le danseur y apparaît en détail, certes, mais avec une monumentale évidence. Puis plusieurs viendront s'ajouter saturant l'espace de jeu, mais toujours cadrés et détaillés par l'image vidéo. La violoniste donne l'andante de la Sonate n°2 pour violon, comme un signal (pour mémoire, Bach avec écrit sur partition « Sei solo » (soit seul) au lieu de Sei soli (six soli), ce qui vaut ici programme) car la vidéo laisse chacun des interprètes à autant de solitudes fragmentées. Jusqu'à ce qu'ils en viennent à démonter le dispositif et que la danse rejoigne le bas de plateau. Toute la partition passe… Construction savante du sextuor, d’abord les six simultanément aboutissant à deux groupes d'unisson. Mais Bach à laissé l'ultime contrepoint inachevé et le noir vient… Soudain la rampe de fond éclaire à contre jour le groupe qui reprend et sur une dernière montée donne le tutti. Bien joué.
Galerie photo : Laurent Philippe
Mais que l'on ne s'y trompe pas. Pour spectaculaire, le dispositif vidéo ne relève pas de la scénographie à effet. Et tout l'intérêt de la première partie est là ! Car si pour le chorégraphe, le dispositif permet de souligner ces détails qui le bouleversent en répétition, il n'en ignore pas le potentiel de fascination de cette image disproportionnée. Il s'agit donc de donner cette sensation de fourmillement, de micro-événements de danse, débordant les capacités du regard, pour souligner ensuite, par l'énorme agrandissement, la nature de ceux-ci. Mais aussi leur limite, car tout l'enjeu du retour à la composition et du tutti (le final) est de souligner que l'émotion, plus encore que dans l'intimité du regard avec le corps du danseur, est contenue dans cette dynamique enthousiasmante qui porte le groupe. En cela, Close Up est à la fois une démonstration de ce qu'apporte la vidéo à la danse mais aussi un hommage indirect à la présence des danseurs.
Philippe Verrièle
Le 12 mars 2025 au Théâtre de la Ville, avec Chaillot Nomade, Paris.
Conception et chorégraphie Noé Soulier
Direction musicale Maude Gratton
Musique Jean-Sébastien Bach,
Scénographie Noé Soulier, Kelig Le Bars et Pierre Martin Oriol
Lumière Kelig Le Bars
Vidéo Noé Soulier et Pierre Martin Oriol
avec Stéphanie Amurao, Nangaline Gomis, Yumiko Funaya, Samuel Planas, Mélisande Tonolo, Gal Zusmanovich
et avec l’Ensemble il Convito dirigé par Maude Gratton
Maude Gratton, clavecin
Sophie Gent ou Christine Busch, violon
Claire Gratton, viole de gambe
Ageet Zweistra, violoncelle
Catégories: