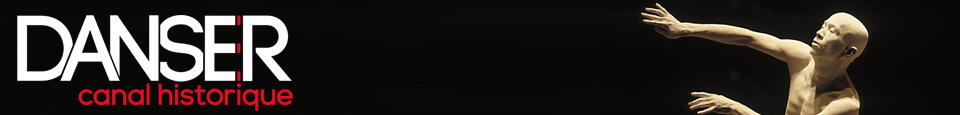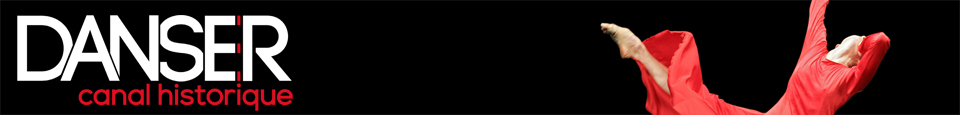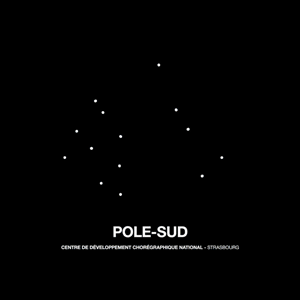Ballet de Bordeaux : Quatre Tendances
Quatre Tendances, c’est le titre générique imaginé par Eric Quilleré il y a une vingtaine d’années pour présenter les chorégraphes emblématiques d’aujourd’hui avec les jeunes talents de demain. Cette année fête la 10e édition de ce temps fort qui réunit Xenia Wiest, Wayne McGregor, Ana Isabel Caquilho, et Sól León et Paul Lightfoot.
 C’est à la demande d’Eric Quilleré, directeur de la danse du Ballet de l’Opéra national de Bordeaux, que Xenia Wiest a créé une œuvre entièrement féminine, sur pointes, intitulée Beauties and Beasts. Bien entendu, le titre fait allusion au célèbre conte La Belle et la Bête, mais le passage par le pluriel en modifie légèrement le sens, tout comme l’anglais que l’on peut traduire par « des beautés et des bêtes » ce qui justifie l’interprétation de la chorégraphe qui oppose dans ce ballet la bestialité de la jeunesse à la beauté de l’âge mur. Autrement dit, différents âges de la vie d’une femme.
C’est à la demande d’Eric Quilleré, directeur de la danse du Ballet de l’Opéra national de Bordeaux, que Xenia Wiest a créé une œuvre entièrement féminine, sur pointes, intitulée Beauties and Beasts. Bien entendu, le titre fait allusion au célèbre conte La Belle et la Bête, mais le passage par le pluriel en modifie légèrement le sens, tout comme l’anglais que l’on peut traduire par « des beautés et des bêtes » ce qui justifie l’interprétation de la chorégraphe qui oppose dans ce ballet la bestialité de la jeunesse à la beauté de l’âge mur. Autrement dit, différents âges de la vie d’une femme.
Volontairement agressif, Beauties and Beasts ouvre par des déboulés et des tours piqués sur pointes, suivis de fouettés, comme pour marquer l’arrogance de cette première entrée de la « Bête » (Vanessa Feuillatte) bientôt rejointe par une meute. Les costumes, des justaucorps bleu-vert-nuit et les pointes soulignent le côté performatif de cet ensemble qui enchaîne tours fougueux, déhanchements et pas fiévreux bien marqués, battant des pointes sur la musique flamenco (La Plata de Rosalia). Et qui dit Espagne dit aussi éventails. Ceux-ci ne manquent pas d’arriver dans les mains de nos ibériques amazones, accessoire féminin par excellence, outil de séduction et marqueur social. Cette section, à la gestuelle incisive et rapide représente l’adolescence selon Xenia Wiest. C’est alors qu’entre la « Beauté » (Diane Le Floc’h). Vêtue d’une robe longue bleue, celle-ci déploie des gestes mesurés, des allongements nostalgiques en arabesques étirées, les bras servant de prolongement à tout le corps dans une sorte d’élégie romantique, avant que des accents un peu jazzy, ne viennent perturber ce solo tout en sérénité.
Galerie photos © Maria Helena Buckley.
La musique signée Bhima Yunusov, un faux mélodique un peu sirupeux, ajoute à cette atmosphère mélancolique, apanage d’une maturité réflexive et « Belle ». Quand les autres danseuses reviennent, elles se déploient en petits groupes, croisant les lignes de la chorégraphie en tours et arabesques et faisant émerger du chaos une certaine sagesse qui se matérialise dans cette écriture très maîtrisée.
Enfin, la troisième partie beaucoup plus jazz réunit « Beautés et Bêtes » dans une seule et même ligne diagonale, laissant place à un duo fantastique entre la jeunesse et la maturité, la « Bête » tout en heurts sauvages, et la « Belle » tout en extensions paisibles, tandis que du sable s’écoule des cintres sur la scène et qu’un nuage de fumée évoque le passage du temps.

Après ce ballet de danseuses, Obsidian Tear de Wayne McGregor a été chorégraphié uniquement pour des danseurs. Le premier d’entre eux, torse nu et jupe pantalon rouge (extraordinaire Riku Ota), se meut lentement en courbes infinies, tandis qu’un autre (Ashley Whittle), dans la même tenue, mais en noir, lui répond. Plutôt qu’un duo, ce sont deux solos en miroir qui s’accordent et se désaccordent, l’homme en rouge extrêmement fluide, dans ses tours finis pliés au sol, dans ses ports de bras moelleux, l’homme en noir plus précis, plus pressé et plus sec. Il y a quelque chose du Chant du compagnon errant de Béjart dans ce Pas de deux contemporain, qui évoque l’ami ou l’ombre qui l’accompagne, ou peut-être d’un Orphée qui retrouverait un Eurydice masculin.

Toujours est-il que dans ce ballet, Wayne McGregor développe une intelligence du discours chorégraphique tout à fait exceptionnelle, ne s’appuyant que sur des inflexions du dos, des déroulés de bras qui soudain font sens. Il faut dire que la musique, signée Esa-Pekka Salonen et intitulée Nyx, comme la déesse de la Nuit, fille du Chaos, mère de la Mort, le Sommeil, la Destruction et d’Eros, offre un cadre dramaturgique formidable. C’est d’ailleurs en l’entendant lors de sa création en 2011 que McGregor a eu l’intuition de cette chorégraphie mystérieuse, sombre et brillante comme l’obsidienne de son titre. S’y insère également Lachen verlernt (Désapprendre à rire) du même compositeur et son violon déchirant (Tear, signifiant aussi déchirer). L’autre source d’inspiration étant une légende amérindienne racontant le sort d’une tribu poursuivie par une cavalerie américaine qui préféra sauter d’une falaise plutôt qu’être vaincue, les larmes de leurs proches se transformant en « larmes d’obsidienne ».Cette pierre noire et réfléchissante naît de la roche en fusion, transformée en lave, puis refroidie brutalement. C’est pourquoi dans la scénographie, s’affrontent le noir et le rouge incandescent, apparu comme une bande lumineuse en avant-scène, ou baignant tout l’espace. La gestuelle est à la fois classique et très originale – très exigeante également, avec ses tours sautés en attitude, sa souplesse, ses portés fugaces et ses explosions brusques, ou ses mouvements de tendresse assez fraternelle quand ils se tiennent par les épaules. Mais surtout elle distille une ambiguïté permanente dans ces rapports de domination, où l’on ne sait plus qui manipule l’autre, s’il s’agit d’un reflet, d’un double, si c’est de l’amour de l’admiration, ou de l’amitié… Mais sans la moindre tentative de séduction.
S’y insère également Lachen verlernt (Désapprendre à rire) du même compositeur et son violon déchirant (Tear, signifiant aussi déchirer). L’autre source d’inspiration étant une légende amérindienne racontant le sort d’une tribu poursuivie par une cavalerie américaine qui préféra sauter d’une falaise plutôt qu’être vaincue, les larmes de leurs proches se transformant en « larmes d’obsidienne ».Cette pierre noire et réfléchissante naît de la roche en fusion, transformée en lave, puis refroidie brutalement. C’est pourquoi dans la scénographie, s’affrontent le noir et le rouge incandescent, apparu comme une bande lumineuse en avant-scène, ou baignant tout l’espace. La gestuelle est à la fois classique et très originale – très exigeante également, avec ses tours sautés en attitude, sa souplesse, ses portés fugaces et ses explosions brusques, ou ses mouvements de tendresse assez fraternelle quand ils se tiennent par les épaules. Mais surtout elle distille une ambiguïté permanente dans ces rapports de domination, où l’on ne sait plus qui manipule l’autre, s’il s’agit d’un reflet, d’un double, si c’est de l’amour de l’admiration, ou de l’amitié… Mais sans la moindre tentative de séduction.
Tout va changer avec l’arrivée d’un troisième personnage (Marc-Emmanuel Zanoli) en robe noire très « couture » avec ses développés musculeux et ses pas étirés à souhait.
Bientôt rejoints par d’autres hommes en noir (tous habillés par Katie Shillingford, célèbre directrice mode ayant rassemblé pour l’occasion des pièces de créateurs emblématiques), Obsidian Tear devient plus sulfureuse, plus dangereuse, plus transgressive. Rien n’est souligné, ni même affiché, mais l’atmosphère sécrète une sorte de backstage beaucoup plus violent que ce qui est montré sur le plateau, une sorte d’Enfer caché. Sur le plateau les corps apparaissent comme des hiéroglyphes, puis s’enchevêtrent, tandis que l’Homme en rouge est peu à peu écarté, puis molesté. Rite ? Sacrifice ? Il y a de l’Élu(e) dans ce personnage décalé tout en flexibilité face à cette meute qui le traque. Mais aussi une sorte d’érotisme sombre et fascinant, comme l’obsidienne chatoyante devenue verre volcanique. La chorégraphie aussi se fait éruptive, impétueuse, rude. Sauts et tours s’accélèrent. L’homme en rouge est sans cesse agressé, jusqu’à finir à la trappe ! Comme à la fin l’homme en noir qui l’y avait précipité.
 Parce qu’elle était la lauréate du Prix du jury au Concours de Biarritz 2023 qui récompense les jeunes chorégraphes, le Ballet de l’Opéra national de Bordeaux a passé commande à Ana Isabel Casquilho de ce Between Worlds. Dès le début nous comprenons qu’il s’agit d’un même organisme incarné par de nombreux danseurs qui se meut sous nos yeux. Mais elle s’inspire aussi de la paralysie du sommeil, un état qu’elle a elle-même vécu et dont elle exprime les contradictions entre physique et mental via cet être pluriel, qui peut bouger d’un côté tout en étant figé de l’autre. Pour traduire chorégraphiquement ce hiatus entre deux mondes (Between Worlds), elle utilise toutes les techniques à sa disposition, d’où un vocabulaire assez étonnant et plutôt dynamique, qui mêle à la danse classique, la technique Graham, des déploiements de bras à partir d’une ligne de face qui rappellent tout autant les canons chers à Crystal Pite que la danse traditionnelle chinoise, mais aussi des élans plus jazzy américains à la Robbins ou Ailey. Ce qui donne au finale une pièce pour onze danseurs et danseuses très prometteuse. Dommage que le patchwork musical ne serve sans doute pas cette création comme elle le mériterait.
Parce qu’elle était la lauréate du Prix du jury au Concours de Biarritz 2023 qui récompense les jeunes chorégraphes, le Ballet de l’Opéra national de Bordeaux a passé commande à Ana Isabel Casquilho de ce Between Worlds. Dès le début nous comprenons qu’il s’agit d’un même organisme incarné par de nombreux danseurs qui se meut sous nos yeux. Mais elle s’inspire aussi de la paralysie du sommeil, un état qu’elle a elle-même vécu et dont elle exprime les contradictions entre physique et mental via cet être pluriel, qui peut bouger d’un côté tout en étant figé de l’autre. Pour traduire chorégraphiquement ce hiatus entre deux mondes (Between Worlds), elle utilise toutes les techniques à sa disposition, d’où un vocabulaire assez étonnant et plutôt dynamique, qui mêle à la danse classique, la technique Graham, des déploiements de bras à partir d’une ligne de face qui rappellent tout autant les canons chers à Crystal Pite que la danse traditionnelle chinoise, mais aussi des élans plus jazzy américains à la Robbins ou Ailey. Ce qui donne au finale une pièce pour onze danseurs et danseuses très prometteuse. Dommage que le patchwork musical ne serve sans doute pas cette création comme elle le mériterait.
Galerie photos © Maria Helena Buckley.
Enfin, Sleight of Hand de Sól León et Paul Lightfoot sur le deuxième mouvement de la Symphonie N°2 de Philip Glass, ouvre sur une magnifique scénographie, dominée par l’obscurité, avec deux personnages, une femme, un homme, perchés à six mètres de hauteur, leurs longues jupes descendant jusqu’au sol, silhouettes étranges et empêchées, puisque seul leur buste peut bouger, aux allures de puritains aussi représentatifs de l’art américain à la Grant Wood (American Gothic) que de la peinture hollandaise et sa palette de noirs à n’en plus finir. À leurs pieds, un couple émerge de sous la scène, et danse un duo hallucinatoire (Perle Villette de Callenstein et Tangui Trévinal) quand surgit un Joker (Riku Ota). Ces trois interprètes semblent pouvoir plier leurs corps à toutes les fantaisies, aux portés les plus exacerbés, aux étreintes les plus ardentes, aux attentes les plus fébriles. Bientôt rejoints par trois autres danseurs, la chorégraphie se déroule dans cette ambiance ésotérique, où la vérité se dissimule ou plutôt s’escamote dans l’ombre environnante, comme le suggère le titre qui signifie « tour de passe passe ». C’est ainsi que peu à peu la femme suspendue se déshabille subrepticement, que la chorégraphie, énigmatique et fascinante, se déploie dans une ambiance surréelle, épousant rêves et cauchemars. Nous plongeons petit à petit dans un autre monde où le rêve et la fiction se confondent dans ce monde indéfinissable. La gestuelle a un rythme formidable, et enchaîne mouvements virtuoses et figures inconnues avec une maestria absolue. Sleight Hand signifie aussi manipulation. Et c’est bien de la manipulation des corps de ces six danseurs entre eux, qui se portent, se tirent, se débattent dans une gestuelle nerveuse, agitée parfois de spasmes, jusqu’aux bouches qui crient en silence, dont il est question... Mais ne serait-ce pas ces deux personnages tutélaires qui tireraient les fils de ces marionnettes danseurs ? À moins que, comme le suggère la fin avec cette femme seule aux courbures animales devant le rideau, ce ne soit elle qui ait inventé toute cette histoire qui disparaît soudain… en un tournemain !
À leurs pieds, un couple émerge de sous la scène, et danse un duo hallucinatoire (Perle Villette de Callenstein et Tangui Trévinal) quand surgit un Joker (Riku Ota). Ces trois interprètes semblent pouvoir plier leurs corps à toutes les fantaisies, aux portés les plus exacerbés, aux étreintes les plus ardentes, aux attentes les plus fébriles. Bientôt rejoints par trois autres danseurs, la chorégraphie se déroule dans cette ambiance ésotérique, où la vérité se dissimule ou plutôt s’escamote dans l’ombre environnante, comme le suggère le titre qui signifie « tour de passe passe ». C’est ainsi que peu à peu la femme suspendue se déshabille subrepticement, que la chorégraphie, énigmatique et fascinante, se déploie dans une ambiance surréelle, épousant rêves et cauchemars. Nous plongeons petit à petit dans un autre monde où le rêve et la fiction se confondent dans ce monde indéfinissable. La gestuelle a un rythme formidable, et enchaîne mouvements virtuoses et figures inconnues avec une maestria absolue. Sleight Hand signifie aussi manipulation. Et c’est bien de la manipulation des corps de ces six danseurs entre eux, qui se portent, se tirent, se débattent dans une gestuelle nerveuse, agitée parfois de spasmes, jusqu’aux bouches qui crient en silence, dont il est question... Mais ne serait-ce pas ces deux personnages tutélaires qui tireraient les fils de ces marionnettes danseurs ? À moins que, comme le suggère la fin avec cette femme seule aux courbures animales devant le rideau, ce ne soit elle qui ait inventé toute cette histoire qui disparaît soudain… en un tournemain !
Agnès Izrine
Le 8 avril 2025, Opéra national de Bordeaux. Et juqu’au 16 avril 2025.
Distribution
Beauties and Beasts Création mondiale - pièce pour 10 danseuses
Chorégraphie et lumières, Xenia Wiest
Concept, Alberto Mendia, Xenia Wiest
Musiques, Francis Hime, Rosalia, Bhima Yunusov
Costumes et scénographie, Darko Petrovic
Assistant lumières, Pascal Cantaloup
Beauty : Diane Le Floc’h,
Beast : Vanessa Feuillatte
Beauties and Beasts :Lucia Rios, Anaëlle Mariat, Marini Da Silva Vianna, Mélissa Patriarche, Sarah Leduc, Charlotte Meier, Emma Fazzi,, Anna Gého.
Obsidian Tear
Conception, direction et chorégraphie, Wayne McGregor
Musique, Esa-Pekka Salonen
Conception des décors, Wayne McGregor
Directrice de la mode, Katie Shillingford
Conception des lumières, Lucy Carter
Dramaturgie, Uzma Hameed
Répétitrice, Amanda Eyles
Coaching, Antoine Vereecken, Neil Fleming Brown
Costumes en association avec Assaf Reeb, Vivienne Westwood, Craig Green, Telfar, Christopher Shannon, Julius, Gareth Pugh, Hood by Air
Lumières réalisées par John-Paul Percox
Supervision technique, Catherine Smith
RIku Ota, Ashley Whittle, Marc-Emmanuel Zanoli, Riccardo Zuddas, Tangui Trévinal, Diego Lima, José Costa, Marco Di Salvo, Guillaume Debut.
Obsidian Tear a été initialement commandé par le Royal Ballet et le Boston Ballet et a été créé au Royal Opera House, Covent Garden le 28 mai 2017.
Between Worlds
Création mondiale - pièce pour 11 danseurs
Chorégraphie et lumières, Ana Isabel Casquilho
Assistant à la chorégraphie, Miguel Esteves
Musiques, David Nigro, John Lennon, Phoria, David Darling
Assistante à la scénographie, Pilar Camps
Assistant costumes, Jean-Philippe Blanc
Assistant lumières, Pascal Cantaloup
Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux
Charlotte Meier, Clara Spitz, Emma Fazzi, Mélissa Patriarche, Sarah Leduc, Diego Lima, José Costa, Kohaku Journe, Marco Di Salvo, Riccardo Zuddas.
Sleight of Hand :
Chorégraphie, Sol León & Paul Lightfoot
Répétiteurs, Roger van der Poel et Menghan Lou
Musique, Philip Glass
Lumières, Tom Bevoort réalisées par Jolanda de Kleine
Supervision technique, Eric Blom
Supervision des costumes, Joke Visser
Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux
Queen of hearts : Hélène Bernadou, King of Spades : Kylian Tilagone, Joker : Riku Ota, Darks Chevaliers : Simon Asselin, Guillaume Debut, Ashley Whittle, The Couple : Perle Vilette de Callenstien, Tangui Trévinal.
Production Opéra National de Bordeaux | Production Opéra national de Paris (Costumes de Sleight of Hand) En partenariat avec l’Opéra national de Paris, le CCN Malandain Ballet Biarritz et le CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin
Catégories: