Balanchine, Teshigawara, Bausch à l'Opéra de Paris
L’Opéra de Paris présente un nouveau programme, avec Agon de Balanchine, une création de Saburo Teshigawara, mais c’est le Sacre de Pina Bausch qui emporte le tout… Et Esa-Pekka Salonen !
Galeries photos : Laurent Philippe
Quand le Ballet de l’Opéra de Paris cessera-t-il de nous rabâcher du Balanchine ? Depuis la direction de Millepied (de 2014 à 2016, issu, on le sait du New York City Ballet) on a eu droit, en moyenne, à trois programmes Balanchine par saison. Et malheureusement, c’est un style qui a terriblement vieilli.
Nous avions pensé qu’Agon (1957, entrée au répertoire de l’Opéra de Paris en 1974) était de ces pièces qui pourraient résister. En effet, la pièce, très abstraite, d’une rigueur chorégraphique à toute épreuve, a tout, en théorie, pour éviter l’outrage des ans. Pourtant, en regardant cette pièce, l’impression de voir une pièce de musée qui aurait pris la poussière domine, contrairement à n’importe quelle œuvre de Cunningham de la même époque.Et rien n’y fait. Ni l’excellence des étoiles qui brillent malgré les difficultés tendues par Mr. B., ni la sobriété des costumes (tunique et collant de travail) qui pourraient être ceux d’aujourd’hui, ni même la partition de Stravinsky ne tiennent le choc. À quoi donc tient ce sentiment ?
Sans doute au lexique utilisé par Balanchine, au fond très classique et pas très inventif (beaucoup de battements, d’arabesques et d’attitudes), et aux tournures qu’il leur a données, ces fameux décalages, décadrages, qui aujourd’hui ne produisent plus l’effet de modernité escompté : on a été tellement plus loin depuis ! Peut-être est-ce le fait de cette sensation permanente de contrainte technique, à une époque où la danse américaine, puis la danse contemporaine, ont su imposer une virtuosité inouïe en défiant les lois anatomiques et celles de l’équilibre tout en donnant une impression de liberté formidable.
Pour revenir à la représentation, malgré des enchevêtrements un peu maladroits dans les ensembles, les deux pas de trois (Arthus Raveau, Hannah O’Neill, Sae Eun Park, et Dorothée Gilbert, Audric Bezard, Folrian Magnenet) et le pas de deux (Myriam Ould Braham, et Karl Paquette) nous ont éblouis. Dorothée Gilbert rayonne et maîtrise le style à merveille, Myriam Ould Braham est d’une légèreté et d’une musicalité parfaite, et les O’Neill et Park sont d’une précision remarquable.
Changement de ton avec la création de Saburo Teshigawara, Grand Miroir, qui tire son titre d’un poème des Fleurs du mal de Charles Baudelaire , intitulé La Musique. Ça tombe bien, car la chorégraphie s’appuie sur le Concerto pour violon d’Esa-Pekka Salonen, qui, cerise sur le gâteau, dirigeait tout le programme de la soirée. Et ce Concerto est à découvrir absolument. Interprété par la violoniste Akiko Suwanai, l’instrument se fait à la fois ductile, insistant, interrogatif, séducteur, tandis que l’orchestre ajoute une ponctuation et une profondeur de timbres comme une profondeur de champ en photo, dessinant une sorte de paysage sonore. Jouant de dynamisme, de surprises, d’harmonies inventives, c’est une partition formidable.
La création de Teshigawara, est, d’une certaine manière, plus convenue. En torsades et en spirales, prise dans un mouvement permanent mais assez homogène, avec de grands moulinets de bras, la chorégraphie tourbillone comme souvent chez Teshigawara, sans pour autant que cette énergie arrive vraiment à nous soulever. Les lumières et les costumes lorgnent curieusement vers Rave, une pièce de Karole Armitage (créée pour le Ballet de Lorraine en 2001) où les corps étaient peints de couleurs vives comme dans cette pièce.
Dans Grand Miroir, on s’interroge sur le sens de cet effet chromatique. Ici encore, les danseurs (Emilie Cozette, Héloïse Bourdon, Lydie Vareilhes, Juliette Hilaire, Amélie Johannidès, Mathieu Ganio, Germain Louvet, Grégory Gaillard, Antonio Conforti, Julien Guillemard,), se surpassent, dynamiques, emportés.
Mais le « clou » du spectacle reste, comme toujours, Le Sacre du printemps de Pina Bausch (1975, entrée au répertoire de l’Opéra en 1997) avec le chef-d’œuvre de Stravinsky dirigé par Esa-Pekka Salonen, un vrai régal ! Les danseurs de l’Opéra maîtrisent à merveille la pièce de Pina Bausch. Et même la mise de la terre sur le plateau est devenu un rituel pour les spectateurs qui saluent comme il se doit le ballet des techniciens de l'Opéra.
Leurs courses pleine terre foudroyantes, leurs cavalcades effrénées, L’Elue d’Alice Renavand tend à devenir une référence, tant elle iest bouleversante dans son interprétation, sauvage dans sa danse, poignante dans sa chute. Eleonora Abbagnato se distingue à ses côtés, même un peu en retrait. Elles réussissent à nous faire passer par toute une gamme d’affects sans jamais exagérer leur expression.
Attention : Distribution de la galerie photo différente : L'Elue par Eleonora Abbagnato
L’émotion, le trouble, restent intact malgré les reprises et les années qui passent. C’est ainsi que l’on reconnaît les œuvres capables de s’inscrire dans l’histoire de l’Art.
Agnès Izrine
Opéra Garnier, le 31 octobre 2017.
Catégories:













































































































































































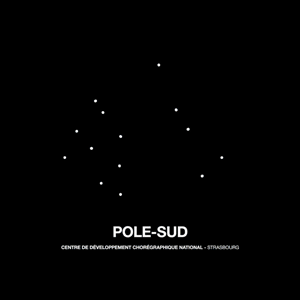









Add new comment