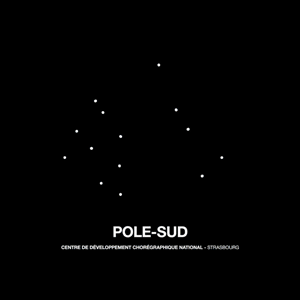Add new comment
« Le journal d'un disparu » mis en scène par Christian Rizzo
Le chorégraphe dispose une boîte à histoires, qui déplace les axes de vision des spectateurs
Le directeur musical de la récente production du Journal d'un disparu par l'Opéra de Lille,Alain Planès, ne cache pas quel fut son étonnement, au moment où il apprit que le metteur en scène retenu serait un chorégraphe. Mais qu'allait-il donc bien pouvoir chorégraphier, se demandait-il, dans le bref récit opératique de Leŏs Janáček (1917), qui n'appelle aucun ballet, et ne convoque sur scène que deux chanteurs ? Ce metteur en scène est Christian Rizzo. Lequel y trouve l'occasion de se confronter pour la troisième fois à l'art lyrique.
- "Journal d'un disparu" @ D.R.
En effet, nul ballet n'émaille la forme de narration sous laquelle se présente Le journal d'un disparu ; ni même vraiment d'action, puisque ce poème scénique nous livre le récit d'une situation, plutôt qu'il n'en déploie l'action dramatique. Or Rizzo est un chorégraphe plasticien. Son souci ne sera pas de diriger une action, qui au demeurant ne s'incarne pas ; mais de mettre en jeu des points de vue sur des matières, dégageant les perspectives qui animent le narrateur, et partant, déterminent aussi le regard et l'écoute du spectateur.
Au reste, les préoccupations dont traite Le journal d'un disparu ne sont pas sans réplique d'actualité. La pièce raconte l'histoire d'un amour quasi impossible, éprouvé par le jeune paysan Janick, pour une tzigane, Zefka. Soit une relation sociale frappée d'interdit – tzigane peut aussi se dire rom, plus ou moins – et le malheureux Janick devra se résoudre à rompre avec sa communauté de souche.
- "Journal d'un disparu" @ D.R.
Ce récit est précédé par un cycle de mélodies pour choeur d'hommes, dont les paroles restituent l'atmosphère champêtre traditionnelle d'Europe centrale, que cette histoire a pour cadre. A ce stade, on remarque le travail de Rizzo à travers un jeu d'allers et venues animant des caissons de bois mobiles, porteurs d'un pan de grille, au design très contemporain, s'agençant à la façon d'un jeu de construction géant. Leurs déplacements, incessants, autour des chanteurs, paraît un peu vain.
Il en va tout autrement lorsque le chœur quitte le plateau, pour laisser place aux solistes. Alors la cage de scène se dégage avec plus d'ampleur. On y perçoit, avec beaucoup d'acuité, les lignes perspectives d'un plancher surélevé, venant buter au pied d'un solide plan dressé en fond de scène, et continuant là son effet de stries, cette fois à la verticale ; ces deux éléments sont du même bois que celui déjà évoqué pour les caissons roulants, désormais alignés en mur ajouré (par les grilles) sur l'un des bords de scène.
Les déterminations des axes de regard sont ici très prégnantes, avec un effet de solide boîte à histoires, où vont se débattre, oppressés, le narrateur, et la tzigane Zefka ; laquelle est la seule protagoniste incarnée de cette histoire. Un jeu d'avancées et reculs coulissant dans le fond de scène, fera apparaître cette dernière toute iconique, nichée dans sa propre cage de scène, gigogne emboîtée dans le volume scénique, avec un rayonnement doublé d'éloignement.
- "Journal d'un disparu" @ D.R.
Mais la plupart du temps, le vaste plan du fond de scène fonctionne tel un écran de projection, que balayent les images vidéographiques géantes de Sophie Laly. Ces vues sont celles de paysages agrestes, sylvestres, qui résonnent avec la contexte campagnard de cette histoire, mais qui sont traités ici avec une insistance des durées, une amplitude cinémascopique, une absence de vie humaine, une quasi immobilité juste troublée de quelques vibrations dues au vent notamment.
Une atmosphère extrêmement tendue est ainsi créée, qui n'a rien d'un angélisme bucolique, et dont les puissances d'hypnose, les dimensions d'échappée, sont émaillées d'inquiétante étrangeté. Cela redouble avec des avancées et recul de la structure support, glissant sur le plateau vers les spectateurs, mais cette fois de façon aussi monumentale en taille, que discrète en vitesse, parfois proche de l'imperceptible. De tout cela émane un effet illusionniste prenant, qui jette un doute perturbateur sur toute idée qu'on aurait pu cultiver, d'une identité simple et rustique du brave et pauvre Janick évoluant dans de beaux paysages.
On peut songer alors aux dérèglements mentaux assaillant un Lenz, de Büchner, parti en randonnée aux aubes de la modernité artistique. C'est alors le lien du sujet au monde qui se réinvente, tout sauf donné d'évidence. Il va sans dire que ce questionnement du point de vue, de ses renversements, changements d'axes, évaluation de perspectives, constitue fondamentalement aussi l'expérience du spectateur. Du moins celui disposé à l'idée qu'il ne vient pas fréquenter l'art pour se rassurer dans un ordre établi de la représentation.
Au fait : ce qu'on voudra penser d'une tzigane, en tant que type social supposé, ne relève-t-il pas d'un choix, ou d'une manipulation, de point de vue ?
Gérard Mayen
16 novembre 2014 à l'Opéra de Lille.
Direction musicale Alain Planès
mise en scène Christian rizzo
Choeur de l’opéra de lille
chef de choeur Yves Parmentier
•••
scénographie Christian rizzo,
Frédéric Casanova
lumières Caty olive
création vidéo et assistante
à la mise en scène sophie laly
costumes Christian Rizzo,
Michaela Buerger
Études musicales et linguistiques
irène Kudela
Avec
Janick, le narrateur Paul o’neill
Zefka Marie Karall
Piano Alain Planès
et
Choeur de l’opéra de lille
16 voix d’hommes
ténors Gil Hanrion, Stéphane Wattez, ArnaudBaudouin, Benjamin Aguirre,Karim Bouzra, Eric Parriche, Nikola Stojcheski,Yanis Benabdallah
Basses Jérôme savelon, Thomas Flahauw, Alexandre Richez, Christophe Mafféi,Olivier Peyrebrune,Florent Huchet, François Méens,Maxime Cohen
Catégories: