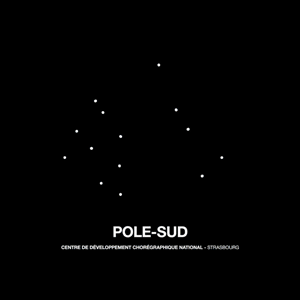Add new comment
Nivine Kallas et Bassam Abou Diab au festival de Marseille.
Deux artistes libanais présentaient des œuvres fort différentes, mais imprégnées d’un propos politique au Festival de Marseille.
FāSL de l’artiste libanaise Nivine Kallas est une vraie corps et graphie. Tout son travail s’appuyant sur le rapport de l’écriture au mouvement, le symbolisme physique et le linguistique. Travaillant sur les signes diacritiques, c’est-à-dire la manière de vocaliser en langue arabe, Nivine Kallas, attribue à chacun d’entre eux un mouvement particulier. Ainsi, selon elle, « la “fatha” qui a la valeur du [a] et le sens d’ouvrir. Elle s’appelle ainsi parce que les lèvres s’ouvrent quand on la prononce. Ce mouvement des lèvres ressemble à l’abandon, à l’ouverture et à la clarification. La “damma” qui a la valeur du [ou] et le sens de joindre s’appelle ainsi parce que les lèvres se rejoignent en signe d’amour et d’acceptation. Le mouvement des lèvres lié à la “kasra” qui a la valeur du [i] et le sens de brisure inspire douleur et régression, alors que la “sukūn” qui raconte l’absence de vocalise et qui indique le silence et la dissimulation semblable a la tranquillité qui est l’opposé du mouvement, la “sukūn” est comme le calme du cœur. »

C’est pourquoi, dans FāSL elle se lance, seule sur scène, casque sur la tête, entièrement vêtue de noir, mis à part ses pieds couverts de chaussettes rose fluo, dans ce qui semble être l’ébauche d’un enchaînement. Aussitôt, s’écrit derrière elle une ligne de gauche à droite qui, pourtant, ne correspond pas vraiment à la séquence gestuelle, une sorte de mélange entre danse classique et locking vraiment original.
Ce texte, qui continue à s’écrire en fond de scène, ressemble, si l’on y réfléchit à des hiéroglyphes, dans la beauté de leur tracé comme dans le système qui est le leur. C’est-à-dire qu’un son est représenté, littéralement par autre chose. Souvent un animal par exemple, avant de devenir signe. Et c’est exactement ce que réalise essai après essai, reprise après reprise d’un même enchaînement qui se perfectionne, se clarifie pourrait-on dire, au fur et à mesure que le spectacle avance et finit par créer du sens.

Est-ce une nouvelle écriture chorégraphique. Au fond, ça pourrait. Mais comme la musique qui est une sorte de toile de fond, un son radio qui envoie toutes sortes de propositions, un peu parasité par les stations d’à côté, de la musique pop arabe, des chants, des fragments d’une répétition d’orchestre, et des publicités, les mouvements s’autonomisent par rapport à cette écriture si nette et nous arrivons à la conclusion qu’il n’y a peut-être aucun rapport entre les deux. D’ailleurs, parfois, les signes se baladent ou s’infléchissent, comme s’ils traduisaient plutôt l’état mental, ou l’âme de la chorégraphe plutôt que la gestuelle.

Cette désarticulation au sens propre comme figuré – entre le signe et le sens, entre la « partition » et l’enchaînement de mouvement, ainsi qu’à l’intérieur de la gestuelle comme à l’intérieur de la convention linguistique – nous raconte aussi le désir d’affranchissement d’un cadre imposé, d’une forme imposée de l’extérieur, et de braver toute interdiction. A la fois beau, simple et épuré, ce court solo, très concentré au double sens du terme, fascine, autant qu’il promet un avenir à cette jeune chorégraphe.
On n’en dira peut-être pas autant de son compatriote, Bassam Abou Diab, qui présentait deux spectacles, Under the Flesh, et Pina my Love, tous deux interprétés sur le plateau par le chorégraphe sus-cité, et par le musicien percussionniste Ali Hout. Les deux performances agissent comme une catharsis, ou un acte de résistance face aux guerres, aux bombes, aux geôles ou aux tortures et paraphrasent finalement la sentence de Pina Bausch* en : « danser et rêver pour survivre à la douleur ». Mais, autant le le principe est plus qu’honorable, autant le propos rate sa cible car trop bavard au détriment d’une élaboration chorégraphique quelconque et, face à une douleur inexprimable, la volonté didactique finit par nous empêcher de le suivre.
Agnès Izrine
Les 30 juin et 1er juillet 2024, Festival de Marseille, Friche de la Belle de mai.
* « Dansez, dansez sinon nous sommes perdus »
Catégories: