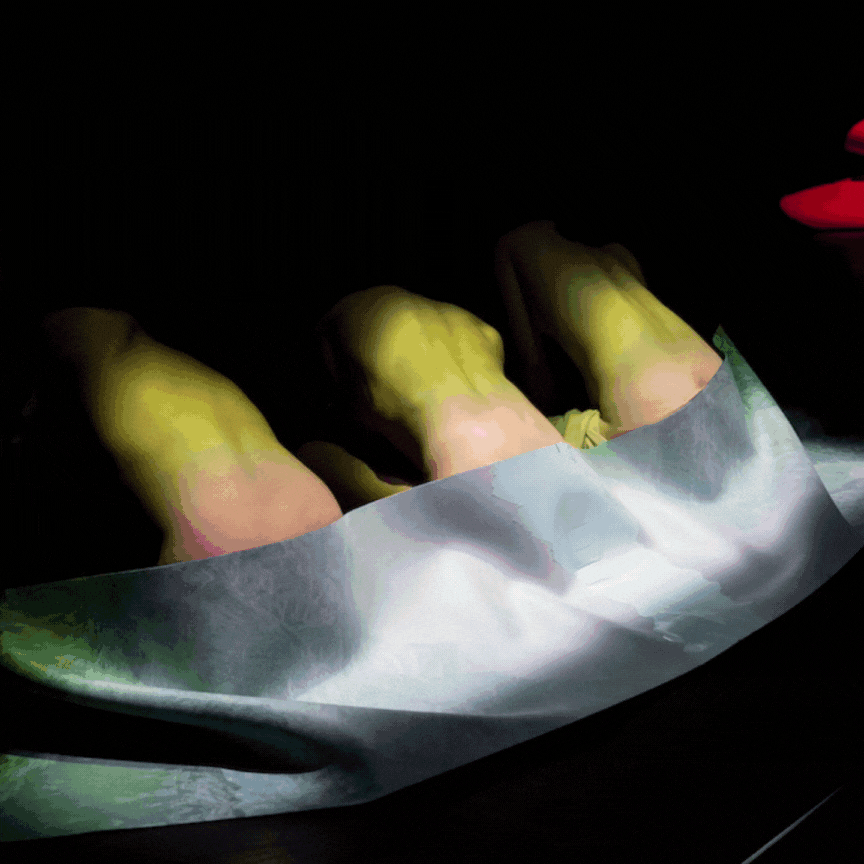Add new comment
Les prémices de la "Jeune Danse"
Avec cet article sur la danse des annnées 1970 en France, nous inaugurons une série sur l'histoire récente de la danse hexagonale très documentée, y compris visuellement, et qui devrait permettre à nos lecteurs - en tout cas nous l'espérons - de parfaire leur culture chorégraphique.
 Comme pour beaucoup de choses, l’année 1968 apparaît comme une borne temporelle, un signe ou un repère, mais reste assez peu féconde en soi. En matière de danse, par exemple, il ne se passe pas grand-chose d’important. A l'Opéra, un mouvement éphémère fait croire que le renouvellement viendra d'en haut, il n'en sera rien. Les efforts de Michel Descombey qui, après George Skibine (1958-1961) a succédé à Serge Lifar, se heurtent à la sourde inertie et aux rivalités en usage depuis toujours dans la maison. Il tiendra la barre durant les événements, mais quitte, dès 1969, l’Opéra et son ballet qui s’enfonce dans une crise profonde. « Malheureusement, tout s’est très vite refermé à l’opéra. Les postures réactionnaires se sont réactivées provoquant par exemple le départ de Michel Descombey, alors directeur de la danse, qui m’avait engagé. Les danseurs étoiles en place ont demandé à ne plus travailler avec lui quand mai 68 a cessé de vivre l’utopie. C’était une personne ouverte à l’esprit de cette période, mais cela ne correspondait pas aux désirs de certains. Je pense qu’il y a eu, d’une façon générale, après 1968, un terrible retour de manivelle », constate le danseur étoile Jean Guizerix (in Danser en Mai 1968, Premier éléments, Micadanses et Université Paris 8, Paris, 2014, p58). En 1970, Roland Petit quittera après six mois une fonction de directeur de la danse à l’opéra de paris qu’il n’a jamais pleinement pu exercer. La crise ne se résoudra pas avant de longues années.
Comme pour beaucoup de choses, l’année 1968 apparaît comme une borne temporelle, un signe ou un repère, mais reste assez peu féconde en soi. En matière de danse, par exemple, il ne se passe pas grand-chose d’important. A l'Opéra, un mouvement éphémère fait croire que le renouvellement viendra d'en haut, il n'en sera rien. Les efforts de Michel Descombey qui, après George Skibine (1958-1961) a succédé à Serge Lifar, se heurtent à la sourde inertie et aux rivalités en usage depuis toujours dans la maison. Il tiendra la barre durant les événements, mais quitte, dès 1969, l’Opéra et son ballet qui s’enfonce dans une crise profonde. « Malheureusement, tout s’est très vite refermé à l’opéra. Les postures réactionnaires se sont réactivées provoquant par exemple le départ de Michel Descombey, alors directeur de la danse, qui m’avait engagé. Les danseurs étoiles en place ont demandé à ne plus travailler avec lui quand mai 68 a cessé de vivre l’utopie. C’était une personne ouverte à l’esprit de cette période, mais cela ne correspondait pas aux désirs de certains. Je pense qu’il y a eu, d’une façon générale, après 1968, un terrible retour de manivelle », constate le danseur étoile Jean Guizerix (in Danser en Mai 1968, Premier éléments, Micadanses et Université Paris 8, Paris, 2014, p58). En 1970, Roland Petit quittera après six mois une fonction de directeur de la danse à l’opéra de paris qu’il n’a jamais pleinement pu exercer. La crise ne se résoudra pas avant de longues années.
Mais la réflexion de Jean Guizerix a le mérite de souligner combien la situation d’après mai 1968 fut plus compliquée qu’ouverte pour les artistes. En 1991 Françoise Dupuy confiait : « Puis il y a eu mai 68, qui fut un gros choc. Nous y avons participé, bien sûr. Mais ce fut quand même un choc, financier et moral. Nous n’avons plus retrouvé par la suite cette stabilité, et nous n’avons plus vraiment cherché une activité dans un théâtre lyrique. Parce que nous savions que faire une opérette toutes les trois semaines ou tous les quinze jours pour pouvoir vivre, ce n’était pas notre propos. » (Les Saisons de la Danse, N°230, décembre 1991). Il faut entendre dans cette confidence de celle qui, avec son mari, a ouvert pour partie la voie d’une reconnaissance de la danse en France, un regret caché. Pendant les années 1960, Françoise et Dominique Dupuy ont, entre Bordeaux et Mulhouse, cherché à créer et développer la danse dans le sein de maisons d’opéra. Avec énormément d’efforts, ils étaient parvenus à quelques succès que la réaction post mai 1968 rendait caduques. La danse s’entendait alors dans des maisons qui, comme l’écrivait Paul Bourcier, n’aimait ses ballets que « chichement » …
Les choses auraient pu se passer autrement. Joseph Lazzini, dans lequel beaucoup, à l’époque, voient un révolutionnaire capable de faire éclater la forme du ballet, fait beaucoup parler. Il conquiert enfin le public de la ville de Marseille dont il dirige le ballet (c’est Rosella Hightower qui lui succédera à partir de 1968). Mais surtout, il se lance, en 1969, dans l’aventure du Théâtre Français de la Danse et crée pour elle quelques pièces très novatrices dont Ecce Homo (1968 mais surtout présenté à l’Odéon en octobre 1969). A Lyon, Sparemblek après Biaggi, tentent de renouveler le ballet. Sans succès.
 Marcelle Michel, grande critique des années « Jeune danse » en écrit : « Vittorio Biaggi, Felix Blaska, Michel Descombey, Adret, d’autres encore Serge Keuten, François Guilbard… constituent ce qu’on ce que l’on pourrait appeler la génération perdue de la danse contemporaine.
Marcelle Michel, grande critique des années « Jeune danse » en écrit : « Vittorio Biaggi, Felix Blaska, Michel Descombey, Adret, d’autres encore Serge Keuten, François Guilbard… constituent ce qu’on ce que l’on pourrait appeler la génération perdue de la danse contemporaine.
Tous sont lucides, imaginatifs, ouverts, tous sont conscients d’appartenir à une époque nouvelle ; mais la culture qui l’aurait dispensé est encore celle d’un monde ancien. Chaque discipline commence à creuser son propre cheminement ; la peinture, la musique ont pris une grande avance, Elle permet à la danse d’entretenir une illusion de modernité. Mais les corps ne suivent pas ; ils sont trop marqués par l’empreinte classique » (1945-1968 : Vers le Ballet Contemporain, in Quatre siècles de danse, programme de la Biennale de la danse de Lyon 1988, p69). Mais, focalisée sur la lutte idéologique de son époque qui oppose contemporain et classique, la critique en oublie de souligner la responsabilité des structures dans cet étouffement systématique des velléités de changement. Les maisons d’opéra attendent de la danse qu’elle reproduise ad libitum l’enchantement des Ballets Russes qui servent encore d’horizon. Et il faut le rappeler clairement, il n’existe pas, alors, en France, de possibilité d’expression chorégraphique en France en dehors de ces « maisons ».
Les Ballets Felix Blaska
La tentative du Ballet Théâtre Contemporain souligne ce poids des références. Fondé le 13 octobre de cette année 1968, à Amiens, par Jean-Albert Cartier et Françoise Adret, avec le soutien de Philippe Tiry qui dirige la Maison de la Culture, le Ballet Théâtre Contemporain est financé entièrement par l’État et réunit trente-cinq danseurs. Cette compagnie s’inspire du fonctionnement des ballets mythiques (sans remonter aux Ballets Russes, au moins ceux des Champs-Elysées). La brochure-programme de sa première saison précise : « Le Ballet-Théâtre Contemporain voudrait être le point de rencontre et de synthèse entre les arts plastiques, la composition musicale et l’expression corporelle de notre temps. Il n’est pas confié à un seul créateur, mais à plusieurs, déterminant un style à l’image des préoccupations des recherches et des interrogations actuelles.
Le Ballet-Théâtre Contemporain cherche à constituer un répertoire essentiellement de création en essayant d’associer chaque fois que cela est possible, le chorégraphe, le compositeur et le scénographe dès le départ de l’œuvre à concevoir et à réaliser en commun. »
Cette approche encore largement tournée vers un passé mythique ouvre cependant quelques pistes importantes, à commencer parce que, et dès l’origine, la compagnie s’affiche comme un Centre Chorégraphique National, tous les documents de communication portant ce label. Le BTC va rester à Amiens jusqu’en 1971, avant d’émigrer d’abord à Angers où l’on installe le CNDC en 1979. Mais, Gigi Caciuleanu quittant alors Nancy pour Rennes où il est nommé directeur du Centre Chorégraphique National (CCN), la place se libère et le Ballet Théâtre Contemporain s’installe à sa place et devient le Ballet-Théâtre de Nancy… (voir le livre 50 ans de révolution chorégraphique – Du Ballet-Théâtre contemporain au CCN-Ballet de Lorraine 1968-2018 par Agnès Izrine et Laurent Goumarre, Les Presses du Réel 2020)
Ainsi, après 1968, il ne se passe pas grand-chose. On note juste cette annonce qu’un danseur américain et chorégraphe, Joseph Russillo fonde avec une égérie fantasque autant que douée, nourrie de la geste "béjartienne", l'une des toutes premières compagnies de danse contemporaine, au sens "actuel" du terme : la compagnie Anne Béranger-Joseph Russillo. Le passage de Béjart à Avignon, après les chocs successifs de 1966 et surtout 1967 (avec Roméo et Juliette et la Messe pour le temps présent), malgré un succès énorme – on parle de 60 000 spectateurs – s’est engluée dans la confusion de manifestations confuses.
Tout cela donne l'impression d’un sommeil qui semble ne devoir jamais être troublé et surtout pas par les militants engagés et souterrains, Françoise et Dominique Dupuy, Karine Waehner, Jacqueline Robinson et beaucoup d’autres en région qui tous, à leur façon et dans une égale ignorance du public, œuvrent pour qu’existent, mieux encore qu’une autre façon de danser, seulement de la danse.
La situation en est là.
Pour être juste, certaines personnalités, qui créaient et enseignaient dans un complet anonymat commencent à recevoir un début d'écho. L'atelier de la danse où Jacqueline Robinson, élève de Wigman officie depuis 1955 commence à devenir un lieu reconnu où se suivent certains noms bientôt repérés. Karin Waener danseuse et chorégraphe voit son action pédagogique reconnue, de même que celle de Françoise et Dominique Dupuy. Cette reconnaissance des pionniers assure, avec une certaine force, la persistance d'une branche "allemande" dans la danse en France. D'autres enfin, Peter Goss ou Joseph Russillo, exercent une influence certaine par le souffle différent qu'ils apportent à travers un sens pédagogique ou une maîtrise technique.
Mais c’est à travers de la danse américaine que les chorégraphes français vont trouver ces outils d’expression qui semblent leur avoir manqué. Au-delà des importants cours que l’on peut suivre à l’American Center du boulevard Raspail, la référence va s’appeler Nikolaïs. La compagnie du maître américain vient à Paris pour la première fois avec sa pièce Imago à l’occasion du festival international de danse de novembre 1968. Si l'on relève au programme de cette édition, entre autres, le Ballet de Strasbourg, celui de Winnipeg ou du théâtre Colon de Buenos Aires, les Ballets Modernes de Paris de Françoise et Dominique Dupuy, c'est Alwin Nikolais qui va constituer la révélation au point qu'Olivier Merlin, l'influent critique du Monde conclue son article, à l’issu du premier programme d’une exclamation sans ambiguïté : « la troupe d’Alwin Nikolais a été constituée aux Etats Unis il y a douze ans. Par quelle aberration nous l’avait-on cachée ? » (Le monde 10-11 novembre 1968).
Alwin Nikolaïs va devenir l'une des figures les plus en vue en France et reviendra souvent, en particulier pour des stages mémorables (La Chartreuse d'Avignon, 1977) où se presseront l'essentiel d'une génération. Mais c’est surtout à travers deux de ces danseuses que le chorégraphe va avoir une immense influence.
La première de ces épigones à venir s’installer à Paris s’appelle Susan Buirge. En 1968 à New York elle a créé Televanilla. Ce solo sur une musique de Philip Glass passe pour le premier spectacle de danse à avoir intégré la vidéo en temps réel. Auparavant, elle fut danseuse à la Murray Louis Dance Company. Et encore auparavant, chez Alwin Nikolais. A Paris, en 1970, elle fonde Danse-Theatre-Experience et commence à donner des cours dans un petit studio de la rue Marcadet qui devient une référence et les danseurs français, en attente de cette liberté que Nikolaïs a su montrer, se pressent chez Susanne Buirge qui seule enseigne alors cet esprit « Nik ».

Puis Caroyn Carlson arrive à son tour. Elle trouve d'abord un contrat de danseuse et chorégraphe dans la compagnie qu'Anne Béranger, figure flamboyante, indépendante et trés proche de Béjart, anime. Carlson y remplace Joseph Russillo, un autre Américain, et propose sa première pièce, Six Plus, en février 1972. Mais elle marque les esprits en août 1972, quand pour son passage à Avignon, la chorégraphe propose Rituel pour un rêve mort. Cette pièce ne ressemble à rien de ce que l’on a vu jusqu’alors. Construite à partir d’improvisations, très théâtralisée, fortement teintée d’onirisme voire de surréalisme, sans cette référence à la logique dramatique que le public s’attend encore à trouver dans les œuvres chorégraphiques, ce Rituel marque une rupture profonde. D’autant que la danseuse américaine, au mieux de sa forme, semble imprimer sa silhouette sur les vieilles pierres de la cour d’honneur du Palais des papes. Mais l'épisode Béranger ne dure pas. Les relations entre les danseurs de la compagnie Béranger et Carlson tanguent et l’américaine part pour Londres où elle enseigne à The Place. C’est là qu’un jeune homme très policé et un peu emprunté, vient la voir. Il s’appelle Hugues Gall, il est chargé de transmettre une invitation de la part de son directeur, Rolf Libermann lequel, nouveau « patron » commence à imprimer sa marque sur l’opéra de Paris. Et c’est ainsi que Carlson est invitée, le 24 mai 1973 à l’opéra de Paris pour créer dans le cadre de l’hommage à Edgar Varèse, un solo intitulé Density 21,5.
Cette pièce est entourée d’œuvres signées Janine Charrat (deux pièces, Offrandes et Hyperprism), Félix Blaska, John Butler, et Serge Keuten soit ce que la danse en France propose alors de plus avancé. L'œuvre n'est alors pas très appréciée, mais marque quelques esprits dont celui de Rolf Libermann, le directeur qui cherche à revivifier la maison en général et le ballet en particulier. Il propose à Carlson de rejoindre le palais Garnier et celle-ci va y provoquer une rupture esthétique majeure d’abord par sa présence personnelle sensible dans quelques solos d'anthologie, mais encore à travers le GRTOP, le Groupe de Recherche Théâtrale de l'Opéra de Paris, qu’elle anime à partir de 1975.
Cette compagnie distincte de celle de l'Opéra crée des spectacles qui sont de véritables ruptures, mais, le cours qu’elle suit tous les matins va devenir un évènement en soi. Ce cours à lieu dans la rotonde des abonnés, sous le grand escalier, est ouvert à de très nombreux danseurs qui se repassent l’information. Ces cours dont les musiciens parfois « de hasard » sont payés « au chapeau » vont faire de cette structure nichée au cœur l’Opéra de Paris mais profondément en rupture avec « la grande boutique » le point de rencontre de toute une génération. L'influence de Carlson va ainsi profondément imprégner toute une génération même après le départ de la chorégraphe pour l'Italie, en 1980.
A postériori, cette période semble donner à la danse américaine dans son ensemble une place prépondérante. Il faut cependant se souvenir que Graham ne parviendra à trouver le chemin du public français qu’après sa longue résidence de 1982 à Châteauvallon et Cunningham est encore tout à fait négligé. Malgré que les Dupuy aient permis sa venue en 1964. En 1982, quand l’Avant-Scène Ballet publie un numéro spécial Cunningham, la revue ne trouve que quatre chorégraphes « cunninghamiens » en France… La danse américaine s’impose à travers Nikolaïs via ses danseuses, avant que le style du chorégraphe finisse par s’inscrire dans le paysage avec d’autant plus de force que la direction du CNDC (Centre National de Danse Contemporaine) d’Angers lui est confié en 1978.
Cette première école de danse contemporaine, née des revendications des jeunes chorégraphes qui commencent à émerger, traduit le changement de rapport de force. Nourrie de ces nouveaux outils venus des USA, la jeune génération de chorégraphes élabore une forme, ce que l’on va appeler La Jeune Danse Française. Jeune et non nouvelle parce qu’à la différence des mouvements modernes, cette danse nouvelle ne procède pas par tabula rasa mais par synthèse, française parce que c’est en France que ces artistes vont être reconnus. Mais nous anticipons un peu.
Philippe Verrièle
Article suivant ici
Photo de preview : Messe pour le Temps présent. Maurice Béjart, 1968 © D.R.