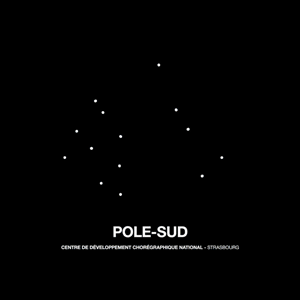Add new comment
Cinéma : « Les enfants d’Isadora » de Damien Manivel
Quatre femmes et un solo bouleversant d’Isadora Duncan, Mother (La Mère) : Damien Manivel signe un long métrage ambitieux, imparfait et touchant.
 L’affiche d’emblée questionne : on y voit une jeune femme - Agathe Bonitzer - au visage en partie coupé berçant le portrait en surimpression d’Isadora Duncan et ses deux enfants. Dans ce raccourci intriguant réside le propos du film, qui au-delà des décennies qui les séparent, veut établir, un pont émotionnel entre la danseuse mythique du siècle passé et une, ou plutôt des femmes d’aujourd’hui. Car à côté du nom d’Agathe Bonitzer sont inscrits ceux de Manon Carpentier, Marika Rizzi et… Elsa Wolliaston. Soit une très grande dame de la danse contemporaine africaine, dont chaque rare apparition est toujours un miracle d’humanité et de beauté.
L’affiche d’emblée questionne : on y voit une jeune femme - Agathe Bonitzer - au visage en partie coupé berçant le portrait en surimpression d’Isadora Duncan et ses deux enfants. Dans ce raccourci intriguant réside le propos du film, qui au-delà des décennies qui les séparent, veut établir, un pont émotionnel entre la danseuse mythique du siècle passé et une, ou plutôt des femmes d’aujourd’hui. Car à côté du nom d’Agathe Bonitzer sont inscrits ceux de Manon Carpentier, Marika Rizzi et… Elsa Wolliaston. Soit une très grande dame de la danse contemporaine africaine, dont chaque rare apparition est toujours un miracle d’humanité et de beauté.
Nous voilà donc quelque peu désorientés devant cet étrange objet cinématographique qui convoque sur le même plan des interprètes aux profils très divers. Car si Agathe Bonitzer est une actrice reconnue, qui a par ailleurs suivi des cours de danse classique, et Marika Rizzi une professionnelle aguerrie à la fois chorégraphe, enseignante et chercheuse, Manon Carpentier actrice et danseuse trisomique, fait ses débuts à l’écran. Toutes quatre se retrouvent toutefois unies par le solo intitulé Mother qu’Isadora Duncan créa en 1923 sur une étude pour piano de Scriabine, quelques années après la mort accidentelle de ses deux jeunes enfants à Paris. Tour à tour, les quatre femmes se confrontent à ce court moment de douleur et de beauté, dont il n’existe aucune image de la création mais qui a fait l’objet d’une notation Laban.
Chacune de leurs interventions, qui se succèdent, correspond à un moment et un aspect de la découverte de l’œuvre. A paris, Agathe Bonitzer lit le livre d’Isadora Duncan Ma Vie, consulte la partition chorégraphique et esquisse quelques gestes ; à Lannion, au cours de séances de travail et de répétition, Marika Rizzi transmet le solo à Manon Carpentier, jusqu’à la représentation dont on ne voit rien, hormis les réactions qu’elle suscite sur les visages en gros plan des spectateurs. Enfin parmi ceux-ci Elsa Wolliaston, de retour chez elle, en réinvente dans une trop brève séquence finale une version minimaliste et bouleversante de la pièce, en hommage à un enfant dont elle contemple la photographie.
On comprend que Damien Manivel, qui a lui-même été danseur dans sa prime jeunesse, a voulu non pas « filmer la danse » mais le sentiment qu’elle suscite, et sa trace quasi immatérielle sur les corps et dans les cœurs. De ce point de vue, l’exercice, aussi fragile soit-il, est plutôt réussi et les quatre protagonistes, chacune à leur façon, font ressentir le poids de mémoire et d’émotion porté par chaque geste. Bien vu, également, le mystère sensible de la chaîne de transmission qui lie entre eux les interprètes d’une même pièce.
Mais on regrette que la caractérisation des personnages soit si marquée (différents âges de la vie, différents statuts y compris mentaux et conditions) et surtout on regrette que la plus grande danseuse des quatre, à savoir Elsa Wolliaston, soit montrée pendant de très longues minutes sur le chemin jusqu’à son domicile comme un corps usé, déformé et souffrant, alors qu’il lui suffit de bouger une main pour être sublime. Ce qu’elle est, dans les ultimes minutes du film.
Prix de la mise en scène au festival du film de Locarno.
En salles le 20 novembre 2020
Catégories: