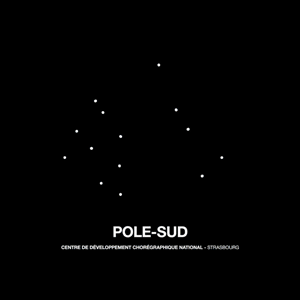La Ribot, Monnier, Rodriguez : « Please Please Please »
Courir sur place et avancer dans la réflexion
« Please Please Please » du trio La Ribot, Mathilde Monnier et Tiago Rodriguez est une brèche dans l’espace-temps à travers une dramaturgie de la durée en boucle : diffraction, reprise, footing piétinant jusqu’aux limites des corps. Et une réflexion irradiant de douleur, désarroi et ironie absurde sur la transmission contrariée de valeurs entre générations contrastées enlisées dans un monde désormais sans devenir viable.
Cosigné par les chorégraphes interprètes Mathilde Monnier et La Ribot au côté du dramaturge et metteur en scène portugais Tiago Rodriguez sachant enlacer dans une danse résistante, viscérale et vitaliste, les mots et les corps. Ceci pour un pas de deux entre affirmation et disparition, « Please Please Please ». L’intitulé vient de la ballade éponyme soul blues rock et R&B révélant James Brown en 1956. Ce dernier y aligne gémissements amoureux de sa voix rauque, sautillements, piétinements et mise à genoux en implorations au fil de ses performances scéniques.

Polysémie
L’opus appelle possiblement à construire des abris, métaphoriques ou bien réels, pour habiter et traverser autrement une terre au cœur de sa sixième extinction. Des points d’interrogations, de bravade, de résistance. Il y a dans ce trio créateur une certitude. On peut s’exercer dans la parole comme on met son corps sur le métier : mieux s’y prendre chorégraphiquement avec les mots, quitte à y trébucher. Parce qu’ils sont une balise dans le monde afin de se demander à quoi l’on souhaite s’attacher, de quoi l’on veut se défaire. Dont la planétaire « maison en feu » mise en avant par la lanceuse d’alertes climatiques et activiste suédoise, Greta Thunberg. « C’est le désespoir qui meurt en dernier », entend-on.
 Le titre peut ainsi se lire à la fois comme prière et résistance face qui réifie l’être et supplique enfantine demandant l'attention. Trois parties composent la pièce. Qui est aussi une manière de croiser, interroger et diffracter les répertoires de l’artiste madrilène et de la chorégraphe montpelliéraine. Dans la première, « Rythmes », le tandem se passe le relais de récits au gré d’une course tissée de furtifs et véloces déplacements aux quatre points cardinaux. Dans leur marathon, les interprètes enquillent plusieurs monologues alternés sous formes de brèves nouvelles intimes et fantastiques, surréalistes et historiques s’inspirant notamment des univers croisés de Borges et Tchekhov, Buzzati et Kafka.
Le titre peut ainsi se lire à la fois comme prière et résistance face qui réifie l’être et supplique enfantine demandant l'attention. Trois parties composent la pièce. Qui est aussi une manière de croiser, interroger et diffracter les répertoires de l’artiste madrilène et de la chorégraphe montpelliéraine. Dans la première, « Rythmes », le tandem se passe le relais de récits au gré d’une course tissée de furtifs et véloces déplacements aux quatre points cardinaux. Dans leur marathon, les interprètes enquillent plusieurs monologues alternés sous formes de brèves nouvelles intimes et fantastiques, surréalistes et historiques s’inspirant notamment des univers croisés de Borges et Tchekhov, Buzzati et Kafka.
Paroles dans le running
Dès l’entame au fil d’une course piétinée, La Ribot évoque ainsi une serveuse à Hiroshima surgie, solitaire, de la catastrophe dans un esprit proche du binôme Duras-Resnais pour Tu n’as rien vu à Hiroshima.
On enchaîne avec le saisissant paysage narratif posant sur le rivage une athlète handicapée espérant dans une foi déconcertante que seule l’amour comme absolu permet afin de ne pas suffoquer dans la noyade. La rencontre cauchemardée par la Ribot avec un « monstre, un animal terrible, gigantesque. Un animal étrange, dont on ne distingue pas la tête de la queue. On dirait un mélange de plusieurs animaux » Un monstre changeant d’incarnation au hasard des mauvais rêves, vers ou « baleine exilée dans le désert ».

La scénographe Annie Tolleter en donne la traduction exacte au plateau. Plus loin, la poignante lettre de Mathilde Monnier, jamais envoyée au père que tout semble opposer symétriquement et qui ressemble pourtant à sa fille, avec laquelle il mange une fois par semaine. Elle scande « Ton exception sera ma règle/Ton oui sera mon non/Ta haine sera mon amour/Ta promesse ne sera pas mon futur…».
Prenant le relais, il y a le rapport à une civilisation disparue retournant de manière saisissante la mortifère et génocidaire conquête de l’Amérique latine par les puissances européennes. Les nouvelles sont invariablement scellées par un twist ou retournement terminal. Le pari nous renseigne sur l’ambition du projet narratif : raconter le monde en quelques paragraphes, ramasser l’histoire de l’humanité en des traits originaux, érudits et ludiques. En somme, l’écriture nous propose des expériences de pensées, où le réel devient sujet de reconstruction, un support de réflexion défendant un alliage de la simplicité et de la profondeur.
 Comment la danse travaille et fait travailler le texte littéraire ? Les gestes dansés par petites foulées et déplacements rapides en latéralité, avant-arrière, cercle, les bras en balancements variés dessinent une signature graphique. Et, surtout, une manière de tamiser, infuser, mémoriser la parole comme matériau mouvementiste. Ces gestes peuvent aussi témoigner d’une variante nonsensique, métaphysique des cardio fitness traditionnellement pratiqués en batteries de salles de sports et de la religion du siècle, le jogging.
Comment la danse travaille et fait travailler le texte littéraire ? Les gestes dansés par petites foulées et déplacements rapides en latéralité, avant-arrière, cercle, les bras en balancements variés dessinent une signature graphique. Et, surtout, une manière de tamiser, infuser, mémoriser la parole comme matériau mouvementiste. Ces gestes peuvent aussi témoigner d’une variante nonsensique, métaphysique des cardio fitness traditionnellement pratiqués en batteries de salles de sports et de la religion du siècle, le jogging.
Enigme profonde, le «Je cours - ici pas uniquement sur place -donc je suis » est ici plus qu’une élémentaire dépense, le fruit d’une pression sociale ou le symptôme du société hyper-mobile qui, paradoxalement ou non, piétine. On assiste à une mise à l’épreuve physique et pneumatique du texte articulé dans la course, exercice de persévérance si essentiel à la composition chorégraphique. Peut-être courent-elles pour éprouver cette transition permanente entre le dedans et l’extérieur. Débordant d’énergie et de vitesse, le corps-locomotive en mouvement ne tente pas d’incarner les mots si ce n’est dans une urgence à dire, à chaque souffle, de la course de fond (dans tous les sens du terme) presque sur place qui rattrape ses déséquilibres, diffère ses errances et chutes. La scansion même des nouvelles dérive de plusieurs options rythmiques, percussives comme la batterie qui crée une musicalité profonde, machinique.

Relectures et danse d’insectes
On se souvient alors que dans les démarches chorégraphiques passées, la forme du marathon est présente chez La Ribot au cœur de Laughing Hole minant le rire des shows cathodiques et autres bêtisiers d’une désespérance allant en s’amplifiant au fil d’un rire continu, obsessionnel et hystérique en écho aux terreurs et scarifications tragiques vite oubliées du monde (Guantanamo, Gaza, migrants...). Du côté de Monnier, il y eut notamment Twin Paradox, inspiré des marathons dansés des années 20-30 dans l’Amérique minée par la crise économique. Sans taire leur pièce collaborative et duo, Gustavia, sa relecture de la grammaire du burlesque, dont la réitération lancinante du même geste. Une investigation malaisante et troublante des problématiques de genre aussi à travers l’absurde troublant le féminin, entre norme générique et singularité incongrue.

Second temps, la « danse des cafards » alterne convulsions et reptations frénétiques avec des stases visant à creuser littéralement le décor, s’y enfouir. Arpentant l’espace de cour à jardin, le corps dansant en transe mariant une authentique mimographie de l’insecte à des grands écarts de ballerine à l’exercice et un grotesque expressionniste et ses gestes d’arbres pétrifiés, morts cher au bûto post-apocalyptique.
De l’insecte recroquevillé à ses chassés de pattes furtifs, compulsifs. Bientôt il est posé contre l’immense lombric reposant en arc de cercle, construit d’une fine armature métallique que recouvrent tissus velours et peaux de bêtes. Ajustant leurs capuches glitter, les deux insectes dansants et scintillant ramènent de loin en loi au vide à l’intérieur du vide. Celui du terrier sanctuaire où le Grégoire Samsa de La Métamorphose kafkaïenne rêve de « ne plus entendre avec dégoût le fouissement des petits animaux ».
 Le rythme Bartók
Le rythme Bartók
Sous les lumières en fluides et imperceptibles transitions signées Eric Wurtz, la partition mouvementiste se délie sur une convocation de techniques de jeu musical comprenant notamment glissandi et pizzicatti, de violons et violoncelle due à Béla Bartók (Quatuors à cordes n° 1 à 5). Elles sont engagées avec la violence et l’intensité voulues par les corps devenus archets. Et comme relevant de l’instinct en une communauté de pensée voulue avec le besoin de sonorités et de rythmes dérangeants du compositeur hongrois.
Pertinent alors de noter que ces quatuors à cordes révélant l’inassimilation de la culture musicale classique par Bartók donnent lieu dans la danse à une refiguration/dissolution fragmentaires et sous forme de véloce morphing corporel de nombre de figures, poses, gestes et mouvements puisés au néo-classique, au moderne et aux pièces des deux interprètes notamment. Il est tout aussi symptomatique que cet épisode scénique évoquant les cafards, connus pour leur résistance à toutes formes d’apocalypse nucléaire voire climatique, soit associé à un Bartok aspirant à une harmonie de la vie basée sur la nature et la liberté.
Un compositeur à la fois cosmopolite et autochtone se dressant précocement contre les régimes fascistes, optant pour l’exil dans un pays, les Etats-Unis, où il pourra œuvrer à l’en croire, « sans renier ses idéaux et son humanisme ». Quand bien même cette nouvelle patrie se montra aussi rétive que l’ancienne à accueillir une œuvre mariant comme rarement musique folklorique, mélodies populaires et musique savante. Dépasser la supposée antinomie de la mélodie (folklorique, populaire) et du thème (savant) n’est-il pas l’un des horizons des deux chorégraphes et danseuses dans leur répertoire ?

Echange abrupt
Enfin oscillant entre incompréhension et questionnement, le dialogue au micro avorté, impossible entre deux âges que tout semble opposer, la mère - Mathilde Monnier - et sa fille nouvelle née (La Ribot) met radicalement en question la notion de devenir. Il évoque aussi la vieillesse, la fin, l’impuissance. La pièce prend acte d’un patrimoine social sur l’avenir commun des sociétés devenu éclaté, brisé par les bouleversements et crises climatiques et l’absence de perspectives d’avenir social et vital pour les nouvelles générations.
Les peaux d’un monde scénique composant l’immense ver ou « monstre » imaginaire se retrouvent in fine disséminées, retournées au plateau. Elles rappellent alors de loin en loin les vêtements comme autant de compositions colorées en attentes de récits dans certaines Pièces distinguées signées La Ribot.
Bertrand Tappolet
« Please Please Please ». Festival d’Automne. Centre Pompidou, du 17 au 20 octobre 2020.
Catégories: