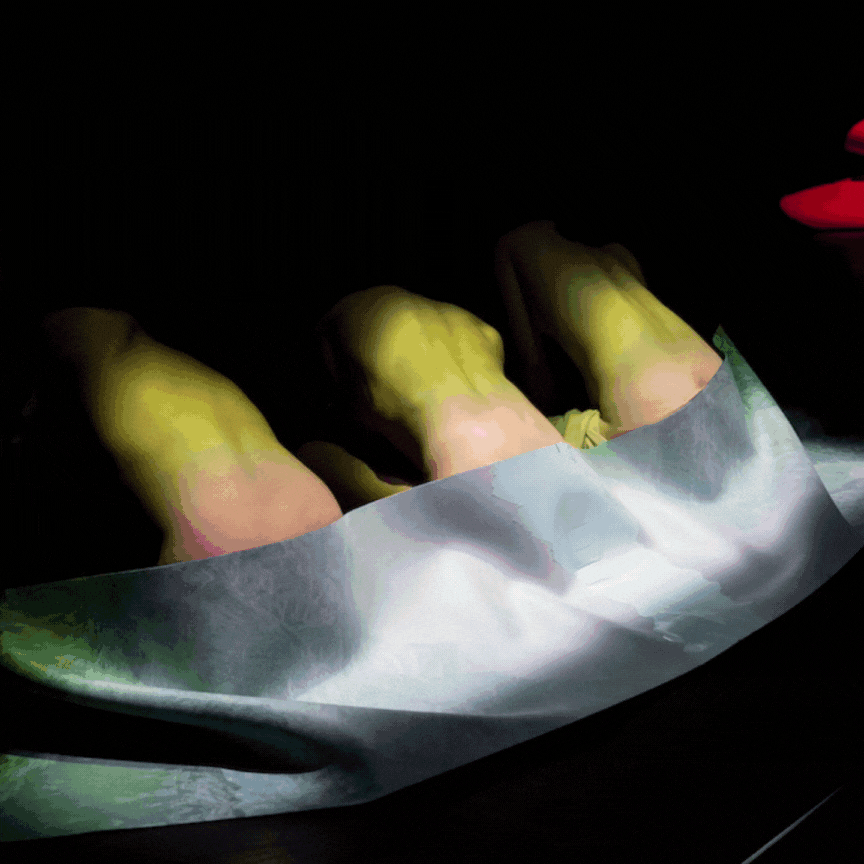Add new comment
Soirée Cherkaoui/Goecke/Lidberg à l’Opéra Garnier
Un programme très contrasté avec deux créations que tout oppose, et un prélude. De Nijinski à Nijinska, en passant par un expressionnisme haletant.
Programme très contrasté par le Ballet de l’Opéra de Paris, avec la reprise de Faun de Sidi Larbi Cherkaoui et les créations de Dogs Sleep par l’Allemand Marco Goecke ainsi que de Les Noces du Suédois Pontus Lidberg. Malgré la différence des styles, un leitmotiv, à savoir une certaine idée de l’animalité, du désir et de l’attirance érotique, permet de faire le lien entre les trois propositions, d’abord, du Faune de Debussy aux chiens de Goecke. Du moins, c’est qu’on se disait, au départ.

Mais il manque à l’interprétation de Faun de Cherkaoui un élément décisif. Car rien ne fera vibrer ce duo de l’intérieur, si ce n’est une attitude réfractaire, un frottement rebelle, un souvenir du Gestus sulfureux de Nijinski datant de 1912, plaçant l’animalité au-dessus de l’élégance, engageant une lutte voluptueuse entre le Faune et sa Nymphe. A l’origine écrit sur mesure pour James O’Hara et Daisy Philips, Faun se nourrit ce cette âme sauvage, revendiquée par Cherkaoui à la création au Sadler’s Wells en 2009. Mais Marc Moreau et Juliette Hilaire se rangent aux côtés des traits les plus aériens et élégants de la partition de Debussy. C’est beau, mais passe à côté de Cherkaoui et de Nijinski à la fois.
Galerie photo © Laurent Philippe
Un cimetière nocturne, peuplé de chiens humains
Peut-être est-ce un choix, pour faire exploser avec plus de violence l’animalité des chiens humains dans Dogs Sleep. Marco Goecke, encore peu connu en France et pourtant le chorégraphe du moment en Allemagne- et ce depuis un fort long moment - revendique être un rebelle et cultive une esthétique saccadée, répétitive et haletante. Ajoutez à cela son univers sombre, souvent angoissant mais frôlant le grotesque, et vous obtenez la relecture très contemporaine de l’expressionisme qui fait le succès de Goecke.
Il faut d’abord oser écrire, comme il l’a fait pour Dogs Sleep, écrire une pièce entière à partir de son chien. Celui de Goecke se nomme Gustav et cela fait dix ans que le basset accompagne son maître à toutes les répétitions. Mais que ressent-il, à quoi rêve un chien? Cette question fut le point de départ de la pièce. Il fallait ensuite se détacher de l’aspect attendrissant d’un tel animal de compagnie. Car le modèle qui a servi à façonner les chiens humains de Dogs Sleep est plutôt à chercher du côté des Cerbères.
Galerie photo © Laurent Philippe
Marco Goecke, perturbant
Dans cette ambiance nocturne avec son brouillard - et même l’orchestre dans la fosse en prend sa part - nous pourrions aussi nous trouver sur un cimetière ou dansent des Wilis survoltées ou autres esprits lunatiques comme dans un film d’animation, avec leurs bras mouvementés, le plus souvent répétitifs et parfois mécaniques ou obsessionnels, le chorégraphe lançant ces micro-articulations à une vitesse vertigineuse.
A partir de ce vocabulaire radical et personnel, Goecke qui décline ce style à travers toutes ces créations, questionne la perception visuelle et la frontière entre le réel et l’illusion. Il faut dire que les sept Etoiles ou Premiers Danseurs du ballet de l’Opéra - même asexués, même plongés dans le brouillard et une lumière minimale - donnent un joli coup de légèreté à une gestuelle qui a déjà été sublimée par beaucoup de compagnies à travers le monde, et notamment par les danseurs des Ballets de Monte-Carlo.
Les choix musicaux, assez fouillés, évitent toute redite avec le côté minimaliste de la gestuelle et la rendent plus effrayante encore. Le Requiem for Strings de Töru Takemitsu, le deuxième mouvement des Valses nobles et sentimentales de Ravel, le troisième mouvement des Nocturnes de Debussy et finalement April in Paris de la crooneuse Sarah Vaughan sont tout sauf répétitifs ou mécaniques et sèment quelques graines d’espoir dans un univers plutôt glaçant.
Galerie photo © Laurent Philippe
Pontus Lidberg et des Noces qui s’égarent
On était alors curieux de voir comment Pontus Lidberg allait rebondir sur Les Noces de Stravinsky et nous livrer sa vision de « ce que l’idée de noces, de mariage, peut signifier aujourd’hui », en écrivant une pièce chorégraphique volontairement détachée des versions qui se placent dans un dialogue avec la chorégraphie originale de Bronislava Nijinska de 1923. Las ! Hormis le fait d’unir, parmi les dix-huit interprètes, quelques couples du même sexe, Lidberg semble s’être inspiré avant tout de West Side Story. La partition, portée par quatre chanteurs solistes et un chœur, paraît alors infiniment plus actuelle que la chorégraphie, basée sur des entrées et sorties incessantes. Des couples et groupes se forment et se séparent et des paravents ferment et ouvrent au regard des pans du plateau alors que descendent et remontent d’énormes tableaux représentant des roses en fleur ou à éclore.

Les costumes aussi nous situent quelque part entre le théâtre scandinave du 19e siècle et West Side Story. On est bien à la campagne, comme l’avant prévu Nijinska. Le bal suit donc son cours, sans rien nous dire de plus, si ce n’est que dans la troupe dirigée par Aurélie Dupont, la jeune garde sait parfaitement épouser un registre élégant et léger, truffé de portés et d’unissons. Mais nous le savions. In fine, l’académisme inattendu de ces Noces fait du chœur le personnage principal. Il aurait alors fallu le placer sur le plateau, pour briser l’aspect trop conventionnel ce cette première création du Suédois à Paris.
Galerie photo © Laurent Philippe
Il y avait pourtant, dans le fait de débuter la soirée avec Faun et la conclusion autour du mariage, la possibilité de créer une soirée thématique fort intéressante, avec au milieu cet abyme de solitude, mais aussi les horreurs de la Grande guerre. Et peut-être était-ce l’intention d’Aurélie Dupont. Mais le rendu trop lisse des propositions autour de l’attirance et de l’érotisme enlèvent à ce programme son éclat rêvé et sa cohérence interne. On ne pourra en apprécier qu’une partie, que l’on préfère cet expressionisme hallucinant de Goecke ou l’esthétisme de Cherkaoui et Lidberg. Les uns trouveront que les portes de l’enfer grincent de façon trop ostentatoire, les autres se détourneront de la timidité des promesses de paradis.
Thomas Hahn
Vu le 5 février 2019 à l'Opéra Garnier- Paris
Catégories: