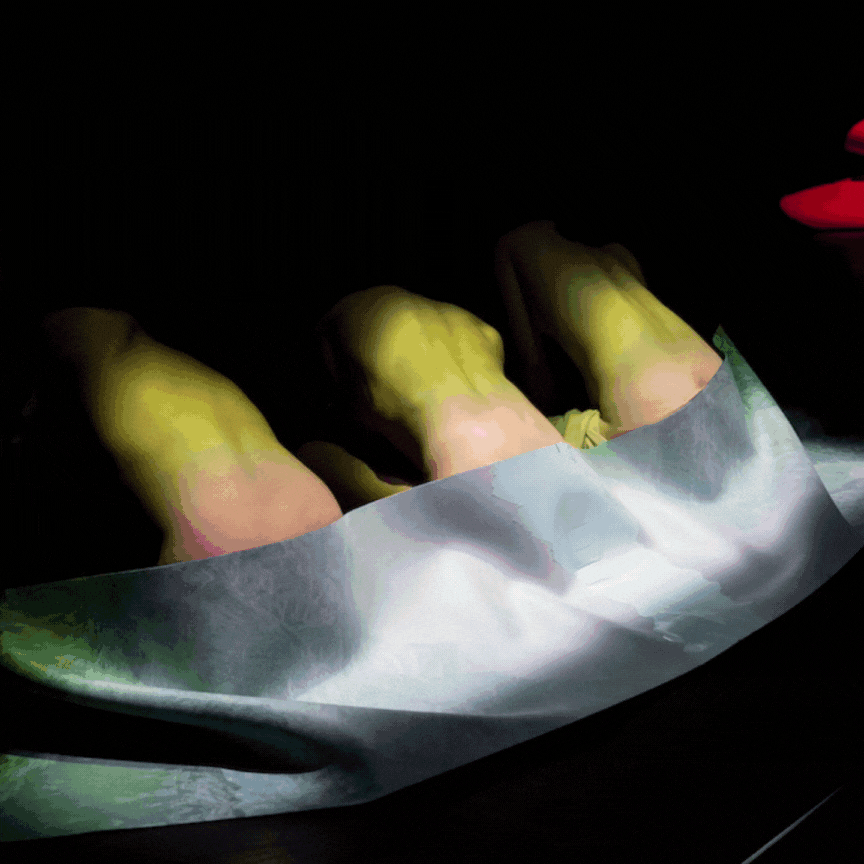Add new comment
« Che Malambo ! » à Bobino
Oh! Qué mambo! chantaient Dario Moreno et Magali Noël dans un nanar des fifties. Che malambo! dansent en rythme douze chicos venus de la pampa à Paname…
Nous avions découvert la troupe de Che Malambo ! fondée par Gilles Brinas au début des années 2000, mise en scène à l’époque avec la collaboration de Sylvie Peron, en 2007 au Casino de Paris. Parmi les douze danseurs-rythmiciens conviés par Valéry Colin à Bobino pour fêter la nouvelle année chinoise, on retrouve deux vétérans du premier casting : Walter Kochanowski et Federico Gareis, le premier très athlétique, le second au style fluide.

Le mot malambo désigne la danse percussive gauchesque qui tire son nom, pour certains – parmi lesquels la spécialiste Leila Guerriero dont l’étude sociologique, Une histoire simple, fut publiée en France par Christian Bourgois en 2017 –, du quartier africain d’une ville péruvienne, pour d’autres – dont le poète, auteur-compositeur et excellent guitariste porteño Atahualpa Yupanqui – d’un verbe d’origine indienne signifiant « galoper ». Et il faut bien dire que les cowboys argentins qu’on appelle gauchos imitent puis stylisent les allures de leur monture dans leurs taconeos ; ils sont en outre, pour la plupart, experts en agrès tels que les boleadores leur permettant d’entraver à distance les pattes des bovidés pour les capturer et les transformer en nourriture pour non végétariens ou en accessoires de maroquinerie ; ils savent aussi user du fouet et du coutelas.

L’art du malambo, une expression traditionnelle remontant à deux siècles, voire plus, synthétise le zapateado andalou, le shuffle afro-américain et les claquettes celtiques. Elle se présente sous forme guerrière, comme certaines danses cosaques et arméniennes, avec ce qu’il faut de regards menaçants d’une fierté supposée macho, quoique surjouée, très deuxième degré, comme l’étaient ceux du danseur de tango Rudolph Valentino dans Les Quatre cavaliers de l’Apocalypse (1921). Les défis symboliques et physiques qui en résultent sont proches des « battles » du hip hop. Le mot « malambo » est dans le show mis en scène et en chorégraphie par Gilles Brinas précédé de l’interjection « che » utilisée en Espagne, du côté de Valence et d’Alicante, des plus récurrentes dans plusieurs pays d’Amérique latine, en Argentine, plus particulièrement – pays d’où était originaire Ernesto Guevara, qui fut, pour cette simple caractéristique langagière, surnommé le Che.

Une docufiction inédite en France, présentée en 2018 au festival du film latin de Biarritz, réalisée par Santiago Loza, Malambo, El hombre bueno, inspirée de l’ouvrage de Leila Guerriero, traite du quotidien d’un malambiste se préparant à la compétition la plus prestigieuse qui soit, celle de Laborde. Il se trouve que plusieurs danseurs venus rue de la Gaîté sont spécialistes de cet art. L’un d’entre eux, Francisco Matias Ciares, a été plusieurs fois médaillé dans la catégorie Jeunesse au concours de la capitale ; un autre, Miguel Angel Flores, a remporté celui de Cosquin, dans la région de Córdoba, au nord du pays ; enfin, Fernando Castro et Facundo Lencina ont été champions à Laborde, petite ville située entre Rosario et Córdoba, dont un parc entier est dédié à cette manifestation, le premier en 2009, le second en 2011. Malgré son côté sensationnel, théâtral, grand public, le « ballet-concert » de Bobino demeure dans le sillon folklorique. On peut comprendre qu’il s’adorne de disciplines que contestent les puristes comme le maniement des bolas et qu’il s’affranchisse des costumes tradi, pittoresques et très coûteux.

Malgré quelque excès cabaretier, la recherche systématique, guerrière ou militaire, d’unisson, nous avons une fois encore apprécié cette interprétation d’une discipline corsetée et admiré la virtuosité d’une troupe de danseurs-rythmiciens maniant le bombo comme les tambours majors d’une armée napoléonienne. Les puristes en auront pour leur compte avec l’illustration mélodique à base de trois ou quatre accords ressassés en un rasguido ad lib. par un gratteur de six-cordes ne s’autorisant pas la moindre falseta, la moindre échappée, la moindre ornementation et, forcément, moins subtil qu’un Ata ou un Cacho Tirao. À ne vouloir conserver que les racines, la coutume ou l’usage d’un passé, somme toute, rêvé ou idéalisé, on risque de se couper du monde. Il est des chances que tout un chacun, hors pampa, puisse trouver le temps long dans les routines de deux à cinq minutes se succédant à Laborde, comme le montre la fin du film de Loza.

A Bobino, les tenues vestimentaires sont donc sobres, les débardeurs noirs élégants, les bottines, strictes et à talons, les lumières, chaleureuses et contrastées, dosées par Ryan O’Mara. Tous ces composants mettent en valeur des interprètes aux poly-expressifs. Les frappes sur les tambours bifaces, sur tout ou partie de leurs peaux, sur les colliers qui les tendent, sur les fûts taillés en principe dans des troncs d’arbres sont d’une précision démoniaque. Les frappes de bottines sont parfaitement maîtrisées sans qu’aucun danseur n’ait particulièrement voulu jouer les Fred Astaire, Savion Glover ou Israel Galván. Les passements de pieds très complexes exigés par la tradition séculaire peuvent, le cas échéant, se pratiquer pieds nus. Les numéros chorégraphiques multiplient des figures géométriques, des lignes chorales, et des courbes florales, des effets miroitants, des motifs symétriques. L’époustouflant numéro de boleadores de Daniel Medina vaut le détour. L’énergie des douze hommes nullement en colère finit par atteindre l’audience.
Nicolas Villodre
Vu le 30 janvier 2019 à Bobino
Catégories: