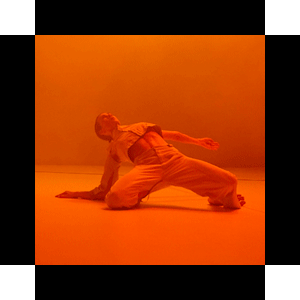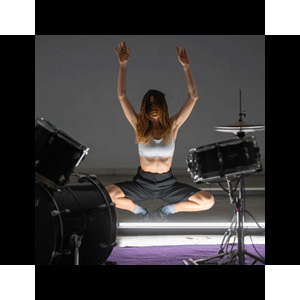Add new comment
« Harleking » de Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi
En clôture de l’édition 2018 de Signes d’automne signée Léa Poiré, l’ancien relais de poste des hauts de Belleville nous a fait découvrir Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi qui ont traité à leur façon la commedia dell’arte.
 Le titre du duo, Harleking, se joue du mot qui désigne un des personnages du théâtre populaire italien du XVIe siècle, avec un « h » aspiré germanique précédant la voyelle initiale du nom et un « king » tout ce qu’il y a de britannique, le parachevant de façon régalienne. Il faut dire qu’Arlequin (qu’incarne Enrico Ticconi) a très vite eu la prééminence sur les autres personnages de l’art de la pantomime masquée, y compris sur celui de Colombine (que représente Ginevra Panzetti).
Le titre du duo, Harleking, se joue du mot qui désigne un des personnages du théâtre populaire italien du XVIe siècle, avec un « h » aspiré germanique précédant la voyelle initiale du nom et un « king » tout ce qu’il y a de britannique, le parachevant de façon régalienne. Il faut dire qu’Arlequin (qu’incarne Enrico Ticconi) a très vite eu la prééminence sur les autres personnages de l’art de la pantomime masquée, y compris sur celui de Colombine (que représente Ginevra Panzetti).
A telle enseigne que l’arlequinade est devenue un genre théâtral en tant que tel. Le rhombe le symbolise, qui est rappelé, répété et liseré sur les côtés d’élégants collants noirs designés et portés par les interprètes puis par la projection lumineuse de deux gros losanges sur les briques murant le fond.
Si, par la force des choses, les danseurs sont contemporains – ils sont vivants ou, en tout cas, ne semblent pas être des hologrammes – leur danse ressort de l’art du mime, agrémenté d’éléments bruitistes – au sens où l’entendait Russolo –, de bribes de mots, de bouts de phrases mixés dans la B.O. de Demetrio Castellucci. La longueur de la variation sur la notion de ricanement ne se fait pas du tout sentir, la pièce étant parfaitement écrite (n’ayant plus rien d’improvisé) et, surtout, interprétée.

La structure cyclique intègre différentes phases, expressions du corps ou de particules, de celui du visage, bien sûr, mime rimant avec mine, de tous les membres, des mains comme du bout des doigts. Les lazzis et les acrobaties sont gracieusement exécutés. La légèreté du duo contraste avec le grossier simulé et ressassé ad lib. Leurs sautillements cabots sont amortis par des chaussons intemporels, quoique du dernier chic – des Trippen, modèle « Flipper » – aux semelles « pattes de velours » garnies de coussinets ou de pelotes passant sous silence la marche des félidés – le pas de chat fait d’ailleurs partie du vocabulaire du ballet.

Des hoquets secouant les corps vus d’abord de dos, ambigus comme le théâtre du même nom, sans raison apparente, qui s’avèrent être des rires et non des sanglots, aux différents degrés crispants et stades spasmodiques, les états d’âme des protagonistes s’énoncent clairement, s’accordent et se contrarient, se suivent continûment, produisent leur effet sur un public bon enfant.
Si la lamentation ne provoque pas les larmes, il n’en est pas de même du rire, suscité par nos bouffons par différents moyens ou stratagèmes. Le fou-rire initial, forcément de commande, se nourrit de lui—même et n’engendre aucune morosité, au contraire. Le rire défensif de certains spectateurs obéit aux lois conditionnant le réflexe de survie. La chute d’un des labadens, automatiquement, le fait toujours – suivant la règle formulée par Bergson. Nul doute que le « mécanique plaqué sur du vivant » soit une source ayant inspiré le couple.

La réussite de ce spectacle à base d’un « petit rien » – un sketch d’autrefois, dans le style coulé d’aujourd’hui – est due non seulement à la qualité du mouvement des interprètes mais à leur sens du rythme. Loin de lasser, la redite gestuelle étonne, amuse, excite notre curiosité.
Nicolas Villodre
Vu le 30 novembre 2018 au Regard du cygne dans le cadre du festival Signes d’automne.
Catégories: