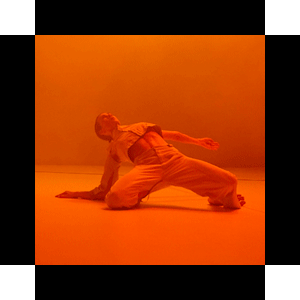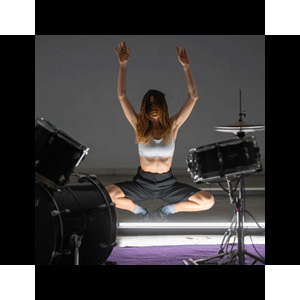Add new comment
« A Taste of Ted » de Jérôme Brabant et Maud Pizon
June Events nous a permis de découvrir la pièce de Jérôme Brabant et Maud Pizon, qu'ils interprètent, accompagnés au piano par Aurélien Richard, A Taste of Ted. Qu’en dire ?
Tout d’abord que la création contemporaine semble hésiter entre remake et ready made. Entre citation, hommage, commémoration d’une histoire balisée qui continue à fasciner, les référents étant éclos de terra incognita, et simulacre, tour de passe-passe, collage « conceptuel » pouvant à la limite se passer de matière expressive pour donner le change.
 Après Loïe Fuller et ses émules (on ne parle pas des imitatrices s’étant indûment approprié sa danse serpentine), de Michelle Nadal, qui vient de nous quitter, à Jody Sperling, en passant par Claire Rousier et Brygida Ochaïm ; après Mary Wigman dont Sylvie Guillem (puis Latifa Laâbissi) ont interprété la Danse de la sorcière ; après Valeska Gert, qui a captivé I-fang Lin et, plus récemment, Jule Flierl ; avant la reprise d’Extasis (1933) de Martha Graham par Aurélie Dupont à l’Opéra de Paris, on était curieux de voir comment Jérôme Brabant et Maud Pizon ont fait revivre les pièces du couple Ruth Saint Denis et Ted Shawn.
Après Loïe Fuller et ses émules (on ne parle pas des imitatrices s’étant indûment approprié sa danse serpentine), de Michelle Nadal, qui vient de nous quitter, à Jody Sperling, en passant par Claire Rousier et Brygida Ochaïm ; après Mary Wigman dont Sylvie Guillem (puis Latifa Laâbissi) ont interprété la Danse de la sorcière ; après Valeska Gert, qui a captivé I-fang Lin et, plus récemment, Jule Flierl ; avant la reprise d’Extasis (1933) de Martha Graham par Aurélie Dupont à l’Opéra de Paris, on était curieux de voir comment Jérôme Brabant et Maud Pizon ont fait revivre les pièces du couple Ruth Saint Denis et Ted Shawn.
La mise à distance de leur objet est obtenue grâce aux commentaires écrits par Clara Le Picard et les danseurs eux-mêmes, enregistrés plutôt que lus ou dits en direct (probablement afin d’éviter la pesanteur d’une « conférence dansée » et de consacrer toute leur énergie et assez de souffle à l’effort physique qu’exige la danse) et aux effets dramaturgiques dès l’entrée du public (cf. l’artifice de la répétition, non face au miroir mais face à l’écran d’un ordinateur diffusant les films des chorégraphies originelles).

Et aussi à l’aide des transitions entre les numéros reconstitués (qui sont au nombre de six), le pianiste jouant à l’occasion le troisième larron dans ces brèves saynètes. Les textes sont informatifs, spirituels en même temps que critiques – la notion d’exotisme y est abordée, avec sa connotation colonialiste, voire impérialiste ; elle est d’ailleurs prise à rebours par Brabant qui rappelle ses origines réunionnaises et même chinoises.
 Mis à part Egyptian Dance et Cobras, créés, l’un en 1932, l’autre en 1908, les solos et duos retenus par les chorégraphes datent des années dix. Les fondements de la technique delsartienne à laquelle avait été initiée Ruth Saint Denis leur ont été transmis à New York par un danseur, Joe Williams. Le « That’s it, Jérôme » est de ce fait un gimmick rappelant aux deux interprètes l’étape d’acquisition de ce savoir qui prend, paradoxalement, sa source en France – en pays seringueux – après avoir transité par la Californie et par la succursale aujourd’hui désaffectée du Bronx. On pourrait dire que les préceptes de Delsarte, appliqués à la danse, ceux-là mêmes qui ont inspiré les adeptes du Monte Verità, ont été pour les pionniers de la modern dance américaine l’équivalent de la Méthode de Stanislavski pour les pédagogues de l’Actors Studio.
Mis à part Egyptian Dance et Cobras, créés, l’un en 1932, l’autre en 1908, les solos et duos retenus par les chorégraphes datent des années dix. Les fondements de la technique delsartienne à laquelle avait été initiée Ruth Saint Denis leur ont été transmis à New York par un danseur, Joe Williams. Le « That’s it, Jérôme » est de ce fait un gimmick rappelant aux deux interprètes l’étape d’acquisition de ce savoir qui prend, paradoxalement, sa source en France – en pays seringueux – après avoir transité par la Californie et par la succursale aujourd’hui désaffectée du Bronx. On pourrait dire que les préceptes de Delsarte, appliqués à la danse, ceux-là mêmes qui ont inspiré les adeptes du Monte Verità, ont été pour les pionniers de la modern dance américaine l’équivalent de la Méthode de Stanislavski pour les pédagogues de l’Actors Studio.
L’importance du film dans la transmission littérale du géométrisme des pas et des gestes des bras mais aussi dans celle de l’esprit, de la manière, du style Denishawn n’est plus à démontrer. Non seulement Ruth Saint Denis n’a cessé d’être filmée jusqu’à un âge canonique, prouvant par l’exemple les qualités salutaires de sa pratique de la danse, mais elle a, très tôt, dès les années vingt, dès l’apparition des formats pour amateurs comme le 9,5 et le 16 mm, filmé les danses d’ailleurs, non dans les foires internationales ou les parcs d’attraction comme celui, cité par les jeunes danseurs français, de Coney Island, mais in situ – elle s’est bel et bien rendue en Inde et ses compositions sont relativement fidèles par exemple aux danses kathak.
 On trouve une même légèreté et un sérieux identique dans la reconstitution par Brabant et Pizon de danses pouvant nous sembler exotiques non plus en raison de l’éloignement mais du travail du temps.
On trouve une même légèreté et un sérieux identique dans la reconstitution par Brabant et Pizon de danses pouvant nous sembler exotiques non plus en raison de l’éloignement mais du travail du temps.
Les costumes de La Bourette à base de tissus bon marché chinés au marché Saint Pierre peuvent paraître sommaires, même s’ils « le font ». Les lumières de Françoise Michel valorisent parfaitement les danseurs, révèlent l’action, créent le climat le plus propice. Les partitions ont fait l’objet de recherches, de trouvailles et de prétextes à imaginer l’accompagnement musical de cette trop courte suite de danses. Aurélien Richard a interprété avec brio les thèmes de Satie, de Delibes, de Meyrowitz ainsi que ceux inventés par lui de toutes pièces. Le final purement percussif, sur un « stamping ground » fait la part belle au piano préparé atteint quasiment la transe. Il va sans dire que le trio a été plusieurs fois rappelé.
Nicolas Villodre
Vu le 14 juin 2018 à l'Atelier de Paris/CDCN dans le cadre de June Events
Catégories: