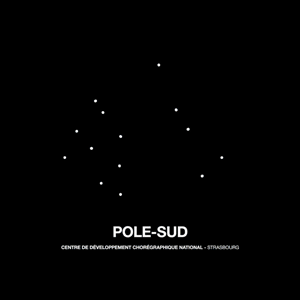Entretien avec Andréya Ouamba
Congolais d’origine, implanté à Dakar au Sénégal, Andréya Ouamba est l’une des figures internationales de la scène chorégraphique contemporaine en Afrique. Il s’apprête à présenter De quoi sommes-nous faits ?! à l’Atelier de Paris / CDCN (qui avait déjà accompagné son précédent grand projet, J’ai arrêté de croire au futur). Un musicien, une danseuse et un poète auteur dramatique évoluent sur le plateau à son côté, dans une pièce qui questionne un lien entre les structures du pouvoir masculin au sein des foyers, et le caractère autoritaire de nombreux régimes africains.
Danser Canal Historique : Lorsqu’on songe à l’engagement politique dans les pays d’Afrique, l’image qui vient volontiers à l’esprit est celle des révoltes de très jeunes gens. A 43 ans aujourd’hui, vous n’êtes plus si jeune. Or, on ressent dans vos pièces les plus récentes, une préoccupation politique grandissante, comme si cela relevait chez vous d’une avancée en maturité…
Andréya Ouamba : Plus largement, ma préoccupation grandissante se porte sur ce que je pourrais appeler la condition humaine. Par exemple, ici à Paris, la Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA) me sollicite pour conduire un projet. J’ai choisi d’y traiter de la question de ce qu’est le succès, la réussite. Je vais en passer par le football américain pour traiter de cela. Qu’est-ce que le succès ? Qu’est-ce que réussir ? Quelles contradictions peuvent animer ces notions ? J’en reviens là encore à une idée large de condition humaine. Mais il me semble qu’on peut considérer aussi que c’est très politique.

Hier, au sein même de l’équipe avec laquelle je prépare De quoi sommes-nous faits ?! une discussion est survenue sur les raisons que peuvent avoir des parents de taper sur les enfants qu’ils éduquent. C’est une question extrêmement politique. A deux niveaux. Premier niveau : c’est évidemment une façon d’exercer un pouvoir, une domination. Deuxième niveau : lorsqu’on aborde une question de ce genre, aussitôt certains viennent vous expliquer que cela vient de la tradition, qu’il s’agit de valeurs africaines, que c’est comme ça…
DCH : Justement, cette nouvelle pièce que vous préparez conduit une réflexion critique sur la question de l’autorité paternelle. Vous vous demandez s’il ne faut pas aller chercher de ce côté-là pour expliquer l’entretien de régimes politiques autoritaires. Or, il est commun de considérer que l’une des forces de l’Afrique est l’entretien de valeurs de cohésion sociale bien enracinées. N’est-ce pas cela que vous venez ébranler en mettant en doute le bien-fondé de la toute puissance paternelle ? Ressentez-vous une attente, une écoute possible sur ce genre de question ? N’est-ce pas un peu tabou ?
Andréya Ouamba : C’est toute la question. Beaucoup de gens sont incapables d’avoir la moindre distance pour affronter ce genre de questions. Ils se rassurent, en se racontant que de tout temps les choses ont été comme ça, et qu’il n’y a pas à les discuter. Mais c’est beaucoup plus compliqué ! Qu’on entretienne un respect pour les aînés et particulièrement pour les parents, est une chose. Que cela se traduise dans de l’autoritarisme et de la soumission, est une autre chose.
Beaucoup de jeunes constatent que jamais ils n’ont eu de véritable dialogue avec leur père. Mais c’est tout à fait faux de penser qu’il en a toujours été ainsi. Il a existé une tradition de vie au village, où un père ne cessait d’être accompagné de ses enfants, en leur transmettant une connaissance du milieu, des animaux, des plantes, des techniques. Il n’y a pas qu’un seul mode d’éducation, cela change avec les milieux, les contextes. Il faut réfléchir : des qualités de relations intéressantes se sont aussi perdues avec l’apparition de la famille urbaine resserrée, et l’adhésion au modèle occidental de la réussite en complet veston dans un travail de bureau. Un modèle où tout l’apprentissage se fait exclusivement à l’école – où d’ailleurs on tape aussi sur les enfants !
Il ne faut pas avoir peur de ce type de débats. On dit que les Africains ont été aliénés par les Blancs de la colonisation, et que cela se transmet des pères aux fils. Certes. Mais ma génération n’a pas connu les Blancs colons, et les jeunes d’aujourd’hui encore moins. Il faut peut-être s’en rendre compte et renouveler la réflexion. Pour ma part, je n’ai jamais frappé mon fils, qui a sept ans. Et je ne considère pas que par là je cède à l’influence européenne actuelle, comme certains peuvent en faire le reproche. Je me mets à le dire dans ma famille. Donc je le dis sur scène. Trop de pères confondent la peur et le respect.
DCH : Dans le dossier artistique qui accompagne votre pièce, vous évoquez la figure du Grand manitou. C’est l’occasion de se rendre compte que si on use de cette expression assez couramment, on ne sait peut-être pas très exactement de quoi il s’agit.
Andréya Ouamba : Oh, ça n’est pas bien compliqué. C’est simplement ce personnage qui prétend tout régenter, tout gérer. Et pendant ce temps, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 30 ans, et on va continuer de t’appeler « petit » si tu ne corresponds pas au modèle de celui qui ramène tout l’argent attendu à la maison. Bon, il est peut-être temps d’oser inventer d’autres images, d’autres comportements. On n’est plus au temps de la colonisation !
DCH : En observant votre danse dans De quoi sommes-nous faits ?! on peut la ressentir plus douce et coulée, moins heurtée et percutante que celle qu’on vous a connue naguère. Est-ce tout à fait propre à cette pièce, ou plus largement à une évolution de fond, peut-être liée à une nouvelle détermination dans la prise d’âge ?
Andréya Ouamba : J’insisterai surtout sur un point : mon geste tient à mon propos. La première forme de cette pièce s’est énoncée en parlant à un micro. J’ai de plus en plus envie de danser et parler en même temps. Au fond, j’ai de plus en plus envie qu’il n’y ait pas de cloisonnement entre des activités spécialisées, qui se découperaient et se succèderaient séparément sur le plateau.
J’ai envie que la scène soit habitée par le même mouvement continu et bouillonnant de la vie. Installez-vous à une terrasse de bistrot, avec des gens qui passent, certains qui vont vite, d’autres lentement, des ouvriers qui travaillent, des gens qui parlent, d’autres qui rêvent, et une voiture avec une forte sirène, toutes ces choses qui se déroulent ensemble autour de toi, sans être séparées les unes des autres, et qui te plongent dans l’univers comme dans une circulation.
C’est ce besoin de continuité, d’y aller sans s’arrêter, que j’ai d’abord communiqué aux membres de l’équipe. Ensuite, vient le temps d’orchestrer, de moduler. Pas d’inquiétude ! Il s’est trouvé, aussi, que notre musicien joue volontiers de la rumba, qui est plutôt douce, et je suis parti de là, dans ma danse. En tout cas, c’est sûr : à des questions toniques, je n’ai pas envie de rajouter des gestes tonitruants.
DCH : Si votre pièce veut déconstruire la relation à l’autorité paternelle, est-ce que cela a été l’occasion de réfléchir à votre façon d’imposer votre autorité de chorégraphe. Notamment, l’autre interprète en danse dans la pièce est Clarisse Sagna, une fille beaucoup plus jeune que vous, qui n’a pas toute votre expérience.
Andréya Ouamba : Remarquez qu’elle a énormément d’énergie masculine en elle ! Cela dit, nous ne travaillons pas dans le même niveau de projection du geste. Pour ma part, c’est vrai, je suis en hauteur, je suis là, je suis moi ; voilà ce qui est exprimé. En revanche, le geste dansé de Clarisse Sagna peut exprimer qu’elle est plus pliée, moins en hauteur ; qu’elle n’est peut-être pas… Reste à savoir si elle n’exprime pas là une part de moi-même, quelque chose de moi étant petit, puisque je porte toute la pièce, son projet, son propos. Cette pièce est entièrement habitée de notre expérience personnelle, et donc pour chacun et chacune différente, d’une histoire vécue, en rapport avec l’éducation et l’autorité.
En tout cas, le fait est que la question que vous soulevez, qui est de définir l’autorité du chorégraphe, a été abordée, clairement posée et travaillée avec la metteuse en scène Catherine Boskowitz. Celle-ci nous a fait nous interroger longuement sur nos parcours de vie, et le sens de notre expérience de l’autorité. C’est notre matière. Après quoi, je travaille beaucoup en recourant à des images. Et j’ai demandé, par exemple, à Clarisse Sagna, d’explorer ce que pourrait être la marque corporelle d’un chien soumis au regard autoritaire d’un maître.
Bon, je sais que j’ai aussi la réputation d’être un chorégraphe têtu, qui impose son point de vue. Je me laisse guider par ce qui se passe dans ma tête, sur le propos que je porte. J’anime tout un groupe, je conduis un travail, j’amène les autres vers un objectif. Mais j’essaye de ne pas me tromper : autorité et autoritarisme ne sont pas synonymes. Il faut dire aussi que dans cette pièce, nous sommes beaucoup moins nombreux que dans la précédente, et que j’y suis moi-même interprète sur le plateau. Cela modifie beaucoup ce qui s’y vit relationnellement, de l’intérieur. Il y a un rapprochement entre nous.

DCH : Vous venez d’évoquer la présence d’une metteuse en scène à vos côtés, alors que vous êtes chorégraphe. Cette double « direction » de projet n’est pas tellement habituelle. Qu’est-ce que ça en dit ?
Andréya Ouamba : Ça en dit surtout que je m’y exprime beaucoup par la parole, et que c’est aussi le cas de Kouam Tawa, qui lui est un auteur, qui a une expérience de la déclamation poétique, mais qui n’est pas un comédien. Catherine Boskowitz a donc eu tout un travail à conduire de ce côté là. Cette pièce est extrêmement composite. Ce n’est pas une pièce de danse au sens habituel. Et encore, nous n’avons pas parlé de la vidéo, ni de la scénographie. Jean-Christophe Lanquetin, qui est l’auteur de celle-ci, s’est lui aussi prêté à la réflexion générale sur sa propre expérience de vie en rapport avec notre thème.
DCH : Pour caractériser la qualité particulière de cette pièce, vous recourez à la notion fort peu habituelle d’un « solo à plusieurs ». Il semble notamment que la présence de l’auteur dramatique Kouam Tawa, que vous venez d’évoquer, compte beaucoup pour vous.
Andréya Ouamba : C’est un solo parce que voilà, c’est moi, c’est ma vie, mon histoire. Et c’est à plusieurs, parce que la pièce est intégralement nourrie de la façon dont chacun s’est confronté, depuis sa propre expérience de la vie, depuis son propre point de vue, aux questions que j’amenais. Quand je parle moi-même sur ce plateau, c’est de façon très brute et directe, c’est issu d’un travail d’improvisation mené avec la metteuse en scène, même si c’est écrit en définitive.
Mais c’est aussi le fruit de quinze jours entiers de résidence occupée à dialoguer avec Kouam Tawa, qui lui est un écrivain, et a amené quatre-vingt dix pages d’écriture littéraire, à partir de nos échanges. Une écriture où je suis, dans laquelle il est tout autant, et finalement qui transporte la pièce ailleurs. Il a forgé huit variations intégrales de nos thèmes. Il est arrivé avec un nouveau poème chaque jour.
Mais je ressens que c’est ma vie qui se déverse là. Ma question. Pourquoi est-ce que je pleure quand je chute de l’arbre ? Je ne pleure pas tellement parce que j’ai mal ! Je pleure parce que j’ai peur de la réaction qu’aura mon père quand il va apprendre que j’ai effectué une chute depuis un arbre.
DCH : Vous êtes l’un des chorégraphes africains contemporains les plus installés dans un va-et-vient de travail entre Dakar, où vous vivez, et des temps de production en France. C’est un système qui vous convient bien, en définitive ?
Andréya Ouamba : Il me convient bien. C’est une bonne mobilité, j’ai fini par y trouver un équilibre. Mais il est vrai que ce serait quand même beaucoup mieux que j’aie plus de moyens et d’opportunité de travail en Afrique.
Entretien réalisé par Gérard Mayen le 8 mars 2018
Andéya Ouamba - De quoi sommes-nous faits ?!
À l'Atelier de Paris, CDCN les vendredi 16 et samedi 17 mars à 20h30