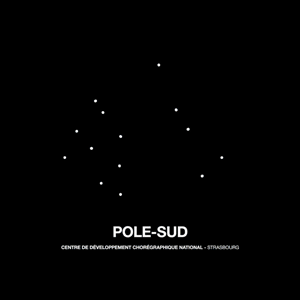Nacera Belaza au Festival de Marseille
Tutoyant le succès avec le Ballet national, puis la déception en Procession, la chorégraphe ruine les accusations portées sur son art, supposément immuable.
Nacera Belaza connaît un adoubement cet été, de la part de Jan Goossens, directeur du Festival de Marseille. On devait déjà à l'inlassable travail de l'Officina, sous la direction de Christiano Carpanini, la constitution d'un public phocéen attentif à cette chorégraphe très exigeante. Il serait stupide de réduire à ses origines la pertinence de sa présence dans la grande cité méditerranéenne. Mais il y a tout de même, dans tout geste qu'elle profère, quelque chose d'une haute élévation spirituelle, qui espère en un monde de communions par-delà le profane. Il faut le percevoir, dans une époque que le religieux déchire, comme jamais la génération antérieure n'aurait pu le présager.
La question semblait d'abord toute chorégraphique, dans l'invitation faite à Nacera Belaza de figurer parmi les sept chorégraphes invité.es à composer une pièce de sept minutes auprès de sept interprètes au Ballet national de Marseille (quatre de la dite formation, rejoints par trois de la compagnie ICK, d'Amsterdam, que continuent de diriger conjointement Emio Greco et Pieter C. Scholten, dorénavant à la tête du CCN phocéen).
Ce partage en actes entres danseurs de deux contextes et traditions fort distincts, cette confrontation à un panel d'esthétiques de grande diversité, souvent éloignées de leurs usages, s'inscrit dans l'aggiornamento voulu à la tête du Ballet, comme plus généralement par le Festival marseillais. Ce dernier recherche des positionnements plus nettement contemporains, internationaaux et néanmois chevillés aux significations socio-culturelles de sa ville.

Précisons d'emblée que Nacera Belaza – têtue comme elle est – s'est affranchie de la règle de sept présidant au projet 7even. Elle l'a arrondi, en portant à dix-sept minutes, non pas sept, son essai intitulé Humain. Apprécions par ailleurs que, hormis pour des projets avec amateurs, l'effectif de sept interprètes est un développement rare chez cette chorégraphe, de surcroît non choisis par elle, pour une pièce de commande. Sur le plan du contexte, on la voit ici expérimenter une configuration non conventionnelle.
Humain débute très belazienne : vêtus de noir sur le noir du fond (comme de toute la cage) de scène, les sept interprètes sont alignés au lointain et à face. Seule les anime une répétition mécanique de fléchis des membres inférieurs. Chacun n'apparaît que dans un faible halo lumineux. On retrouve l'atmosphère de condensation monacale, et d'esquisse minimale juste perceptible, qui travaille au fond l'art de la chorégraphe.
Dans ce dispositif, les peaux dénudées se distinguent nettement par contraste. Mais plutôt que les visages, ce sont les mains qui captent le regard. Pendant au bout des bras, elles sont soumises aux lois premières de la gravitation. De sorte que les gagnent des effets de balancements, de sursauts, d'éclats dans l'espace, qui n'ont rien d'uniforme. Et cela monte en intensité au fur et à mesure que la dynamique de flexions-extensions s'amplifie elle aussi, insensiblement. On ne se lassera jamais du bonheur en quoi la danse manifeste des puissances de vie, par des canaux indéfiniment renouvelés, jusque là peu aperçus. Vu de la sorte, ce monde est ample, même chevillé à l'extrême d'une sobriété de principes.
De façon analogue, sans qu'on s'en soit trop rendu compte, la ligne des danseurs a avancé, insensiblement, à la face et vers le front de scène, mais au bord d'une divagation, d'un éclatement, qui étoile les présences sur scène. Cette dillution finira par muter dans une disposition en cercle. Se produit alors une rupture franche d'intensités, où cette ronde rappelle finalement une battle : tour à tour, chacun.e des sept danseur.ses va s'en détacher, se projeter vers le centre du cercle, et s'enflammer dans une brève incandescence de gestes décochés à l'adresse du monde, carbonisés.
Il en découle un scintillement des singularités tour à tour investies par chacun respectivement. Tout est à la fois net, sobre et sec ; or, magnifiquement divers. On éprouve la sensation d'une libération d'intensité du propos, un débordement gestuel, mais qui ne fait sens qu'au regard de la stricte austérité du processus de condensation qui l'a précédée et y a conduit. N'empêche, après Sur le fil, déjà animée de moments d'ivresse du geste, on repère là un tournant dans l'art de Nacera Belaza.

Un tournant n'est pas une rupture. Un tournant fait suite dans la trajectoire jusqu'à lui inscrite par un parcours. Un tournant n'est qu'une suite. On accède pleinement au souci de la chorégraphe, quand elle préfère souligner des principes de cohérence et de continuité animant son travail. On entend parfaitement en quoi cette autorisation à une forme exubérante, voire lyrique, du mouvement, aura nécessité plus d'une décennie de contraintes et restrictions extrêmes. Ainsi, rien de ce tournant ne menace de faire dérapage. Ce serait pour avoir pris tout le temps de creuser au plus extrême du noyau vital et spirituel du mouvement humain, que cette insistance vient à permettre aussi une vibration à la surface. S'il a quelque chose de jubilatoire, alors c'est au sens des essences de vie et de danse. Aux antipodes de toute trivialité.
La chorégraphe aura semblé en prendre le contrepied, quelques jours plus tard, dans sa Procession et solos. On avait eu la chance d'assister à l'amorce de cette nouvelle forme, déjà à Marseille, mais cette fois à l'invitation – et à l'intérieur – du musée du MUCEM. Ni pour les spectateurs, ni pour le critique, rien ne laissait présager ce qui allait se produire ce soir-là. On fut émerveillé par un dégel des conventions de visite de l'espace muséal, générant des flux de circulations humaines partagées, d'une intensité énigmatique et inédite.
Rien de cela ne s'est reproduit dans le parc François Billoux pour le Festival de Marseille. Il y est d'emblée annoncé qu'on va prendre part à une procession. Tout un cadre de conventions s'abat sur la situation. Il en va jusqu'à un appariteur en uniforme qui mouline des bras pour engager le spectateurs à bien se mettre en mouvement comme il faut. Lequel mouvement est rendu strictement dépendant d'un pack de tête, autoritaire, si profonde et délicate soit l'émission vocale du choeur expérimental Mi[ki] qui le constitue. On ne fait que suivre, à une lenteur de pas caricaturale, qui ne peut s'imposer par décret, et inspire dès lors à plusieurs participants de s'égarer en papotages hors propos.

De tout cela, on est néanmoins remercié, lorsque sous un arbre fabuleux, en bout de parcours, se produit l'installation autour de ce qui se présente clairement comme une scène entourée de bancs pour les spectateurs. On savait que tout passage à la Skené est affecté d'une dimension rituelle. C'est le mérite de l'essai de Nacera Belaza de hisser cette ritualisation au rang passager d'une sacralisation. Ce moment est intense, mais retombe quand les solos successifs de la chorégraphe, puis de sa sœur Dalila, s'émoussent bien vite : parce que donnés à l'air libre, ils sont privés du cadre scénique strict qui, habituellement, met en tension leur rareté au point d'en acérer l'acuité.
A l'inverse, dans ce cas, on se ressent assiter à un spectacle, coupé de soi, sans trop d'impact. Ainsi Nacera Belaza ne cesse de prendre des risques. N'y auront rien compris, ces professionnels adeptes de la bêtise méchante des usages du milieu, claironnant au final : « Avec Belaza, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne la voit pas de trois ans, on y revient, mais absolument rien n'a changé ». C'est tout le contraire. Mais sans garantie que "ça marche". Car cette artiste n'évolue pas à ce niveau de trivialité.
Gérard Mayen
Spectacle vu le mercredi 28 juin 2017 dans le cadre du festival de Marseille
Catégories: