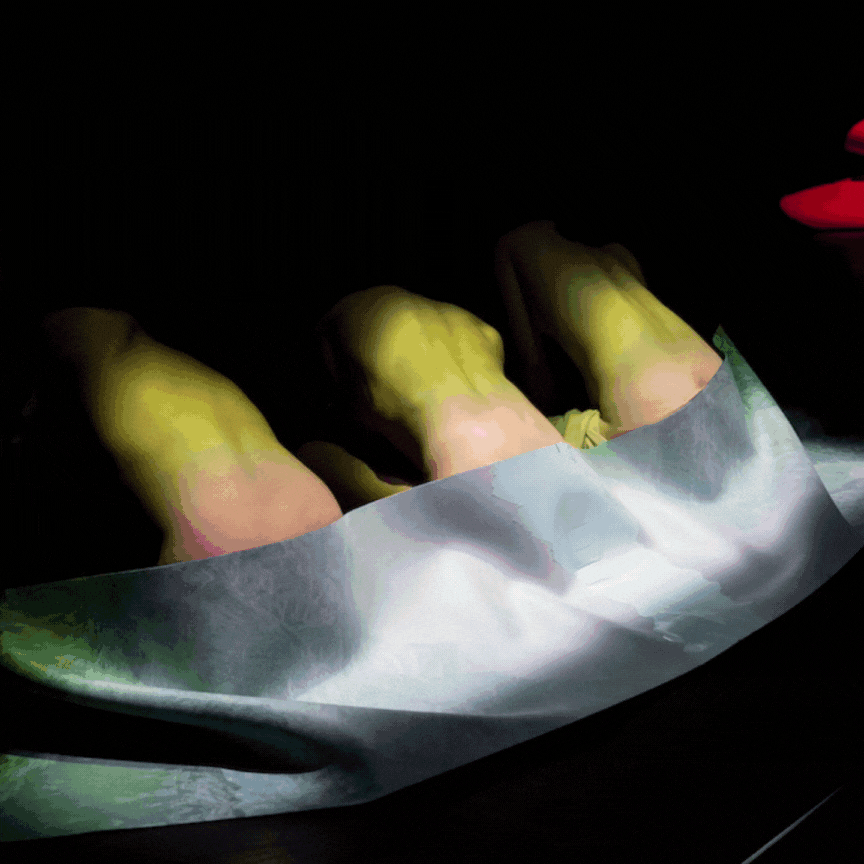Add new comment
« Vois-tu celle-là qui s'enfuit » de DD Dorviller et Catherine Meurisse
Chorégraphe et dessinatrice engagent leurs deux arts dans un éloge de la fuite, fugace et vertigineux.
Jean- François Munnier ne manque pas de confiance utopique, lorsqu'il annonce, pour l'éditorial du festival Concordan(s)e, que « chacun sortira de cette expérience un peu différent ». Ce festival, qu'il a créé, applique de façon immuable le même protocole : il met en rapport un.e écrivain.e et un.e artiste chorégraphique. Tou.te.s deux font œuvre commune de leur différence. Et cette rencontre se joue en public.
La paire constituée de la chorégraphe DD Dorviller et de la dessinatrice Catherine Meurisse comble les vœux de Jean-François Munnier, dans leur duo Vois-tu celle-là qui s'enfuit. Elles partent d'une observation passionnée des Niobides, un groupe de statues installées dans le jardin de la Villa Médicis à Rome, où elles ont séjourné. Cet ensemble sculptural illustre un récit mythologique, mettant en scène la fuite de jeunes filles devant des poursuivants qui les menacent de leurs tirs de flèches.

De cette expérience, on est sorti différent, comme souhaité. Différent, parce qu'on est tellement habitué, en danse, à privilégier l'attention pour la relation entre musique et danse, qu'on pense avoir découvert quelque chose – ça n'est pas tous les soirs, au spectacle ! – de la fécondité de l'entrelacement des arts. D'ailleurs, le festival Concordan(s)e effectue lui-même un pas de côté, dans la mesure où Catherine Meurisse, auteure, l'est par le geste du dessin, plutôt que l'écriture littéraire.
C'est tout d'abord la résonance décalée entre deux gestes du corps, l'un dansant, l'autre dessinant, mais tous deux écrivant, qui attire l'attention. La danseuse, réduite à la modestie d'apparence d'un justaucorps, reproduit très directement des figures observées sur les sculptures. Le spectateur n'a accès à aucune image de ces dernières. Le premier mouvement est donc déjà celui, imaginaire, d'une interprétation d'une première forme artistique donnée, par DD Dorviller.
La traduction en paraît aussi incisive et posée que les motifs reproduits sont abondants et divers. Or c'est bien tout un style qui se forme là, où l'on suppose que le sculpteur a voulu capter, et souligner, des attitudes très marquées dans le mouvement de la fuite, la peur, l'espoir d'en réchapper, le geste de se protéger. C'est extrêmement théâtral. Mais alors même que la danseuse développe cela dans un volume en mouvement, elle opte pour une claire sobriété de trait, qui se cristallise dans le détail des mains.

L'occasion est rare que le regard dansant soit sollicité de manière si insistante sur le jeu des poignets, des paumes, des doigts. L'art chorégraphique n'a pas connu assez de Dominique Bagouet pour cela. On en est captivé. Tout comme on l'est par la seconde interprétation, que la dessinatrice en produit, de façon instantanée : sur sa table, elle meut ses propres mains pour restituer les mouvements – en fait surtout les postures arrêtées en freeze – de celles de la danseuse. Cela est filmé et projeté en simultané, en format géant sur un écran de fond de scène. L'image en deux dimensions vient disputer, autant que discuter, avec le mouvement de DD Dorviller.
C'est extrêmement simple. Or captivant. Car moins instantané, ou simultané, qu'on vient de le dire. Le dispositif donne à capter le temps d'observation, de tâtonnement, d'adéquation, qui habite le geste de la dessinatrice. Le regard spectateur entre dans la vibration de son mouvement d'interprération en train d'opérer. Si on s'attache à sa personne en train d'oeuvrer, on se rend compte qu'elle ne regarde quasiment jamais ses propres mains en train de chercher leur disposition sous ses yeux, sur la table. Elle préfère fixer celles de sa partenaire danseuse. De ce fait, on pressent comment la traduction manuelle qu'opère la dessinatrice, est véhiculée le long d'un cheminement d'abstraction mentale, au point qu'elle n'a quasiment pas besoin de contrôler de visu ce que ses mains sont en train de produire. Quant à DD Dorviller, elle ne travaille elle-même qu'en relation de mémoire avec son sujet.

Alors que sous nos yeux, ici et maintenant sur ce plateau, tout est extrêmement concret, évident dans cette affaire de deux paires de mains qui bougent, et qui s'imitent, tout procède avec la légèreté de l'ellipse. Un monde vertigineux s'entrouve, qui est celui des fonctionnements sensori-moteurs, des sélections perceptives, impressions mentales et inductions gestuelles. On s'émerveille de façon presque enfantine. On songe aussi, de manière plus savante. N'est-on pas confronté là à un jeu chiasmatique, hélicoïdal, d'entrelacements sensibles et inter-disciplinaires, dont on pourrait transférer les enseignements aussi bien du côté de la relation entre musique et danse ? Ou autre.
Voici qu'on a été bien long, pour commenter un premier procédé, qui n'occupe que quelques minutes initiales du spectacle. Mais presque tout est dit. Un second procédé va suivre. Cette fois la dessinatrice est munie d'un pinceau. On continue d'en suivre les jeux à l'écran. On s'étonne d'abord. Les traces restent invisibles sur le papier, alors que l'instrument de dessin parcourt bel et bien celui-ci. On ne peut capter que le mouvement, le rythme, les suspensions, les insistances, les reprises et remords, les soulignements, du geste lui-même de peindre.

Mais c'est un procédé proche de l'aquarelle qui est ici mis en œuvre. Sur son esquisse supposée, l'artiste fait ensuite tomber des gouttes d'une encre qui se répand sur le support en fonction des traces humides, jusque là imperceptibles à l'oeil, laissées par le pinceau. C'est par tâches mouvantes, par coulées et dilutions, qu'opère ainsi une révélation. Le différé entre figures dessinées dans l'espace par la danseuse, toujours si précises, et formes plus étirées, décalées, attendues sur la toile de l'écran, fait épouser, dans l'acte artistique même, conjoint et dédoublé, uni mais séparé, le mouvement de l'élan, de la fuite, de la sortie de soi.
Tout cela s'orchestre aussi dans une perspective temporelle, qui convoque réminiscences antiques, références plasticiennes d'époque classique (les sculptures), incise contemporaine de la danse, et palpitation d'un dessin où le choix de la couleur rouge renvoie peut-être autant au sanglant de l'actualité qu'à la manière des sanguines. Cette pièce dure trente minutes. Mais chacune de ses secondes invite au transport dans les rebonds de l'intelligence vécue. Laquelle ne relève, chez tout être en tout instant, que d'un mouvement d'interprétation de ce qui l'entoure. Il est excellent que le propos de la danse se loge à cet endroit.
Gérard Mayen
Spectacle vu le mercredi 15 mars à la Maison de la poésie (Paris). Le festival Concordan(s)e se poursuit jusqu'au 2 avril, dans de multiples lieux de la région parisienne.
Catégories: