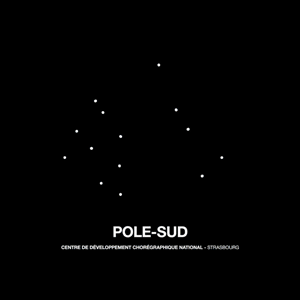Add new comment
« Ouvrir le temps (the perception of) » d'Eva Klimackova et Laurent Goldring
Un rigoureux, affolant et délicieux précis d'écriture insolite du mouvement dansé.
La danseuse Eva Klimackova et le chorégraphe Laurent Goldring cosignent le solo Ouvrir le temps (the perception of). La première des deux l'interprète en scène. On est bien habitué à ce genre de cosignatures, qui attestent, généralement, d'une réflexion critique soucieuse de reconnaître à l'interprète la part d'autorat qui lui revient dans un processus de création ouvert – à commencer par la production de son propre geste.
 Mais on aurait tort de s'en tenir à celà dans le cas d'Eva Klimackova et Laurent Goldring. Quand ils cosignent Ouvrir le temps, cela signifie que tous deux en partagent la chorégraphie. Mais cela attire aussi l'attention sur le rôle particulier du second. Notons que Laurent Goldring,
Mais on aurait tort de s'en tenir à celà dans le cas d'Eva Klimackova et Laurent Goldring. Quand ils cosignent Ouvrir le temps, cela signifie que tous deux en partagent la chorégraphie. Mais cela attire aussi l'attention sur le rôle particulier du second. Notons que Laurent Goldring,
doté d'une forte charpente philosophique, est un artiste plasticien s'interrogeant sur les représentations du corps, autant qu'un chorégraphe au sens plus usuel. On lui doit de grands moments dans la déconstruction du corps chorégraphique emblématique – cela du temps, par exemple, de sa collaboration avec Maria Donata d'Urso.
Pour Ouvrir le temps, la question attirante consiste à situer le moment de l'intervention plasticienne de la prise de vue, du regard plasticien posé sur le corps. Ce moment se situe au coeur même du processus de composition. Cela n'a rien à voir avec l'ordinaire de la photographie ou de la vidéo de danse, venant capter l'image d'une figure chorégraphique au moment où celle-ci a déjà été produite comme résultat d'un processus de création.
Goldring prend ses images alors même qu'il est en train de partager avec la danseuse l'élaboration du mouvement. La spécificité du regard plasticien qui anime cette image s'intègre alors comme l'une des composantes débouchant dans la production du mouvement qui sera retenu. Cette procédure inhabituelle se traduit dans le mode de composition même du mouvement chorégraphique. Animé du référent imagé, ce mode de composition peut s'affranchir, pour bonne part, du souci de l'élaboration des transitions, qui parfois verrouille l'avancée dans un désir plus ou moins conscient d'image aboutie à ordonner.
On pardonnera l'éventuelle aridité du développement qui précède, au simple vu de la danse déployée dans le solo d'Eva Klimackova. Qui est étourdissante. Avouons un plaisir naïf qu'on peu trouver parfois en danse contemporaine : c'est le plaisir d'observer des mouvements qu'on n'avait jusque là jamais vus, qu'on n'avait jamais imaginés, alors même que tout un chacun partage la banalité d'être et d'avoir un corps dont la manifestation la plus immédiate est de produire incessamment des mouvements sans que ça fasse une histoire. La jubilation, dans Ouvrir le temps (the perception of) est que cela n'arrête jamais pendant les quarante minutes que dure ce solo. Le regard spectateur y effectue l'expérience de l'ouverture d'un abîme.
Cela se passe sans musique, mais à l'écoute, de temps à autre, de la poésie de Gherasim Luca. Celle-ci combine une collection de notions de base, non sans gravité, telles que les frissons, les idées, les angoisses, le vide, la mort. Le texte s'égrène à la façon d'un mode d'emploi, donnant instruction ici de « fléchir la mort vers la gauche », là « de conserver les idées tendues », ailleurs de « ne pas détacher le vide du sol », ou encore « de tenir les angoisses en arrière ». Cette combinatoire absurde se démultiplie à l'infini. Et la méditation existentielle y prend un tour saugrenu.
C'est à cela que répond le mouvement dansé, de façon décalée. Au Théâtre de la Reine blanche, où le festival ZOA s'inaugurait avec ce solo, le tapis de scène, comme son fond, étaient strictement noirs. De même la tenue de la danseuse, short et tee-shirt. De sorte que la peau, guère bronzée, de ses bras et ses jambes, au-delà de la manche, au-delà du short, était affectée d'un fort coefficient de contraste visuel, en blanc. Cela favorise une sorte de glissement de la forme – la part blanche des membres – tendant à se détacher du fond noir (de scène, du tapis, mais aussi du reste du corps).
Par là se faufile un déconstruction perceptive de l'image, généralement prépondérante, d'un corps unifié dans une silhouette dument repérée dans la clarté de son contour – cela tient de la saisie scopique dans l'instant, mais aussi d'un solide héritage culturel. Le geste de la danseuse peut être simple (parfois non, jusqu'à un quasi contorsionnisme au parfum libertaire).

Voyons par exemple un bras simplement abandonné à sa force gravitaire, lâché en direction du sol. Puis voyons l'animation de ce bras à la façon d'un balancier. Puis l'amplification de cette bascule. Enfin, soudaine, l'intervention de l'autre bras, déviant brusquement la course du premier. Puis les rebonds et combinaisons entre eux. Une algèbre. Une dérivation arborescente. Un affolement du regard. Une main dont on ne sait plus à quel bras elle est reliée, quand encore elle n'apparaît pas derrière le pied où on la pensait incapable d'aller.
Or on n'est pas ici devant un stand de la foire aux illusions optiques. Fût-elle pourvoyeuse de quelques moments délurés, on traverse ici une écriture gestuelle de très haute poésie, qui tient beaucoup à un vertige doux. Celui-ci se creuse dans le paradoxe qui voit s'imposer un principe de déliaison pourtant développé sur le mode d'un continuum. Au titre de la première, chaque geste se perçoit comme signe isolé, abstrait, donnée brute séquencée, parfois non reconnaissable. Au titre du second, cela ne cesse néanmoins de faire flux, qui emporte, parfois au bord du merveilleux.
Faut-il évoquer ici les travaux de la chronophotographie, qui jouèrent tant dans la modernisation de la compréhension du mouvement, en même temps que dans les balbutiements de l'art cinématographique ? Mais on reste loin des genres de séries formalisées, dans lesquelles a pu exceller un Brice Leroux. Le geste demeure ici très prégnant, plutôt décontracté, voire imparfait. On y ressent la détermination d'une intention, comme venant d'une danseuse déjà habitée par la conscience imagée de la figure qu'elle produit, et beaucoup moins une obsessions de la stricte exécution. Ce solo palpite.
On se prend à se demander de deux choses l'une. Ou bien jamais on ne nous avait montré des gestes de ce type. Du moins de cette façon. Ou bien ces gestes existaient déjà, mais nous n'avons pas appris à les voir. Ou pas eu la curiosité. Ou été empêchés par construction culturelle. En toute philosophie de la représentation, on penche bien entendu pour la seconde série de ces hypothèses. Mais qu'importe, peut-être, tant cela clame la stimulante liberté d'un vouloir pouvoir voir.
Gérard Mayen
Spectacle vu le 9 octobre 2016 au Théâtre de la Reine Blanche, en ouverture du 5e festival ZOA (zone d'occupation artistique). Prochain rendez-vous de ce festival, jeudi 13 octobre à Micadanses : Debout – Se relever, de la compagnie Kikuvo (République du Congo), très prometteur lorsque vue en étape de travail voici quelques semaines. Puis Les corps mous, de Vincent Lacoste. Réservations : 01 72 38 83 77.
Catégories: