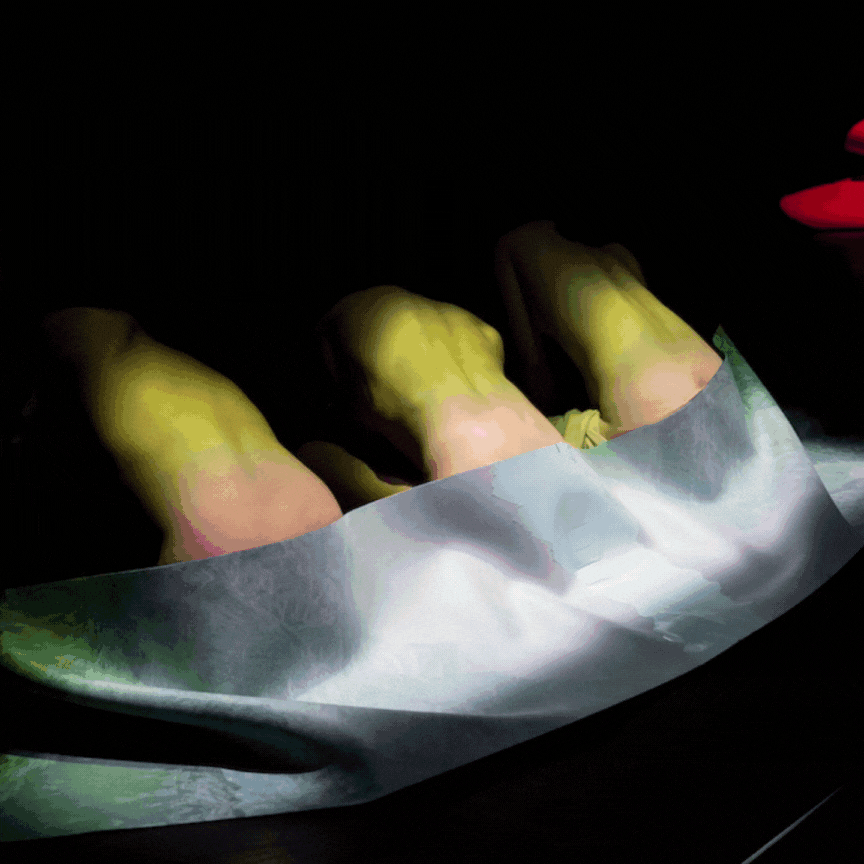Add new comment
Le festival Souar Souar à N'Djamena (Tchad)
Du 8 au 16 décembre s'est déroulée à N'Djamena la quatrième édition du festival Souar Souar – ce qui signifie tout simplement "Danse ! Danse !" en langue Kabalaye, l'une des principales du Tchad. Malgré une embellie pétrolière inattendue, aujourd'hui douchée par la chute des cours, ce pays sahélien demeure le troisième plus pauvre du monde. Trois décennies durant on en a entendu parler pour ses guerres Nord-Sud, et ses dictatures. La paix intérieure à peine revenue, le voici impliqué en gendarme régional dans la crise centrafricaine et les alliances militaires anti-islamistes au Cameroun, Niger et Mali.

C'est dire que tout ne prête pas à sourire, ni ne prédispose aux envolées artistiques, dans un pays sahélien dont la société demeure profondément conservatrice. Par ailleurs, le Tchad est très enclavé, on s'y sent éloigné de tout, et notamment des pôles africains où de nouvelles esthétiques de la danse ont pu se développer au fil des deux décennies écoulées.
Bravant tous ces handicaps, le festival tchadien a surpris par l'abondance de sa programmation, offrant un très large pannel, au point que ces soirées comptant jusqu'à cinq spectacles, voire plus, ont pu paraître parfois interminables. Mais leur grande originalité était de se séparer en deux lieux, deux atmosphères, deux axes de propositions.
D'abord, en fin d'après-midi, dans l'espace techniquement équipé et devant un public plus sélectionné, la scène de l'Institut Français accueillait les pièces les plus exigeantes, notamment internationales. Prenait ensuite le relais, jusque fort tard dans la nuit, dans un quartier moins central et dans une ambiance de « village » juvénile et populaire, une scène plus ouverte au hip hop, aux artistes du cru, alternant avec des groupes musicaux.

Ce balancement est très intéressant à observer. Si on rajoute que la très faible fréquentation par les professionnels ou la presse internationale a permis des rencontres simples et décontractées, la quatrième édition de Souar Souar aura prêté à réflexion approfondie sur les conditions actuelles du développement de la scène contemporaine de la danse en Afrique. On pressent que la politique des « coups », même au nom des meilleures intentions, conduit à produire des à-coups artifciels dans les parcours des artistes, en lieu et place d'une logique de développement durable, plus proche de leur environnement.
La chorégraphe sénégalaise Fatou Cissé en sait quelque chose, dont la surexposition surdimensionnée au dernier festival d'Avignon, s'est soldée par un échec très douloureux. On l'aura retrouvée à N'djamena, présentant un nouveau projet en cours, sous le titre Ce qui restera...Cela se présente sous le format, cette fois idéal, d'un duo avec le musicien Oumar Sarr, dans un échange scénique électrisé. On y retrouve une Fatou Cissé totalement frappée, femme éperdument libre, traçant son langage très bellement plastique.
 Les très forts propos de femmes auront d'ailleurs fourni une cohérence convaincante à ce festival. Ce choix délibéré du directeur artistique Abdoulaye Tobio résonnait fortement dans un contexte où les performances féminines ressemblent souvent à des défis, devant un public encore peu préparé, interloqué par la nouveauté, très majoritairement masculin et pas toujours féministe (c'est un euphémisme) , n'hésitant jamais à interjeter bruyamment ses commentaires.
Les très forts propos de femmes auront d'ailleurs fourni une cohérence convaincante à ce festival. Ce choix délibéré du directeur artistique Abdoulaye Tobio résonnait fortement dans un contexte où les performances féminines ressemblent souvent à des défis, devant un public encore peu préparé, interloqué par la nouveauté, très majoritairement masculin et pas toujours féministe (c'est un euphémisme) , n'hésitant jamais à interjeter bruyamment ses commentaires.
À ce jeu combattant, on n'oubliera pas le défi de la Mozambicaine Janeth Mulapha. Comme chez beaucoup de ses compatriotes artistes, la prégnance de l'art-performance, plutôt que la danse stricto sensu imprègne son solo O Meu genero mora aqui (titre où on décèle la référence à la question du genre). Laquelle est ici abordée à la façon d'un quasi funambulisme sur talons aiguilles, obstinément engagé, finalement victorieux, yeux dans les yeux des spectateurs rendant les armes, en contexte d'installation déambulatoire.
Française, d'origine camerounaise, Nathalie Mangwa trouve dans la référence au contexte africain la source originale d'un propos tout aussi combattant, où elle déchire son corps dans des explosions directionnelles affichant ses pulsions de liberté. Cela gagnera à se composer plus. Dans une sorte d'opposé, également française, mais d'origine malgache, et revenant d'un séjour new-yorkais de plusieurs années, Gwen Rakotovao opère à l'opposé.

Son geste arrondi, jamais fini, porte l'empreinte d'un swing afro-américain (source Alvin Ailey), mais expurgé de tout clinquant lyrique. La longue composition en boucles de reprises, de son solo Initiation, résonne intiment avec ses boucles de mouvement quasi hypnotiques, tout auprès du corps. Ce fut un miracle, de voir cette poésie abstraite, quarante-cinq minutes durant, envoûter un public renonçant enfin à ses turbulences. Il faudra compter avec Gwen.
Dans l'impossibilité de tout évoquer, on ne fera que citer au passage les propositions plus directement africanistes de l'Ivoirienne Bacome Niamba, en mainteneuse d'une ambition de tragédienne de la scène, et son pendant masculin, saturé de symbolique, Vincent Mantsoe, bien connu en France. Enfin, la Tunisienne Nour Mzoughi a développé l'idée très audacieuse d'une danse de ses cheveux, hélas emmêlée dans les relents de vieille jeune danse à la française telle que la cultive toute une jeune génération tunisienne formée dans cette filiation.

On aura remarqué que toutes les pièces précédemment mentionnées sont des solos. Cela en dit assez quant aux conditions de production qui ne cessent de se rétrécir. Les Tchadiens emmenés par Rodrigue Ousmane, Ahmed Taïgué, Aleva Ndavogo auront heureusement inversé ce cours. On leur doit diverses combinaisons intéressantes entre actualités de propos, essais de modernité et références traditionnelles, que le regard occidental ne parvient pas toujours à bien décrypter.
Et c'est finalement en solo, toujours et encore, que deux d'entre eux auront brillé à un niveau évidemment international : dans Yadou, Yaya Sarria joue de trajectoires savantes et d'énergies économes, pour parvenir à faire vibrer au plateau les perspectives du vide, de l'effacement et du lointain, qu'appelle l'évocation de sa mère nomade, qu'il a perdue très jeune de vue, à jamais. À l'inverse expressionniste et virulent, parfois proche du butô, Hyacinthe Tobio projette les fulgurances de ses membres insensés, tout en segments, pour conjurer les tourments d'une vie africaine, dont les accents violents pourraient résonner aux confins de la folie.
Gérard Mayen
Catégories: