« Maria de Buenos Aires » de Matias Tripodi
L’Opéra national du Rhin a dévoilé sa nouvelle production à la Filature de Mulhouse. Il s’agit, en l’occurrence, de la version de Matias Tripodi de l’opéra-tango Maria de Buenos Aires (1968) d’Astor Piazzolla et Horacio Ferrer.
Ce « petit opéra », ou operita – pour reprendre l’expression du bandonéoniste qui réforma la milonga au début des années soixante – se basait sur une légende urbaine datant « du temps du tango » – comme disait Léo Ferré – symbolisant l’expression porteña via la vie d’une ouvrière poussant la chansonnette dans des beuglants plus ou moins bien famés. La destinée de l’héroïne, mi-Carmen, mi-Anna (personnage double ou bipolaire des Sept Péchés capitaux de Bertolt Brecht et Kurt Weill), mi-Mimi (Pinson) s’annonçant tragique, faut-il considérer sa résurrection comme un miracle ou un « happy end » ?

Il faut croire que le bourdon est partie intégrante de l’opus traitant d’une mater dolorosa. La poésie sous-surréaliste de Ferrer file doux sous forme de lyrics, suavement modulée par Ana Karina Rossi (qui tient le rôle-titre) ou teutoniquement accentuée (= opératiquement mise en bouche) par le ténor Stefan Sbonnik. Mais elle gêne aux entournures nombre de spectateurs lorsqu’elle est dite, récitée, surjouée par le personnage du Narrateur (el Duende ou l’Esprit), un barde qui ne cesse de faire de fausses sorties et finit par lasser comme celui d’Astérix gâchait les meilleures soirées en transformant les festins en capilotades. Ce poète ou son représentant sur scène, baroque, mélancolique, hyperbolique, on souhaiterait par endroits aussi pouvoir le bâillonner.
 Cette impression de désenchantement, on la trouve déjà dans les airs d’un Piazzolla ayant quitté la proie (Anibal Troilo et son indépassable orchestre) pour l’ombre – cf. la sériosité, la complexité ou complexe de Nadia Boulanger qui a eu d’éminents élèves comme George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Phil Glass, Lalo Schifrin ou Quincy Jones mais qui a poussé au moins deux d’entre eux, Michel Legrand et le natif de Mar del Plata, à abuser de leur virtuosité, à préférer le brio au swing, à confondre vitesse et précipitation. Le jazz comme le tango ne sont pas purs objets d’écoute contemplative ; ils sont, ont été et peuvent l’être encore, musiques à danser.
Cette impression de désenchantement, on la trouve déjà dans les airs d’un Piazzolla ayant quitté la proie (Anibal Troilo et son indépassable orchestre) pour l’ombre – cf. la sériosité, la complexité ou complexe de Nadia Boulanger qui a eu d’éminents élèves comme George Gershwin, Leonard Bernstein, Aaron Copland, Phil Glass, Lalo Schifrin ou Quincy Jones mais qui a poussé au moins deux d’entre eux, Michel Legrand et le natif de Mar del Plata, à abuser de leur virtuosité, à préférer le brio au swing, à confondre vitesse et précipitation. Le jazz comme le tango ne sont pas purs objets d’écoute contemplative ; ils sont, ont été et peuvent l’être encore, musiques à danser.
Maria de Buenos Aires a fait l’objet de reprises à travers le monde – celles-ci se sont multipliées à l’approche du cinquantenaire de l’œuvre. L’une des plus marquantes en France reste celle, en 2003, du metteur en scène Alfredo Arias qui s’était attaché la collaboration de la talentueuse chorégraphe argentine Ana Maria Stekelman et du grand bandonéoniste Juan José Mosalini. Une des disciples de celui-ci, Carmela Delgado, manie en fosse le soufflet. Il faut dire que Paris avait, dans les années 80, contribué au renouveau du tango, pas seulement de la musique (le mixage électro devra attendre le changement de siècle et l’arrivée de Gotan Project) : celui de la danse, de la pratique du bal, sur les quais de Seine, dans des cours de danse et les dancings (cf. l’engouement pour les Trottoirs de Buenos Aires).

L’apport culturel des réfugiés politiques argentins, le militantisme d’orchestres comme le Cuarteto Cedron, l’engagement poétique d’une Michèle Rust, d’un Philippe Chevalier, d’une Dominique Rebaud qui fusionnèrent cette expression au contemporain, les recherches pointues d’un Rémi Hess, l’activisme de Christian Dubar et de Dansons, le magazine de danse de salon de Toulouse (ville de naissance de Carlos Gardel), furent couronnés par la mémorable programmation d’Ariel Goldenberg à Chaillot.

La reprise de Maria de Buenos Aires renoue avec une période qui commençait à s’estomper dans notre esprit. C’est un événement en soi qui mérite d’être souligné. D’autant que l’Opéra national du Rhin a mis les moyens nécessaires à cette création ou recréation, à commencer par son corps de ballet, irréprochable techniquement. La pièce, découverte le soir de la première, gagnera certainement à être rôdée. La danse trouvera sa fluidité et l’orchestre sa juste intensité – la donnée rythmique, par laquelle Piazzolla a cherché à dépasser la perfection orchestrale à laquelle il avait personnellement contribué au sein de la formation de son maître Troilo, paraît essentielle et les batteurs et percussionnistes de La Grossa doivent lâcher la bride et ne pas se limiter à jouer les métronomes. Le chorégraphe aime se référer à Pina Bausch (laquelle, il faut rappeler, signa Bandonéon en 1995), qu’il connut personnellement.

Cependant, sa manière est plus proche d’après nous du néoclassicisme béjartien. Sans même évoquer la figure de Jorge Donn, danseur argentin qui inspira ce dernier, sans avoir à rappeler quelques-uns de ses titres (Tangos, Mozart-Tango, Sept tangos, Che, Quijote y Bandoneon...), nous noterons une analogie entre l’univers de Tripodi et celui du créateur marseillais. Non seulement chorégraphiquement mais aussi scénographiquement parlant. A cet égard, l’empilement des sièges bistrot, les vestes de costumes masculins portées à même le torse nu, la noirceur d’ensemble rappellent le ballet Les Chaises (1981) où s’illustrèrent Marcia Haydée et John Neumeier.

Les passages de chant féminin-guitare seule, à peine électrifiée, plus qu’électrique, dans le style subtil usant d’harmoniques d’un Wes Montgomery, sont efficaces, sans besoin de tambours ou trompettes – batterie, xylophone, flûte traversière, etc. La chanteuse Ana Karina Rossi nous a paru toute en nuances, et restant dans la tradition d’une Libertad Lamarque ou d’une Susana Rinaldi. Sa diction est proche de celle d’une des plus grandes cantaoras de flamenco, Carmen Linares.
 Le parti pris opératique de Piazzolla, probablement en quête de légitimité culturelle, avec le chanteur ténorisant à la manière d’un Paul Robeson (comme l’avaient du reste fait dans les années trente les interprètes de Porgy and Bess) reste discutable, sinon discuté – les qualités vocales de Monsieur Sbonnik n’étant pas en cause.
Le parti pris opératique de Piazzolla, probablement en quête de légitimité culturelle, avec le chanteur ténorisant à la manière d’un Paul Robeson (comme l’avaient du reste fait dans les années trente les interprètes de Porgy and Bess) reste discutable, sinon discuté – les qualités vocales de Monsieur Sbonnik n’étant pas en cause.
Enfin, nous avons apprécié le travail de mise en scène en général, la projection des magnifiques photos en noir et blanc de Claudio Larrea, agrandies et cadrées en diagonale et le soin apporté au détail de tous les tableaux. Certains d’entre eux nous ont particulièrement touché, comme le « poème valsé » ou celui sur la « misère des faubourgs ». Sans parler de « l’air des psychanalystes » ! Le final, Tangus dei, est vraiment réussi. Dans ces passages ou moments de duende, la danse n’illustre pas, ne remplace pas le texte. Elle s’accouple joliment aux chorus, aux accords, aux accents des chanteurs.
Nicolas Villodre
Vu le 26 avril 2019 à la Filature de Mulhouse.
Catégories:










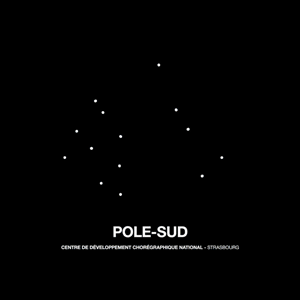








Add new comment